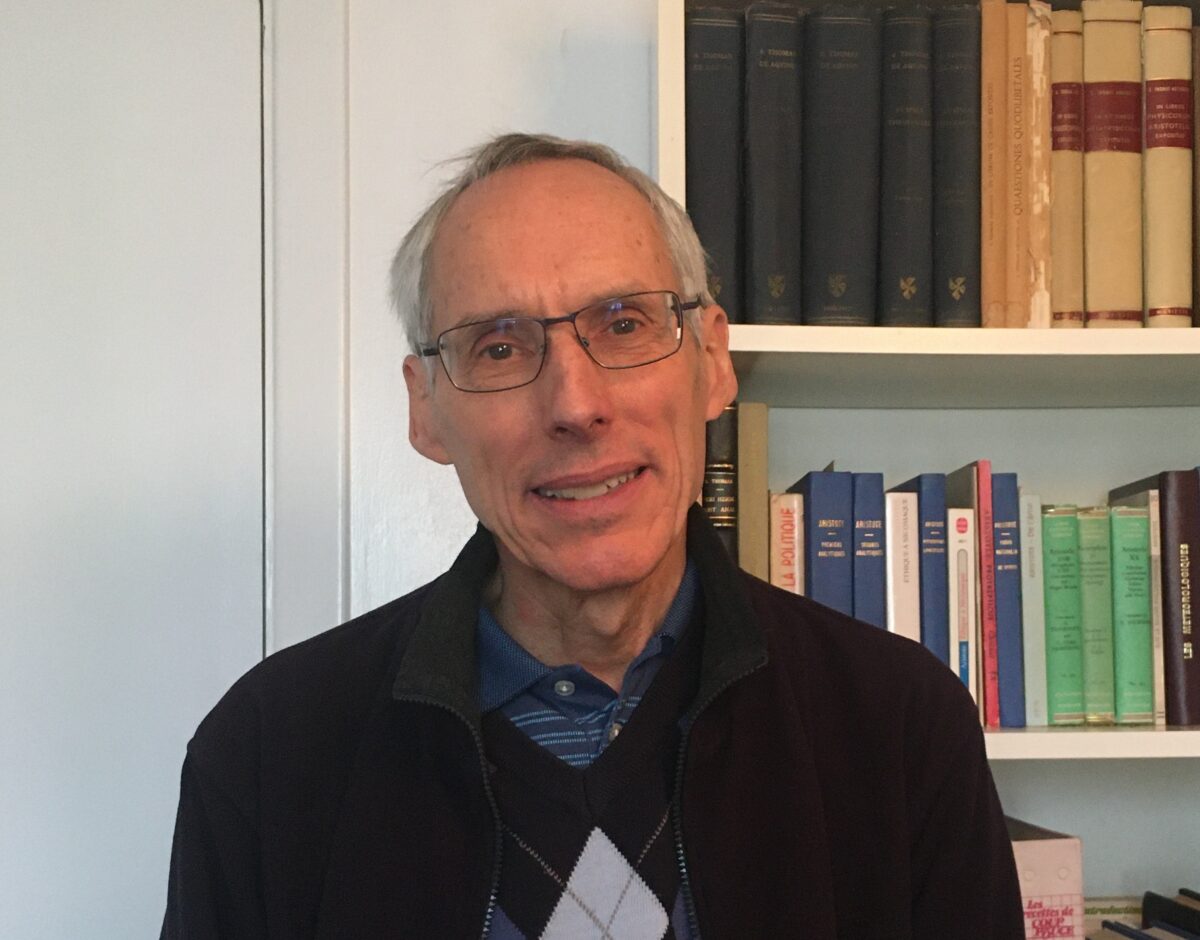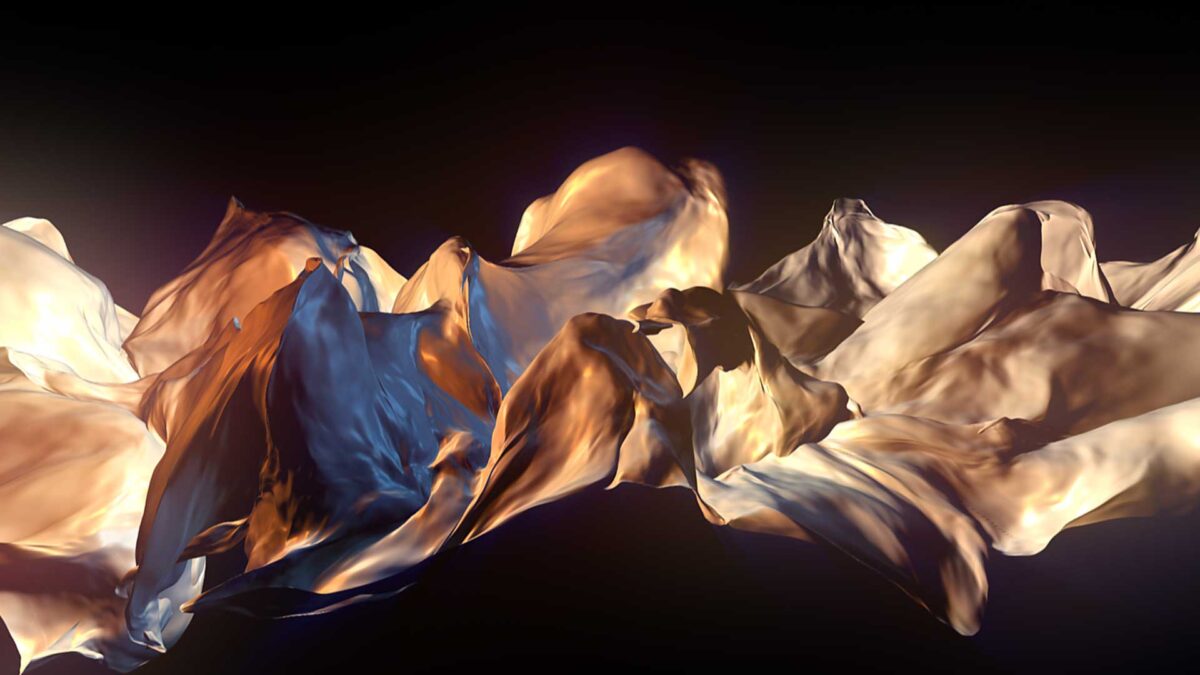Louis Brunet, docteur en philosophie, co-auteur de Philosophie de l’éducation (PUL, 2000), et auteur de Le texte argumentatif en philosophie. Théorie et pratique (2011), a été professeur de philosophie au Cégep Ste-Foy et chargé de cours à l’Université Laval. Formé à l’école de saint Thomas d’Aquin par la dernière génération de maitres thomistes ayant poursuivi l’œuvre fondatrice de Charles De Koninck, il est, au Québec, un des trop rares héritiers de ce que les historiens appellent « le thomisme de Laval ».
Ce courant philosophique, dérivé du thomisme de Louvain, a prospéré des années 1930 aux années 1960, avant de disparaitre presque complètement chez nous. Cependant, son influence est encore sensible ailleurs, aux États-Unis et en France, où des disciples de Charles De Koninck sont allés poursuivre la quête d’intelligence et de savoir amorcée à Québec. J’ai interrogé Louis Brunet sur ses années de formation, afin qu’il nous rappelle, par-delà la déroute de la raison qui caractérise notre époque, la souveraine beauté de la tradition à laquelle il a été initié.
Le Verbe : Louis Brunet, avant d’entrer à l’université pour y faire vos études en philosophie, aviez-vous été exposé à la tradition néothomiste et à l’œuvre de saint Thomas ?
Louis Brunet : Oui, par le biais d’Yvan Pelletier, qui a été mon professeur de philosophie lors de ma première année d’études au Cégep de Sainte-Foy, en 1971-1972. Il y avait aussi d’autres collègues enseignant à ce cégep qui, comme M. Pelletier, suivaient encore les cours de Mgr Maurice Dionne.
Vos années d’études philosophiques à Laval couvrent quelle période et qu’est-ce qui vous a conduit à vous inscrire à cette université plutôt qu’à une autre ?
J’ai entamé mes études philosophiques à l’Université Laval en 1973 et j’ai poursuivi jusqu’au doctorat, que j’ai obtenu en 1981. Le choix de cette université allait de soi pour moi, en raison des éminents professeurs rattachés à la tradition thomiste qui s’y trouvaient. J’avais déjà la conviction que c’était la meilleure formation en philosophie qu’on pouvait recevoir.
De quels mémorables professeurs avez-vous suivi les cours ? Sur quels ouvrages ou à quels grands commentateurs modernes d’Aristote et de saint Thomas recouraient-ils pour vous faire entrer dans l’intelligence des classiques ?
Je dirais que les professeurs qui m’ont le plus marqué sont Mgr Dionne, l’abbé Jasmin Boulay, Warren Murray, Alphonse Saint-Jacques et Yvan Pelletier. J’ai aussi bénéficié du cours de Thomas De Koninck sur les présocratiques. Mgr Dionne enseignait la logique ; il utilisait beaucoup des textes de saint Thomas glanés ici et là dans son œuvre, ainsi que des commentaires de saint Albert aux traités logiques d’Aristote. L’abbé Boulay enseignait la philosophie de l’art ; ce boulimique de lecture utilisait une grande variété de sources. Il se servait d’Aristote, entre autres concernant la notion de catharsis ou celle d’imitation dans la Poétique, mais il aimait poser les problèmes à partir d’opinions modernes, ce qui l’amenait à présenter, par exemple, des extraits de la Lettre à d’Alembert ou de l’Émile de Jean-Jacques Rousseau, ou encore des Conversations de Goethe avec Eckermann. Warren Murray enseignait la philosophie de la nature et la philosophie des sciences. En philosophie de la nature, on apprenait certaines notions de base tirées des Physiques d’Aristote ; en philosophie des sciences, le professeur Murray utilisait La nature et la portée de la méthode scientifique. C’est un livre qu’Émile Simard avait rédigé à partir des notes de cours de Charles De Koninck. Une section « textes choisis », à la fin de chaque chapitre, donnait un accès direct à la pensée de grands scientifiques tels Eddington, Einstein, Planck ou Heisenberg. Alphonse Saint-Jacques enseignait l’histoire de la philosophie moderne. Il avait à cœur de faire de l’histoire de la philosophie pour les bonnes raisons : pas pour remplir sa besace d’opinions, comme il disait, mais en vue de mieux juger de la vérité. À tel point que dans son cours sur Descartes, à peu près seulement la dernière semaine a été consacrée à Descartes, parce qu’il a jugé qu’il fallait d’abord réfléchir sur le comment et le pourquoi de l’étude de l’histoire de la philosophie, ce qui a occupé plus d’une dizaine de semaines ! Yvan Pelletier a été engagé un peu plus tard (en 1975), de sorte que c’est surtout comme étudiant gradué que j’ai profité de ses enseignements en logique ou en éthique. Il a été mon directeur de thèse.
Quels souvenirs gardez-vous de cette époque, de l’atmosphère qui régnait dans les classes, des échanges que vous aviez avec vos maitres et les autres étudiants ? Évoluiez-vous dans un climat où régnait la camaraderie et la joie de la découverte ? Par ailleurs, la vie facultaire était-elle soumise à des tensions entre écoles rivales, comme à l’époque de saint Thomas ?
À l’époque, j’étais plus sensible à la qualité des contenus des cours qu’à l’atmosphère des classes. Mes meilleurs souvenirs, côté atmosphère et échanges, concernent les rencontres en dehors des salles de classe : pour son cours de philosophie moderne, pour lequel nous étions cinq ou six étudiants, Alphonse Saint-Jacques nous invitait chez lui, on recevait le cours dans son salon et c’était suivi d’un gouter qu’il nous offrait. Warren Murray organisait chez lui, le vendredi soir, des rencontres où les étudiants gradués présentaient leurs recherches pour leur thèse. On pouvait ensuite discuter et fraterniser. Il y avait aussi la fête de saint Thomas, qui donnait chaque année l’occasion de rencontres entre étudiants et avec nos maitres. Et à la fin juin, on pouvait participer au colloque de la Société d’études aristotéliciennes, qui avait lieu parfois à Québec, parfois à Manchester, au New Hampshire. Bien sûr, cela n’intéressait pas tous les étudiants de la Faculté de philosophie et seuls les professeurs les plus attachés à la tradition aristotélico-thomiste y participaient. Mais chez ceux qui s’y intéressaient, il régnait un enthousiasme d’apprendre et une camaraderie se développait. Pour ce qui est de la vie facultaire, elle était bien sûr soumise à des tensions. Que se continue, au moins en partie, la tradition thomiste, n’était pas du gout de tout le monde. Le groupe de ceux qui suivaient assidument, année après année, les cours de Mgr Dionne se faisait surnommer « la chapelle », ce qui, dans l’esprit de ces détracteurs, était loin d’être un compliment.
Avant de parler de façon plus détaillée des grandes orientations qu’a prises l’enseignement de la philosophie à l’Université Laval sous l’impulsion de Charles De Koninck et de ses disciples, j’aimerais m’attarder sur le fait que vous avez eu des liens plus étroits avec quelques-uns de vos maitres. Avez-vous tiré de ces relations privilégiées de maitre à disciple et de disciple à maitre quelque leçon de vie marquante ? Ce que je cherche ici à savoir, c’est si, en plus de vous apprendre à penser, vos maitres vous ont aussi, de quelque manière, appris à vivre, et si l’amitié a joué un rôle dans l’apprentissage de la sagesse.
C’est sûr qu’on choisit d’abord ses maitres parce qu’on cherche des personnes qui vont nous apprendre à penser. Mais c’est vrai qu’ils m’ont aussi appris à vivre, surtout en ceci qu’ils ont été pour moi l’occasion d’une conversion. Je m’étais éloigné de l’Église au début de mon adolescence, mais je me suis retrouvé obligé de constater que les professeurs les plus articulés et intéressants parmi ceux qui m’enseignaient étaient tous croyants. Sans parler de saint Thomas lui-même, que j’avais commencé à lire et dont la sagesse en philosophie m’impressionnait. Cela m’a amené à me questionner, à me poser la question de Dieu. De sorte que lorsqu’un confrère étudiant m’a invité à une retraite, je me suis dit que ce serait une occasion de réfléchir. Les Exercices de saint Ignace ont été un choc culturel, mais j’ai finalement eu une grâce de liberté appuyée sur mon désir de vérité, qui m’a fait passer à la foi. J’ai aussi entretenu des liens d’amitié avec Warren Murray et Yvan Pelletier. Je dois dire que leur exemple m’a aidé et inspiré dans l’apprentissage de la sagesse, pas seulement par ce qu’ils m’ont appris en philosophie, mais aussi par leurs attitudes, telles l’ardeur à l’étude, l’honnêteté intellectuelle et la générosité dans le partage des connaissances.
Parlons maintenant de la formation intellectuelle reçue à Laval, à l’époque où vous y étiez étudiant. À quelle grande option philosophique peut se résumer « l’esprit de Laval », en matière de pratique de la philosophie en contexte universitaire ?
L’esprit de Laval, c’était l’option pour une philosophie réaliste. On y était conscient de la difficulté de la philosophie, qui exigeait de ne pas faire table rase du passé. On voyait la nécessité de profiter de ce qui était encore valable dans les enseignements des plus grands philosophes qui nous ont précédés, tels Aristote et saint Thomas d’Aquin. Dans l’esprit d’une tradition vivante, il s’agissait d’appliquer les principes aux réalités nouvelles et de savoir discerner, faire le tri, à la lumière des nouvelles observations et découvertes, entre ce qui demeure vrai et ce qui s’avère caduc dans les idées des Anciens.
Quelle était la finalité première de l’enseignement philosophique, dans l’optique même de vos professeurs ? D’après ce que vous avez dit à propos du cours d’Alphonse Saint-Jacques sur l’histoire de la philosophie moderne, je devine que leur but n’était pas seulement de dresser le catalogue des grands systèmes philosophiques, pour le plaisir de l’érudition.
Dans l’optique de mes professeurs, la finalité première de l’enseignement philosophique est de transmettre la connaissance de la vérité, de faire comprendre le réel. La connaissance de l’histoire de la philosophie n’était jamais considérée comme un but en soi. Chercher à connaitre les opinions des philosophes ne se justifiait que dans la mesure où cela pouvait contribuer à mieux juger de la vérité. Mes professeurs réprouvaient l’esprit de système en philosophie. Ils se disaient qu’un philosophe ne devrait pas chercher à construire un système dans lequel il chercherait à enfermer la pensée, mais que l’esprit devait rester ouvert à la complexité du réel. Ils cherchaient à libérer l’intelligence, pas à l’enfermer dans un système.
Avant d’aller plus loin dans notre exploration du thomisme de Laval, je ne peux m’empêcher de vous demander : que pensez-vous de cette manière d’enseigner qui prétend à la neutralité historienne et qui en profite pour imposer, sous prétexte d’objectivité, sa lecture rationaliste de l’histoire de la philosophie, en sautant d’autant plus volontiers par-dessus le Moyen Âge qu’elle y voit l’exemple par excellence d’une éclipse de la raison ? N’est-ce pas le meilleur moyen de fermer l’accès à une véritable compréhension de l’histoire de la pensée occidentale, qui est inséparable de la quête du premier principe ?
Si, par « neutralité historienne », on veut dire qu’il ne faut jamais conclure, même après examen attentif des arguments, que, sur tel ou tel point, tel philosophe a raison et que tel autre philosophe est tombé dans l’erreur, je pense qu’une telle neutralité est un non-sens, une perversion de la finalité même de l’enseignement philosophique. Si, par « lecture rationaliste », on veut dire que c’est seulement quand un penseur n’a pas la foi que sa raison est bien utilisée, je ne vois là qu’un préjugé. Comme si les incroyants avaient le monopole de la raison. Ou comme si, parce qu’un philosophe adhérait à la foi, il laissait alors automatiquement sa raison au vestiaire. Sauter par-dessus le Moyen Âge, c’est ce qui a caractérisé la façon dont les humanistes de la Renaissance ont voulu faire retour à l’Antiquité. Dans leur recherche d’émancipation par rapport à l’autorité, ils se sont privés de grands trésors de sagesse. La pensée moderne et contemporaine n’a fait qu’accentuer ce rejet de la tradition. On a voulu s’ouvrir l’accès à une plus grande liberté et à toutes sortes de nouveautés, mais on s’est effectivement fermé l’accès à une tradition philosophique très riche. Y porter une plus grande attention aurait permis d’éviter bien des erreurs, notamment sur les grandes questions très difficiles de la métaphysique.
Au développement de quelles branches de la philosophie les maitres de Laval, à commencer par Charles De Koninck, ont-ils particulièrement contribué ?
Le domaine de prédilection de Charles De Koninck était la philosophie de la nature et la philosophie des sciences. Mais il a aussi été impliqué dans les grandes controverses de son temps, comme celle sur le personnalisme ou sur le marxisme, ce qui l’a amené à traiter de questions relevant de la philosophie politique et de la métaphysique. La publication, en cours depuis le début des années 2000, de ses Œuvres complètes, par les Presses de l’Université Laval, donne maintenant un accès plus facile à sa pensée. Mgr Maurice Dionne a surtout contribué, du moins par son enseignement oral, dans le domaine de la logique et de ce qu’on pourrait appeler la métaphysique de la logique, qui consistait en des réflexions sur la nature et la nécessité de la logique. Il n’a cependant à peu près rien laissé comme écrits. On a cependant des traces de son enseignement dans des notes de cours rédigées à partir d’enregistrements de ses cours. On peut trouver un accès à sa pensée sur le site de la Société d’études aristotélico-thomiste. Jacques de Monléon a surtout développé ses réflexions en philosophie politique. Il n’a pas laissé beaucoup d’écrits, mais des ouvrages publiés de façon posthume permettent de profiter de ses enseignements : Marx et Aristote (1984), Personne et Société (2007) et L’homme selon Marx (2018). L’abbé Jasmin Boulay s’est surtout occupé de philosophie de l’art et d’éthique, mais lui non plus n’a pas laissé beaucoup d’écrits. On peut cependant trouver son article « Quelques notes sur les vertus morales » sur le site d’Érudit, en choisissant la revue Laval théologique et philosophique.
Pouvez-vous énumérer quelques-uns des grands problèmes qui ont occupé et captivé les thomistes de Laval, depuis l’époque fondatrice jusqu’à celle de vos études ?
Le débat le plus célèbre a été, dans les années quarante, celui sur le personnalisme, qui a opposé Charles De Koninck à Jacques Maritain, qui était un thomiste très influent à cette époque. Le grand problème discuté alors concernait le bien commun et sa primauté. Dans le domaine de la philosophie de la nature, il faut mentionner le problème de l’indéterminisme et celui de l’évolution. De Koninck s’est opposé aux partisans d’un déterminisme dans la nature, qui en exagéraient la nécessité et en éliminaient la contingence. Il s’est aussi opposé aux thomistes qui, par une application qu’il jugeait mal avisée de principes puisés dans saint Thomas, refusaient d’admettre l’évolution pour rendre compte de l’apparition des espèces vivantes. Mais le professeur De Koninck s’attaquait tout autant à l’idée que toute cette évolution des vivants puisse s’expliquer uniquement par le hasard, dans un monde sans finalité et sans Dieu. Un autre grand problème qui a occupé Charles De Koninck, c’est celui du rapport entre les sciences expérimentales et la philosophie de la nature. Tout en reconnaissant des différences de méthode, il a soutenu qu’il y avait une unité dans le savoir sur la nature, de sorte qu’il situait les sciences expérimentales dans le prolongement de la philosophie de la nature.
En matière de pédagogie, qu’est-ce qui caractérisait l’enseignement dispensé par vos maitres ?
Ils encourageaient à pratiquer la philosophie à partir de l’étonnement, en gardant un esprit d’enfance qui permet de s’émerveiller devant le réel et de chercher à fuir son ignorance. Mes maitres préconisaient une manière de faire des recherches et d’enseigner respectueuse du mode naturel de connaitre, qui consiste à toujours procéder du connu à l’inconnu, du sensible à l’intelligible, du commun au propre, du confus au distinct. Dans l’enseignement, ils insistaient sur l’importance de la manuductio, ce qui voulait dire : conduire l’intelligence comme par la main, en commençant par le plus facile, avec toujours le souci de proportionner l’enseignement aux capacités des auditeurs. Ces professeurs jugeaient important de mettre leurs étudiants en contact direct avec les textes des grands maitres de la pensée. Jamais ils n’auraient utilisé de manuels qui exposaient dogmatiquement des réponses avant même qu’on ait pu comprendre les problèmes et les questions.
Vous avez commencé vos études de philosophie à une époque où la place du thomisme dans l’enseignement universitaire et dans l’Église avait déjà, à tort ou à raison, été remise en question et où il connaissait une perte d’influence considérable, en comparaison de l’importance qu’il avait eue auparavant, au Québec et dans tout l’Occident, durant les deux premiers tiers du XXe siècle. Comment avez-vous, vous et vos professeurs, vécu et interprété ce recul ? Les étudiants et les professeurs thomistes qui évoluaient autour de vous avaient-ils confiance, malgré tout, en la capacité du thomisme à faire face aux défis de la modernité séculariste ?
Ce recul était une source de déception. On avait le sentiment qu’un héritage d’une grande richesse était en train d’être dilapidé. Le doute ou le manque de confiance ne portait pas sur les capacités du thomisme à fournir des principes appropriés pour faire face aux défis de notre temps, mais sur la capacité d’accueil de cette philosophie de la part de gens qui, en rejetant le passé catholique du Québec, refusaient du même coup tout ce qui s’y associait de près ou de loin.
La grande époque de l’enseignement du thomisme se termine quand, environ, à l’Université Laval ? Le changement s’est-il fait brusquement ou a-t-on simplement assisté à un lent épuisement ? Quelles sont, selon vous, les principales causes de cette évolution, tant du point de vue de l’enseignement de la philosophie que de la mutation plus générale des mentalités ?
Dans une introduction qu’il a écrite pour l’édition américaine des œuvres de Charles De Koninck, le professeur Leslie Armour, qui enseignait à Ottawa mais collaborait au Laval théologique et philosophique, écrit que la réaction contre le thomisme a commencé à prendre de l’ampleur moins d’un an après la mort de De Koninck, en 1965. Il fait aussi référence à la levée des défenses officielles qui empêchaient les universités catholiques de s’écarter de l’enseignement de saint Thomas. Cela aurait permis aux forces qui cherchaient à assiéger la citadelle thomiste de Québec de se déployer rapidement. Le professeur Armour témoigne que le changement a été si rapide que le thomisme de Québec a été balayé de la vue avant que quiconque ait eu la chance de faire une évaluation de sa condition et de ses réalisations. La façon dont la Faculté de philosophie raconte sur son site Internet sa propre histoire confirme le côté expéditif du changement d’orientation survenu :
« Au moment de la création de la Faculté, l’Université Laval était une université catholique. Ayant un statut canonique, la Faculté et l’enseignement qui y était dispensé se rattachaient essentiellement au courant aristotélico-thomiste. À cette époque, la Faculté accueillait, outre un grand nombre d’étudiants canadiens de diverses provenances, plusieurs étudiants américains attirés par ce courant de pensée. Avec les profondes transformations de la société québécoise dans les années 1960 et 1970, après la formation du réseau des cégeps et l’abolition du statut canonique de la Faculté, l’enseignement fait une place de plus en plus large à la philosophie moderne et contemporaine, surtout continentale. Les programmes de la Faculté se caractérisent alors par une double orientation, aristotélicienne et pluraliste. À la fin des années 1980, seule l’orientation pluraliste est conservée. »
Quand j’y ai fait mes études, dans les années 1970, il était encore possible de se former dans la tradition thomiste, mais il fallait vraiment le choisir. Avec les cours de tel ou tel professeur, on apprenait à philosopher dans l’esprit d’Aristote et de saint Thomas. Avec d’autres, c’était plus mitigé. Et avec d’autres encore, on était carrément ailleurs, dans un pluralisme en accord avec l’air du temps. L’engagement d’Yvan Pelletier en 1975 n’a été possible que de justesse, en raison de circonstances (liées à l’élection de Thomas De Koninck comme doyen) qui n’ont pu se reproduire par la suite. Ce fut comme l’exception qui confirme la règle. Cette embauche improbable a permis de prolonger un peu une tradition qui perdait de plus en plus de terrain. Par la suite, le recrutement des professeurs selon la nouvelle optique pluraliste (mais selon un pluriel qui exclut d’emblée toute allégeance aristotélicienne ou thomiste) et les prises de retraite des professeurs encore attachés à la tradition conduiront à la disparition quasi totale de ce qui a fait la grandeur de cette Faculté.
Depuis le départ à la retraite des derniers disciples de Charles De Koninck, l’enseignement de la philosophie à l’Université Laval se poursuit, mais dans un esprit et en fonction d’objectifs qui n’ont rien à voir avec la quête de vérité telle qu’elle fut comprise et vécue par ceux qui s’étaient mis à l’école du Philosophe et de l’Aquinate. Il existe toutefois, vous y avez fait référence plus tôt, une Société d’études aristotélico-thomiste qui poursuit la tradition. Pouvez-vous nous dire un mot sur cette association, sur ses origines et ses activités actuelles ?
Cette association a été fondée en 1974 par Warren Murray, dans le but de promouvoir l’amitié dans la poursuite de la sagesse dans la tradition aristotélico-thomiste. Chaque année, vers la fin aout, elle organise un colloque. Le but de cette Société est de mener des études philosophiques en conformité avec la méthode et les principes de la tradition aristotélicienne et thomiste. Au fond, on cherche à y faire de la philosophie comme on devrait en faire et comme on en faisait avant que cette étude ne devienne qu’un exercice d’érudition. En un certain sens, on peut dire que cette association est pluraliste. Mais pas selon un pluriel justifié par l’idée que tous les opinions et systèmes philosophiques se valent. L’ouverture au pluriel signifie plutôt un encouragement à l’examen de tous les philosophes et de toutes les opinions susceptibles de contribuer à l’intelligence de la réalité. On y entend contribuer à la formation dans la tradition à tous les niveaux, incluant une formation continue pour professeurs. On compte aussi y faire de la recherche visant à une meilleure intelligence des vérités de la tradition et à leur application aux problèmes d’aujourd’hui. La Société publie de façon électronique une revue intitulée Peripatetikos.
Le site Internet de cette société présente un intérêt certain. Quelles ressources y retrouve-t-on ?
Le site comprend un volet public qui donne accès à une sélection de textes philosophiques et une section réservée aux membres qui offre encore davantage de contenu. Les articles du plus récent numéro de la revue Peripatetikos sont disponibles dans le volet public. En devenant membre, on peut avoir accès à tous les numéros publiés les années précédentes.
Vous m’avez dit, ailleurs, qu’on vous avait sollicité pour la rédaction d’un texte sur Charles De Koninck, contribution à paraître en 2025, dans un ouvrage collectif. Êtes-vous autorisé à nous dire quelques mots sur la tâche qui vous a été assignée et sur la raison de cette publication ?
La Revue thomiste prépare pour 2025 un volume sur le thomisme francophone au XXe siècle. Il s’inscrit dans une série de colloques et de publications pour le centenaire de la canonisation et de la naissance de saint Thomas d’Aquin en 2023-2025. Ma tâche consiste à rédiger les pages du volume sur le thomisme qui seront consacrées à Charles De Koninck et à Jacques de Monléon.
En terminant, auriez-vous quelques suggestions de lecture pour ceux qui aimeraient s’initier à la philosophie en général et à Aristote et saint Thomas en particulier ?
Pour ceux qui aimeraient s’initier à la philosophie en général, je suggèrerais des ouvrages écrits par des philosophes qui ont une écriture les rendant très accessibles, qui vulgarisent bien tout en conservant une certaine profondeur. Je pense au livre du québécois Laurent-Michel Vacher, Débats philosophiques, une initiation, à celui de l’américain Thomas Nagel, Qu’est-ce que tout cela veut dire ? Une très brève introduction à la philosophie, ou à celui du français Charles Pépin, Une semaine de philosophie. Il y a aussi l’espagnol Fernando Savater, avec son Éthique à l’usage de mon fils. Je n’endosserais pas le détail de toutes leurs opinions, mais ce sont des ouvrages qui stimulent la réflexion et que des débutants en philosophie peuvent lire sans trop de difficulté. Pour s’initier à Aristote, on peut lire La voie de la sagesse selon Aristote, du québécois Georges Frappier. Ou encore Le gout du bonheur, au fondement de la morale avec Aristote, de Jean Vanier. On peut aussi consulter le site d’Annick Stevens, Philosophies de l’Antiquité : Aristote. Pour s’initier à saint Thomas, on peut trouver des ressources sur le Grand Portail saint Thomas d’Aquin. Je suggère aussi de lire le livre de Leo J. Elders, Au cœur de la philosophie de saint Thomas.
Louis Brunet, merci d’avoir si généreusement répondu aux questions du Verbe.