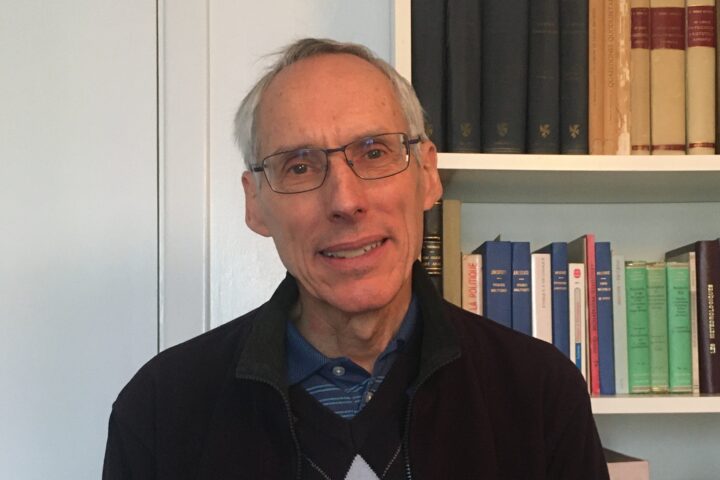Pour plusieurs, déconfinement rime avec réouverture des librairies et découverte des nouveaux livres publiés qui, pour cause de pandémie, n’ont pu recevoir toute l’attention méritée. Espérons-le, cette attente aura pour effet de stimuler l’ardeur et l’appétit des lecteurs. C’est dans ce contexte que sort ces jours-ci le livre « L’autre moitié de la modernité : conversations avec Joseph Yvon Thériault », qui aborde de manière sociologique le Québec d’aujourd’hui.
On trouve dans ces pages une bonne introduction à la pensée du sociologue acadien qui, tout au long de sa carrière, a cherché à comprendre notre époque aussi complexe que paradoxale. Sous la forme d’entretiens questions-réponses, on assiste non seulement aux différentes étapes de l’évolution de sa pensée, mais également aux enjeux récurrents qui ont parsemé sa vie intellectuelle. Identité, démocratie, questions de sens, état, société civile, petites et grandes nations, idéologies et épistémologie ne sont que quelques exemples des différents thèmes abordés dans cet ouvrage.
On en retire le portrait d’un homme soucieux de trouver l’équilibre nécessaire entre les différentes « tensions génératrices » (p.193) qui animent notre monde moderne. Deux d’entre elles ont particulièrement attiré mon attention.
Joseph Yvon Thériault n’est pas un utopiste (p.107) et il a horreur des « abstractions » (p.264) qui créent l’illusion de compréhension alors qu’elles nous en éloignent. Il n’en demeure pas moins « engagé » (p.275) et fidèle au fondement éthique de sa discipline, à « cette préoccupation de sauver le monde » (p.273).
L’équilibre par l’enracinement
À travers les pages, on ressent un besoin constant de combattre ce que Martin E. Meunier nomme « l’anomie de la société québécoise postrévolutionnaire tranquille » (p. XX). Crise des accommodements raisonnables (p.115), chartisme et multiculturalisme exacerbés (p.131), judiciarisation du politique (p. 29), désorganisation sociale (p. 60), surétatisation (p.69) ne sont que quelques exemples de problèmes devant lesquels il a su admirablement allier « compréhension » et « explication » (p.110). Il semble, en ce sens, avoir mis le doigt sur l’une de nos blessures collectives qui touche les rapports des Québécois avec l’Église. Mémoire douloureuse qui, encore aujourd’hui, continue de produire des fruits empoisonnés pour notre avenir.
Dans une époque gangrénée par le réductionnisme idéologique, la place de ce sociologue dans les débats publics ne peut être que salutaire.
Depuis la Révolution tranquille, le Québécois moyen semble entretenir un rapport conflictuel avec son passé. Contre cette « surenchère moderniste mue par une conception radicale de la modernité, qui se traduit notamment par une tendance à la désaffiliation, au déracinement, etc. (p. 162-163) », notre sociologue affirme sans gêne que « l’humanité se construit par un enracinement » (p. 256).
À l’instar du pape François qui affirme que « [si] les jeunes s’enracinent dans ces rêves des anciens, ils arrivent à voir l’avenir, ils peuvent avoir des visions qui leur ouvrent l’horizon et leur montrent de nouveaux chemins » (no193), le professeur de l’UQAM souligne la « nostalgie créatrice » (p.34) implicite à l’« intention de vivre ensemble, d’un désir de continuité qui sort de l’histoire même de cette nation » (p.105).
Ainsi, ce n’est que bien ancrés dans cette vision positive de la tradition (p. 108), dans cette « tradition vivante » (p.155) qui s’exprime, qu’on le veuille ou non, à chaque étape de notre histoire, que nous pourrons mieux faire face aux défis qui nous touchent présentement.
L’équilibre par le dépassement
Mettre aux poubelles de l’histoire notre héritage culturel et religieux par soumission aux dictats des tenants du mythe de « l’auto-fondation » (p.158) n’est évidemment pas une option pour qui cherche à trouver des solutions aux problèmes actuels. Dans ses analyses, on comprend l’importance pour Thériault de surmonter cette vision manichéenne des idéaux modernes qui cherche à exclure tout ce qui n’est pas soumis aux exhortations de ce que j’appellerais le « néo-individualisme[1] ».
Joseph Yvon Thériault nous invite donc à reconsidérer « l’autre moitié de la modernité » en redécouvrant la complémentarité réciproque entre l’individu et la collectivité. Pendant que notre société moderne cherche à mettre l’accent sur une abstraction de l’individu et de ses droits, parfois même au détriment de la société réelle et incarnée, l’analyse du sociologue cherche plutôt à remettre ses lettres de noblesse à une approche plus « romantique » (p. 110).
Comme les romantiques du XVIIIe siècle qui s’opposaient aux philosophes rationalistes, son romantisme cherche à redonner une place au vécu en sociologie. Cette méthode semble, en effet, plus en mesure de considérer l’homme dans sa complexité, dans sa profondeur, au-delà du quantifiable rationalisant. Pour le dire ainsi, son romantisme est à la sociologie ce que la phénoménologie était à l’idéalisme. Dans une époque gangrénée par le réductionnisme idéologique, la place de ce sociologue dans les débats publics ne peut être que salutaire. C’est cette posture qui lui permet de voir ce qui est toujours enfoui dans l’inconscient collectif et qui ne cesse de s’exprimer aussi bruyamment que confusément.
Repérer le sens
Il me semble que nous pourrions gagner en intelligence et en efficacité si on donnait davantage de visibilité à l’approche qualitative qu’est la sienne. Sortant de la lettre morte de la quantité, nous gagnerions beaucoup à reconsidérer l’impact sociologique de la subjectivité. En remettant les questions de sens au cœur des débats.
Par exemple, on le dit souvent : il est fort probable que nous ayons « jeté le bébé avec l’eau du bain » lors de la Révolution tranquille, signifiant par-là qu’en rejetant tout de l’époque précédant 1960, nous avons perdu le trésor qui nous avait été légué. Or, se pourrait-il que nous n’ayons peut-être pas si bien fait le ménage que ça ? S’il est vrai qu’« on ne s’est pas débarrassés complètement de notre tradition religieuse catholique lors de la Révolution tranquille » (p.168), se peut-il que nous ayons également perpétué de ces processus soi-disant « catholiques » et qui sont plus que jamais désuets ?
Beaucoup de nos problèmes actuels, « magistère des juges » (p.29), moralisation du politique (p.175), etc., semblent pointer vers cette conclusion. L’utopie progressiste aurait-elle donc été le masque idéologique cachant une certaine perpétuation des mécanismes sociaux identifiés comme propres à la « Grande Noirceur » ? Aussi paradoxalement que cela puisse paraitre, les catholiques, connaissant bien la foi qui les anime, sont les plus aptes à repérer les avatars actuels des excès « religieux » du passé. Ce sont les questions qui ont surgi dans mon esprit à la lecture de cet ouvrage.
L’ouverture de la démarche de Thériault peut donc nous aider à construire une nouvelle vision apte à reconnaitre nos mécanismes sociaux inconscients et à méditer sur ce type de questions aussi subtiles qu’urgentes.
Pour donner de la substance aux débats
Nous l’avons vu encore récemment, nos débats sociaux font ressortir les hauts faits et les blessures du passé. Comprendre la portée sociale, économique et politique de la culture (ou de l’inculture) historique semble plus urgent que jamais. C’est dans cette optique que j’encourage la lecture de « L’autre moitié de la modernité : Conversations avec Joseph Yvon Thériault ». Tant de par sa saisie des enjeux présents que par sa sensibilité pour le « poids de l’histoire » et sa lucidité imperméable aux œillères idéologiques, ces conversations auront tout pour alimenter vos réflexions et vos conversations sur le présent et l’avenir de nos sociétés.
[1] Par cette expression, j’exprime la différence entre l’individualisme classique des Lumières (équilibre entre l’individu et le collectif) par rapport à sa déviance actuelle « néoindividualiste » qui cherche à mettre l’individu au-dessus de la collectivité.