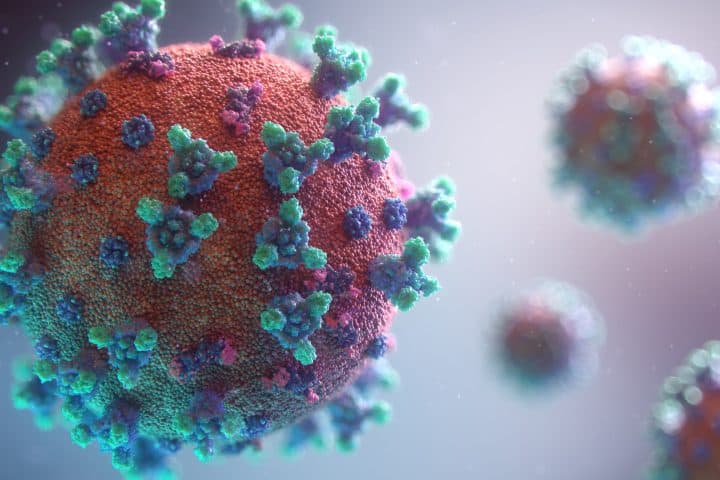Un texte de Claude Simard
La mort est consubstantielle à la vie, elle en est le terme incontournable. Dès qu’un être vient au monde, il est inexorablement voué à mourir un jour. Toute vie est mortelle. Dans la roue de l’existence, un vivant sera un mort, et un mort aura été un vivant. Telle est la loi implacable de la Nature.
Qu’elle soit naturelle ou accidentelle, douce ou atroce, lente ou rapide, la mort provoque des sentiments de crainte et de répulsion chez la plupart des êtres humains. C’est l’épreuve suprême dont le caractère tragique entraine le vain désir de la reporter sans cesse.
Comme notre instinct de conservation nous pousse à préserver notre santé et notre vie, l’idée de notre propre mort est un impensable. Nous imaginer ne plus être, nous figurer notre dissolution, est en effet très difficile à supporter.
Vers un déni de la mort
En raison des bouleversements culturels et technologiques qui les ont transformées au cours de la seconde moitié du XXesiècle, les sociétés occidentales contemporaines privilégient une approche de la mort fort différente de celle qui caractérise les sociétés traditionnelles.
La science et l’amélioration des mesures d’hygiène ont permis de mieux combattre les maladies et d’augmenter l’espérance de vie, si bien que la mort a été en quelque sorte repoussée dans l’imaginaire collectif ; la légalisation de l’euthanasie donne même aujourd’hui à la personne la possibilité de choisir le moment de sa propre mort si elle juge que ses conditions de vie sont devenues intolérables.
Avec la chute de la pratique religieuse, la religion a perdu son emprise sur la symbolique et la ritualité de la mort. Moins soumis aux normes sociales dans ses choix existentiels et moins soudé à son milieu familial, l’individu jouit de nos jours d’une plus grande liberté pour concevoir la mort à sa manière et pour organiser ses funérailles selon ses choix personnels.
Se profile actuellement une tendance à une forme de bricolage spirituel, à une métaphysique à la carte où diverses traditions sont amalgamées au gré des modes ou des idées de chacun.
Médicalisation, sécularisation et individualisme ont abouti en Occident à ce que certains penseurs appellent le « déni de la mort » (citons entre autres du côté anglo-saxon Ernest Becker, The Denial of Death, 1973, et du côté francophone, Louis-Vincent Thomas, Anthropologie de la mort, 1975).
Plus qu’une simple peur, ce déni représente sociologiquement un refus culturel de la mort et psychologiquement un refoulement de son propre décès.
Un négativisme réducteur
Au lieu d’assumer la mort avec sagesse en l’envisageant comme un phénomène naturel inévitable, la mentalité occidentale contemporaine semble ne retenir de la mort que les images sinistres qu’elle évoque : maladie, accident, souffrance, angoisse, agonie, dépérissement, extinction, décomposition.
Ce négativisme amène à proscrire la pensée de la mort et à chercher à dissimuler le plus possible les signes qui la rappellent.
L’aménagement du deuil est réduit au strict minimum et est laissé à ceux qui en font le commerce. Les proches ne voient plus le mort qui, dès son décès, est incinéré solitairement dans un four crématoire industriel.
Le rituel funéraire qui ne dure maintenant que quelques heures semble précipité comme si on voulait passer à autre chose le plus rapidement possible parce que le deuil dérange, parce qu’il trouble en ramenant à la conscience la réalité traumatisante de la mort que l’on tente paradoxalement de fuir.
Magnanime, la mort respecte pourtant scrupuleusement les droits universels : elle frappe tout le monde, sans égard à l’âge, au sexe, au handicap, à la race, à la religion.
Ce refus de la mort connait son expression extrême dans le transhumanisme, mouvement moderne qui rêve de refaçonner la condition humaine jusqu’à vaincre la mort à l’aide de la science et de la technologie. De religieuse qu’elle a été pendant des millénaires, la promesse de l’immortalité est maintenant proclamée scientifique.
Universelle et oubliée
Le déni de la mort de notre époque jette le soupçon sur la vieillesse parce qu’elle est vue comme la préfiguration de la mort. Magnanime, la mort respecte pourtant scrupuleusement les droits universels : elle frappe tout le monde, sans égard à l’âge, au sexe, au handicap, à la race, à la religion. Mais il est un âge plus susceptible de succomber à la mort, en l’occurrence la vieillesse en raison des affaiblissements de l’organisme qui l’accompagnent.
Et cette proximité de la vieillesse avec la mort est sans aucun doute la raison fondamentale qui explique que dans notre société les personnes âgées sont mises à l’écart et sont même victimes d’une forme de discrimination occultée, l’âgisme.
Les générations plus jeunes n’aiment guère découvrir à quoi ils ressembleront dans quelques années quand ils sont en présence de vieillards avec des altérations physiques ou mentales telles que l’ouïe défaillante, la vue trouble, le visage ridé, les cheveux blancs, la démarche hésitante ou la mémoire oublieuse.
Certains, dénués de toute bienveillance, n’hésitent pas à s’en moquer, d’autant plus facilement que la valeur sociale des ainés est dépréciée du fait qu’ayant quitté le marché du travail ils ne sont plus productifs sur le plan économique.
L’âgisme à peine caché
Le modèle d’hébergement pour les ainés qui est appliqué au Québec est symptomatique du malaise gériatrique qui y sévit depuis des décennies.
On a tendance à parquer les personnes âgées dans des résidences où elles sont condamnées à vivoter entre elles, sans guère de contact avec l’extérieur.
Pour employer une image forte, on n’hésite pas à les isoler dans des sortes de camps d’internement un peu comme s’il s’agissait de pestiférés ou d’aliénés. Enfermées dans leurs ghettos, elles n’ont plus qu’à attendre la mort, sans que le reste de la société ne s’en soucie vraiment.
On s’émeut bien sûr épisodiquement pour le sort des « bâtisseurs du pays » quand éclate un scandale de maltraitance. Mais après les beaux discours pharisiens qui alimentent les médias pendant quelques jours, on retourne au statuquo et on oublie vite la triste fin de vie de nos vieillards. Comme l’a dit dans une formule choc le Dr Réjean Hébert, gériatre et ex-ministre de la Santé et des Services sociaux (Le Soleil, 15 avril 2020), « la mort biologique s’ajoute à la mort sociale ».
La véritable source de l’âgisme
On insiste ici sur l’idée que le déni de la mort est à la source de l’âgisme. Il existe bien sûr d’autres facteurs qui concourent à cette discrimination, notamment la bureaucratisation et la marchandisation des services gériatriques, la réticence de nombreux enfants de notre époque à s’occuper de leurs vieux parents à cause de leur rythme de vie absorbant et de leur propension à l’hédonisme, la recherche chimérique d’une sécurité maximale chez bien des aînés attisée par la publicité des vendeurs de faux paradis de l’« âge d’or ».
La thèse qui est soutenue dans le présent texte est que l’exclusion des vieux dans nos sociétés contemporaines n’est pas seulement de nature socioculturelle ni organisationnelle. Elle est plus profondément d’ordre anthropologique et philosophique, car elle relève d’une conception du trio existentiel de la vie, de la vieillesse et de la mort.
La vieillesse est à présent disgraciée et congédiée parce que trop de gens cherchent illusoirement à évincer la réalité de la mort de leur conscience et, pour reprendre le titre d’une œuvre d’Unamuno, à oblitérer dans leur esprit le « sentiment tragique de la vie ».
Pour bien vivre et bien vieillir, il faut apprivoiser la mort ; comme le suggérait Montaigne, « il faut apprendre à mourir ». Toute la tradition philosophique nous l’enseigne. La mort donne un sens à la vie et lui confère toute sa valeur. Au lieu de la nier, mieux vaut l’accepter et en faire une source de compréhension de la vie en s’habituant à y penser de façon lucide et équilibrée.
Pour conclure, donnons encore la parole à Montaigne en précisant que dans la langue du XVIe siècle le mot préméditation signifie : « action de réfléchir à l’avance à quelque chose » :
Et pour commencer à lui ôter son plus grand avantage contre nous, […] ôtons-lui l’étrangeté, […] n’ayons rien si souvent en la tête que la mort. […] La préméditation de la mort est préméditation de la liberté. (Essais, I, xx)

Claude Simard est retraité de l’enseignement universitaire depuis l’automne 2011 après avoir poursuivi une carrière de professeur pendant une trentaine d’années à l’Université Laval dans le domaine de la didactique du français et de la formation des enseignants. Il a publié, en 2016, L’Islam dévoilé: le différentialisme et l’Islam imaginaire aux éditions Dialogue Nord-Sud.