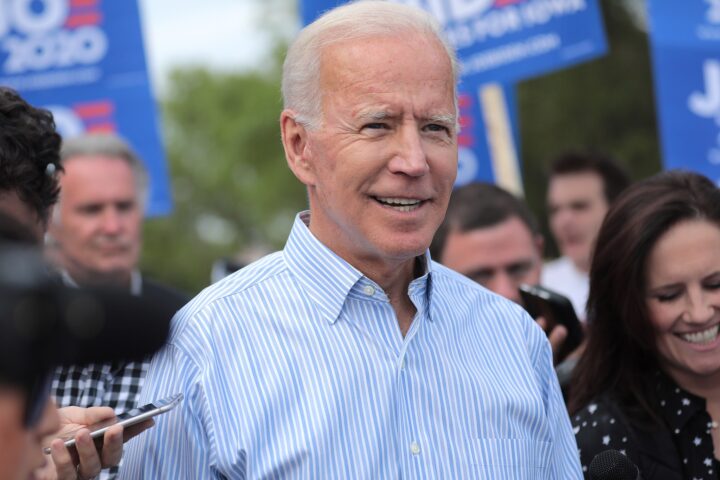Le Sang du pélican, dernier film de Denis Boivin, vient de sortir. Il est consacré à sainte Marie de l’Incarnation, mystique et amie des autochtones. La Thérèse du Nouveau Monde, disait Bossuet.
Pendant environ deux heures, on se promène entre les XVIIe et XXIe siècles, entre Marie Guyart, jouée par Karen Elkin, et la même actrice qui interroge aujourd’hui les vieilles ursulines, profondément affectées par le déménagement du vieux couvent de la Haute-Ville de Québec.
Cette histoire d’espérance sur fond de perte m’a ramené à un coup de foudre que j’avais eu en aout 2020, lors d’un séjour d’une petite semaine à Québec, libérée des touristes pour cause de pandémie. La Haute-Ville était à moi.
Lors d’une visite de la chapelle et du musée des Ursulines, j’ai été frappé par le souci que ces femmes avaient eu de former intégralement les jeunes filles au cours des siècles. Non pas des souillons d’une pauvre colonie, mais des femmes structurées et droites, appelées à participer à une grande œuvre.
L’évidence m’a brutalement giflé : nous sommes assis sur un trésor dont nous avons perdu la clé. Notre honte cache quelque chose de plus profond et de plus fécond qui nous fait peur.
Le classicisme exquis de la chapelle, qui rappelle celle des mêmes Ursulines de Trois-Rivières, m’a par ailleurs replongé dans le Grand Siècle français, aussi appelé « siècle des âmes ». Bossuet, François de Sales, Marguerite-Marie Alacoque, Vincent de Paul, Louise de Marillac ne sont pas loin.
La statue de Champlain
Je passe sous silence tous les monuments que j’ai pu voir. Mais il y a une statue qui m’a ébloui et fait comprendre la noblesse de la Nouvelle-France. Située à la rencontre de la terrasse Dufferin et de la rue Saint-Louis, elle montre le sieur Samuel de Champlain, fondateur de la ville en 1608, soit dix ans après l’Édit de Nantes.
Le personnage est droit, la cape repliée sur le bras gauche, le chapeau à panache à la main droite, justaucorps boutonné, culottes bouffantes enserrées dans des bottes, barbe à l’impériale, le regard franc et noble. La statue de 1898 est du sculpteur français Paul Chevré.
L’esthétique ici ne s’oppose pas à la dimension morale : elle en est le signe le plus éclatant. L’homme stylisé dont je fixais la droiture pendant des heures condensait à mes yeux l’essentiel de la grandeur de la Nouvelle-France. Nous l’avons oublié depuis la défaite de 1759 et notre cession à la couronne britannique en 1763.
Nous sommes des héritiers ignorants et ingrats.
Que de questions…
Comment se fait-il que les cénacles nationalistes censés chanter l’âme et les destinées de ce peuple aient placé les 150 ans de l’ancien régime dans l’angle mort de leurs discours ?
Pourquoi commence-t-on notre histoire par un avortement en 1763 ? Sont-ce les seuls fonts baptismaux que ce triste clergé sans enthousiasme (littéralement : en-dieusement) est capable d’offrir à ses ouailles ?
Pourquoi le Christ généreux et glorieux de la Nouvelle-France s’est-il depuis rabougri en un petit Jésus minable cloué/cramponné à jamais sur sa croix et aux basques de sa mère, dans la peur panique de ressusciter pour accéder à la vraie vie ?
La perte de la sainteté
Nos échecs subséquents ne sont-ils que la répétition névrotique de la première défaite, jamais assumée dans toute sa perte, jamais dissoute et jamais résolue ? Avons-nous peur de notre noblesse et préférons-nous enfouir ce talent sous terre pour ne pas en perdre le peu qui reste ?
« Rien ne nous rend si grand qu’une grande douleur », chantait Alfred de Musset. Le mot essentiel ici n’est pas « douleur » mais « grand ». C’est un mot tabou au Québec. On lui préfère « grandiloquence » et son inverse « misérabilisme ».
Notre nationalisme local oscille entre les deux et la tiède ambigüité qui en résulte est, à ses yeux, somme toute préférable à la grande douleur. Car, malgré nos impressionnantes réalisations, le Christ n’est plus ressuscité depuis. L’expression de notre foi s’en ressent : elle est pauvre et fadasse.
S’il y a bien un enseignement de cette Nouvelle-France dont nous ne balbutions plus que le pâle écho, c’est bien le sens de l’immensité, de l’amitié, du style, du don et du martyre.
À cet égard, j’avais entendu une historienne s’exclamer que « cette terre est parsemée de sainteté ». J’ai d’abord eu honte de cette femme qui glorifiait ces petits saints doucereux et moches. Sa phrase m’est pourtant revenue à la contemplation de la vie de sainte Marie de l’Incarnation et de la statue de Samuel de Champlain. L’évidence m’a brutalement giflé : nous sommes assis sur un trésor dont nous avons perdu la clé. Notre honte cache quelque chose de plus profond et de plus fécond qui nous fait peur.
Mais pour retrouver ce qui est éminemment digne d’être aimé, chanté, assumé profondément, il faut d’abord passer par la grande douleur de la Passion…
Sagesse du Carmel
« Pour venir à ce que vous ne goutez, allez par où vous ne goutez. Pour venir à ce que vous ne savez, allez par où vous ne savez. Pour arriver à ce que vous ne possédez, allez par où vous n’avez rien. »
Ces paroles sont de saint Jean de la Croix, dans La montée du Carmel. Elles pourraient tout aussi bien être celles de Sophocle ou de Freud. Elles sont assurément celles de Gaston Miron, notre poète devenu tragique à force de tâtonnements.
L’idée fondamentale est que la perte ne se répare que par son acceptation, prélude aux retrouvailles, au vin nouveau, aux noces célestes. Car ce que l’on a aimé et perdu, on peut le retrouver, mais à un autre niveau. Cela demande une trempe et un caractère qui ne se résolvent que dans l’humilité du don total de soi.
Jésus-Christ en est l’exemple même.
Après une hésitation tout humaine à Gethsémani, il a finalement accepté de se donner entièrement sur la croix. Mais nous, Québécois, sommes-nous capables de pleurer amèrement l’engloutissement de la Nouvelle-France, dans l’espérance que les eaux vives de la tristesse ravivent une grandeur à un autre niveau ?
Le vrai socle nourricier
Sommes-nous à la mesure de cette « grande querelle » avec nous-mêmes ou bien ne préférons-nous pas, en fin de compte, tricher en remplaçant l’objet adoré perdu par un colifichet qui lui ressemble sans en avoir la force ni la transcendance ?
Fidèles à notre rouerie et finasserie paysanne, préférant le vin et le triple crème, ne troquons-nous pas ce deuil profond pour une lancinante jérémiade qui nous apporte malgré tout un mol confort que l’on maquille aussitôt des atours d’une fierté nationale boursoufflée ?
Nos chapelles nationalistes, tièdement ardentes, font commodément l’impasse sur ces questions. Farouches gardiennes du dogme national, repliées sur elles-mêmes et orphelines de cette Nouvelle-France authentiquement d’ici, elles se cherchent des miettes de légitimité auprès d’une France républicaine.
Nous n’avons certes pas à trahir notre modernité durement acquise, mais notre vrai socle nourricier, pourtant, est plus ancien : il est royal, avec tout ce que le qualificatif comporte de noblesse, d’allégeance, de loyauté, de panache, de peines et de service. Là est notre vérité.
Pour y accéder, pour traverser la perte et ressusciter l’écho des martyrs canadiens, c’est bien moins d’intellectuels que nous avons besoin que de prophètes. Ceux-ci devront respirer de leurs deux poumons fondamentaux : français et autochtone.
Comme sainte Marie de l’Incarnation.