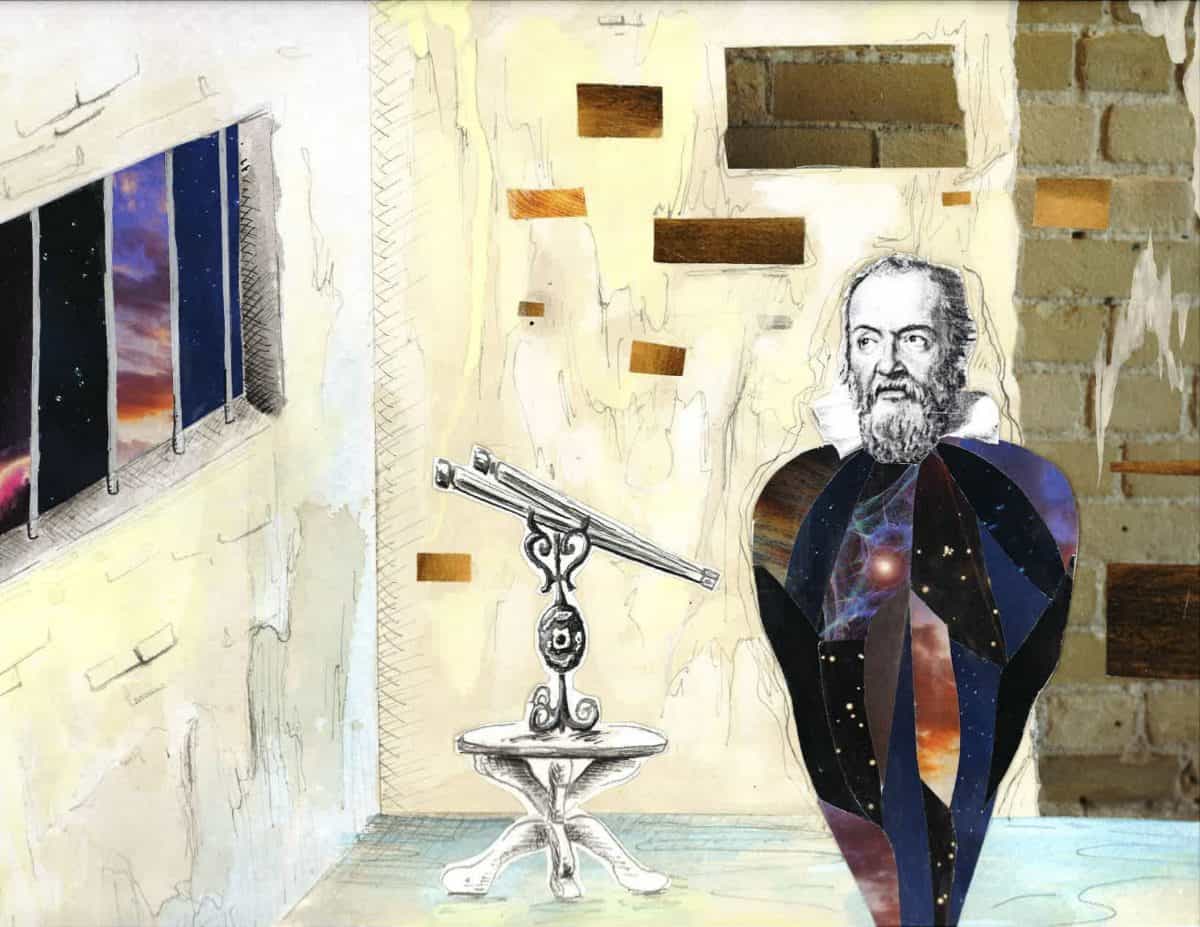Il y a cent trente ans aujourd’hui naissait Georges Bernanos (1888-1948). Le cinq juillet prochain, nous soulignerons le soixante-dixième anniversaire de son entrée dans «la Maison du Père». Ce sont là deux excellentes raisons d’examiner, pour la simple joie de l’intelligence et du regard, quelques-unes des scènes de son enfance, de son adolescence et de sa jeunesse, puis du début de sa vie adulte.
Cela nous permettra de nous rappeler au confluent de quelles influences intellectuelles, morales et spirituelles a grandi celui qui trouva très tôt dans le catholicisme, non seulement le sens de la vie, mais «la vie même». Voici donc le premier d’une série d’articles, ou plutôt de tableaux, quelque peu impressionnistes, consacrés aux jeunes années de l’écrivain.
*
Louis, Émile, Clément, Georges Bernanos naît le 20 février 1888, à Paris, au 26 de la rue Joubert, à deux pas de l’église Saint-Louis d’Antin (IXe arrondissement), où il sera porté sur les fonts baptismaux cinq jours plus tard.
Pour l’anecdote, signalons que c’est à la même église que Marcel Proust a été baptisé, le 5 août 1871. Ajoutons aussi que, depuis 1994, les locaux de l’église abritent un centre culturel catholique très animé: l’Espace Bernanos.
Après une soeur aînée, Marie-Thérèse-Marthe, morte en 1883 alors qu’elle n’avait pas trois ans; après sa deuxième soeur Marie-Thérèse, née moins de cinq ans avant lui, Georges est le troisième et dernier enfant de Jean-François Bernanos (1854-1927), dit Émile, et de Marie-Clémence Moreau (1855-1930), qu’on appelle communément Hermance.
Émile est d’ascendance lorraine et exerce, avec un sens aiguisé de l’esthétique et des affaires, le métier de tapissier-décorateur à Paris, sa ville natale. Il est le fils d’un cordonnier qui, vers le mitan du siècle, quitta le pays lorrain de ses ancêtres pour venir s’établir dans la capitale. L’exode rural ne profita guère à l’artisan, puisqu’il dut se contenter d’un travail de manoeuvre. Il mourut en 1872.
Marie-Clémence, née à Pellevoisin, dans l’Indre, est issue d’une famille paysanne. Elle est, comme la décrivit son fils en parlant de la génération à laquelle elle appartenait, une de ces «trop bonnes mères, trop patientes, si dures à la besogne, si dures et si douces, avec leurs tendres coeurs vaillants, inflexibles». Le 9 octobre 1879, elle épouse Émile Bernanos.
Du côté des Bernanos, la tradition familiale a toujours entretenu la mémoire de très lointains ancêtres espagnols, dont la lignée aurait pris souche en Lorraine. Parmi les descendants français de cette immigration provenant d’Ibérie, il y aurait eu un militaire, tué au combat, par les Anglais, dans les Caraïbes, à Saint-Domingue (actuel Haïti), pendant la guerre de la Ligue d’Augsbourg (1688-1697).
Car son profil était en accord parfait avec son idéal d’héroïsme aventureux et d’engagement désintéressé au service du pays, un idéal enraciné dans les plus fervents rêves de son enfance et appelé à irriguer plus tard toute son oeuvre.
Jusqu’à la fin de sa vie, l’écrivain, soucieux de mieux connaître ses origines incertaines, cultiva le souvenir de cet officier de légende sorti tout droit d’une pièce d’Edmond Rostand; car le profil de ce guerrier était en accord parfait avec son idéal d’héroïsme aventureux et d’engagement désintéressé au service du pays, un idéal enraciné dans les plus fervents rêves de son enfance et appelé à irriguer plus tard toute son oeuvre.
Des recherches entreprises du vivant du romancier, à la demande de celui-ci, n’ont abouti qu’après sa mort. Elles ont confirmé l’existence de cet ancien corsaire devenu capitaine de cavalerie, puis major de Port-de-Paix. L’homme, plein de hardiesse, est mort héroïquement, «percé de trois lances», lors d’une embuscade tendue par l’ennemi anglais. Il avait nom Jean Bernanos. C’était le frère de l’ancêtre direct du romancier.
Le jésuite Pierre-François-Xavier de Charlevoix (1682-1761), connu chez nous pour son Histoire et description générale de la Nouvelle France (1744), parle de cet ancêtre en termes fort élogieux dans son Histoire de L’Isle Espagnole Ou de S. Domingue (1730): «C’était le plus brave homme qui fût alors dans la colonie et il eût seul conservé au Roi le Cap et le Port-de-Paix s’il y eût commandé en chef» (1).
Dans l’amitié des saints
Est-ce chose étonnante? La vie de Georges Bernanos commence par ce qui pourrait bien être un miracle – un miracle attribuable à l’Immaculée, Notre-Dame-de-Lourdes. Un tout petit miracle en vérité, un miracle proprement anodin, qui se laisse facilement confondre avec le hasard ou la coïncidence, de peur de s’imposer. Un humble miracle, pourrait-on dire, qui ne veut surtout pas déranger les incroyants. Ni les croyants d’ailleurs.
Ce fut (sous réserve d’être corrigé au Ciel par son auteur) un de ces milliers de prodiges ordinaires, dont on n’entend presque jamais parler, sinon dans l’intimité des cercles familiaux, et que Dieu jette sur la terre avec une telle munificence qu’on ne s’étonne plus, que plus personne ne fait attention, qu’on n’écarquille plus les yeux. Laissons ici Jean-Loup Bernanos, dernier des fils de l’écrivain, nous le relater:
«Ma grand-mère [Hermance Moreau] a raconté qu’à l’âge de dix-huit mois le petit Georges fut atteint d’une infection si grave que le médecin prévoyant une issue fatale cessa tout traitement. Déjà cruellement éprouvés par la mort de leur premier enfant, mes grands-parents étaient au désespoir. Ils habitaient alors 26, rue Joubert, un immeuble tout proche de l’église Saint-Louis d’Antin. Mon grand-père [Émile Bernanos] s’y étant rendu afin de prier pour son fils y rencontra sous le porche une voisine qui revenait d’un pèlerinage à Lourdes. Apprenant la triste nouvelle, elle lui offrit une petite bouteille d’eau de la grotte. Sans trop d’espoir, ma grand-mère en fit boire quelques gouttes au bébé à l’aide d’une petite cuillère en argent. Le lendemain la fièvre baissait et trois jours plus tard le médecin déclarait l’enfant sauvé» (2).
À l’évidence, celle que Bernanos dira «plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue», celle qu’il appellera «mère des grâces», et qu’il désignera comme «la cadette du genre humain», ne ménagea guère sa «tendre compassion» pour une fille de Pellevoisin dévastée par la perspective de perdre son fils (3). Mais Hermance ne fut pas la première ni la seule fille de Pellevoisin à laquelle Marie fit entrevoir les abîmes, comblés de sublimités, de son coeur compatissant.
En 1876, soit trois ans avant qu’Hermance ne convole en justes noces avec Émile, la Vierge, médiatrice des grâces de son Fils, était apparue à Estelle Faguette, une humble servante, une femme très pieuse, condamnée par la maladie. Quatre nuits de suite, Marie avait chassé le diable apparu au pied du lit de la mourante et avait finalement obtenu du Christ qu’il sauvât la malheureuse d’une péritonite tuberculeuse qui était sur le point de l’emporter. Sous le talon de Marie-Conculcatrice, le soleil de Satan fut pulvérisé comme un vulgaire caillou.
Si je ne m’abuse, l’apparition mariale de Pellevoisin n’a laissé aucune trace dans l’oeuvre de Georges Bernanos, au sens où il n’y fit jamais référence directement. L’évoquer ici même, parallèlement à la guérison (possiblement) miraculeuse du nourrisson qu’il fut, nous fait toutefois comprendre comment la famille du futur écrivain vécut, à l’instar de bien des familles catholiques de l’époque (pensons par exemple aux Martin d’Alençon), dans le proche voisinage et pour ainsi dire dans l’amitié des saints – au premier rang desquels figure la Vierge.
Le surnaturel était pour ces générations anciennes, pour ces chrétiens de jadis, élevés dans une piété compassée, mais profonde, quelque chose de tout à fait naturel, quelque chose qui allait de soi, qui tombait sous le sens et que nul n’aurait eu l’idée saugrenue d’ignorer.
Le surnaturel était pour ces générations anciennes, pour ces chrétiens de jadis, élevés dans une piété compassée, mais profonde, quelque chose de tout à fait naturel, quelque chose qui allait de soi, qui tombait sous le sens et que nul n’aurait eu l’idée saugrenue d’ignorer. Bernanos grandira en tout cas dans cette familiarité avec les habitants du Ciel et cette intimité de rapport transparaîtra, des années plus tard, dans son essai sur la Pucelle, intitulé Jeanne, relapse et sainte, livre dans lequel il martèle cette vérité essentielle: «Notre Église est l’Église des saints.»
Les travaux, les jeux et les jours
Durant son enfance et son adolescence, Georges Bernanos fréquente divers collèges de province ou de la capitale, dont celui des jésuites, le Collège de l’Immaculée-Conception, rue Vaugirard, où il est inscrit de 1897 à 1901, et où un dénommé Charles de Gaulle, promis à un destin hors du commun, reçoit également l’éducation des pères.
Les élèves de la rue Vaugirard doivent changer d’établissement quand, en 1901, la République rabique vote la loi anticongréganiste sur les associations. Cette loi motivée par l’antichristianisme d’alors pousse la Compagnie de Jésus, comme d’autres congrégations décidées à ne pas se soumettre aux mesures vexatoires imposées par l’État, à fermer leurs établissements et à prendre le chemin de l’exil (4).
À l’automne 1901, le jeune Charles de Gaulle suit les jésuites à Antoing, en Belgique, tandis que Bernanos se retrouve interne au Petit Séminaire de Notre-Dame-des-Champs (à Paris). À couteaux tirés avec ses professeurs en raison de son comportement qui n’est pas toujours exemplaire, il a rapidement en horreur cet endroit où tout le dispositif disciplinaire semble être «uniquement construit pour vous prendre en défaut, pour cultiver la mauvaise conscience». L’hostilité des autres élèves, qui en font leur souffre-douleur, achève de rendre l’expérience infernale.
Pour son plus grand bonheur, le collégien, dont les parents sont domiciliés à Paris, passe le plus clair de ses étés d’enfance, d’abord dans la famille de sa mère, à Pellevoisin, puis, à partir de 1896, «dans une vieille propriété de campagne appartenant à [son père], au petit village de Fressin», dans le Pas-de-Calais, «un pays de grands bois et de pâturages» qui lui fournira plus tard le décor de ses romans. Pour le petit Parigot en vacances, «Fressin, c’était la liberté, d’interminables promenades sur les chemins d’alentour, la rêverie et le braconnage», raconte le critique et biographe Albert Béguin (5).
Ce petit être «qui trottait sous la pluie de septembre, à travers les pâturages ruisselants d’eau, le coeur plein de la rentrée prochaine, des préaux funèbres où l’accueillerait bientôt le noir hiver, des classes puantes, des réfectoires à la grasse haleine, des interminables grand’messes à fanfares où une petite âme harassée ne saurait rien partager avec Dieu que l’ennui», ce petit être emprunta un jour la carabine d’un paysan pour aller tirer la galinette cendrée dans les poulaillers voisins! Manière de rasséréner son âme harassée, sans doute!
Au fil des travaux, des jeux et des jours, le petit «Jô» reçoit de ses parents, dans la douceur du foyer familial, une éducation française et catholique, dont il tirera le meilleur de lui-même tout au long de sa vie. «Je dirais que j’ai été élevé dans le respect, l’amour, mais aussi la plus libre compréhension possible, non seulement du passé de mon pays, mais de ma religion.» Leur dédicaçant son premier roman, l’écrivain devenu célèbre en 1926 remerciera son père et sa mère d’avoir, par leur dévouement fidèle, formé son coeur d’enfant «à la vérité éternelle».
Je crois toujours qu’on ne saurait réellement «servir» – au sens traditionnel de ce mot magnifique – qu’en gardant vis-à-vis de ce qu’on sert une indépendance de jugement absolue.
L’esprit dans lequel il a été éduqué, Bernanos l’a synthétisé en quelques phrases qui respirent la santé spirituelle : «Dans ma famille catholique et royaliste, j’ai toujours entendu parler très librement et souvent très sévèrement des royalistes et des catholiques. Je crois toujours qu’on ne saurait réellement «servir» – au sens traditionnel de ce mot magnifique – qu’en gardant vis-à-vis de ce qu’on sert une indépendance de jugement absolue. C’est la règle des fidélités sans conformisme, c’est-à-dire des fidélités vivantes.»
À suivre…
___________
Notes:
(1) Cité par Jean-Loup Bernanos, Georges Bernanos à la merci des passants, Plon, 1986, p. 18.
(2) Jean-Loup Bernanos ajoute: «Ma grand-mère conserva longtemps le petite cuillère que son «petit Jô» avait mordillée. Crurent-ils au miracle? Pourquoi pas? Toujours est-il qu’un ex-voto est encore en place à Saint-Louis d’Antin» (Georges Bernanos à la merci des passants, op. cit., p. 21).
(3) Ces citations sur la Vierge sont tirées d’une des plus belles pages du Journal d’un curé de campagne. Je ne résiste pas à la tentation de vous la faire lire:
«Et la Sainte Vierge, est-ce que tu pries la Sainte Vierge ? – Par exemple ! – On dit ça… Seulement la pries-tu comme il faut, la pries-tu bien ? Elle est notre mère, c’est entendu, elle est la mère du genre humain, la nouvelle Ève. Mais elle est aussi sa fille. L’ancien monde, le douloureux monde, le monde d’avant la Grâce l’a bercée longtemps sur son cœur désolé – des siècles et des siècles – dans l’attente obscure, incompréhensible d’une virgo genitrix… Des siècles et des siècles, il a protégé de ses vieilles mains chargées de crimes, ses lourdes mains, la petite fille merveilleuse dont il ne savait même pas le nom. Une petite fille, cette reine des Anges ! Et elle l’est restée, ne l’oublie pas ! Le Moyen Âge avait bien compris ça, le Moyen Âge a compris tout. […] Mais remarque bien maintenant, petit: La sainte Vierge n’a eu ni triomphe ni miracles. Son fils n’a pas permis que la gloire humaine l’effleurât, même pas du plus fin bout de sa grande aile sauvage. Personne n’a vécu, n’a souffert, n’est mort aussi simplement et dans une ignorance aussi profonde de sa propre dignité, d’une dignité qui la met pourtant au-dessus des Anges. Car enfin, elle était née sans péché, quelle solitude étonnante ! Une source si pure, si limpide, si limpide et si pure qu’elle ne pouvait même pas y voir refléter sa propre image, faite pour la seule joie du Père – ô solitude sacrée ! Les antiques démons familiers de l’homme, maîtres et serviteurs tout ensemble, les terribles patriarches qui ont guidé les premiers pas d’Adam au seuil du monde maudit, la Ruse et l’Orgueil, tu les vois qui regardent de loin cette créature miraculeuse placée hors de leur atteinte, invulnérable et désarmée. Certes, notre pauvre espèce ne vaut pas cher, mais l’enfance émeut toujours ses entrailles, l’ignorance des petits lui fait baisser les yeux – ses yeux qui savent le bien et le mal, ses yeux qui ont vu tant de choses ! Mais ce n’est que l’ignorance après tout.La Vierge était l’innocence. Rends-toi compte de ce que nous sommes pour elle, nous autres, la race humaine ? Oh ! naturellement elle déteste le péché, mais enfin, elle n’a de lui aucune expérience, cette expérience qui n’a pas manqué aux plus grands saints, au saint d’Assise lui-même, tout séraphique qu’il est. Le regard de la vierge est le seul regard vraiment enfantin, le seul vrai regard d’enfant qui se soit jamais levé sur notre honte et notre malheur. Oui mon petit, pour la bien prier, il faut sentir sur soi ce regard qui n’est pas tout à fait celui de l’indulgence – car l’indulgence ne va pas sans quelque expérience amère – mais de la tendre compassion, de la surprise douloureuse, d’on ne sait quel sentiment encore, inconcevable, inexprimable, qui la fait plus jeune que le péché, plus jeune que la race dont elle est issue, et bien que Mère par la grâce, Mère des grâces, la cadette du genre humain. (Georges Bernanos, Oeuvres romanesques, Gallimard (coll. Bibliothèque de la Pléiade), 1961, pp. 1192, 1193 et 1194).
(4) Dans un article scientifique accessible en ligne, Patrick Cabanel, spécialiste de cet épisode peu glorieux de l’Histoire de France, rappelle quelques faits: “Disons un mot tout d’abord de l’ampleur de l’exil congréganiste au début du XXe siècle. Après avoir rappelé que l’attitude adoptée par de nombreuses congrégations enseignantes fut la « sécularisation » fictive de leurs membres et la reprise de leurs activités dans des écoles bientôt réouvertes. La Croix a estimé le seul exil, le 5 août 1914, à 60 000 départs. Un chiffre ramené à la moitié paraît, pour l’heure, plus raisonnable : il comprend notamment 4 000 frères des Écoles chrétiennes, 2 100 jésuites, 700 frères Maristes, environ 850 ursulines pour la seule Belgique, la quasi totalité des carmels, etc..; ou, par pays d’accueil, 2 000 arrivées au Québec, 3 000 environ en Espagne, beaucoup plus en Belgique. Ces congréganistes sont d’abord des jésuites ou des contemplatifs qui ont repoussé toute démarche d’autorisation et quittent le pays dès la fin du mois d’août 1901. Les enseignants les suivent massivement en 1903 et 1904 et, pour certains, jusqu’à la veille de 1914.”
(5) Albert Béguin, Bernanos par lui-même, Éditions du Seuil (coll. Écrivains de toujours), 1954, p. 28.