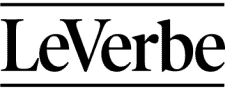Vingt-cinq pour cent. C’est la proportion de la population québécoise qui choisit de passer sous l’aiguille de l’artiste-tatoueur. Pourquoi choisit-on d’inscrire ainsi dans sa chair – plutôt que sur le mur de son salon – ce qui est beau, ce qui compte, ce qui doit résister à l’oubli ? Enquête sur les sens que revêt aujourd’hui la pratique ancestrale du tatouage.

Accoudé au bar du restaurant où l’on s’est donné rendez-vous, Guillaume offre une vue imprenable sur les fresques qui ornent ses avant-bras. À gauche, une Vierge Marie éplorée d’un côté, un Christ couronné d’épines de l’autre. À droite, c’est un crâne traversé d’une lame ainsi qu’une sirène qui habillent sa peau. Frappants contrastes. Ces tatouages n’illustrent pas des temps discordants de sa vie. Au contraire. Alors qu’il est à l’aube de la vingtaine, ses débuts dans l’armée canadienne l’incitent à marquer son appartenance au camp des tough : « On partait à la guerre, on voulait avoir l’air dur à cuire. Il n’y avait pas une grande réflexion. On s’entrainait pour être déployé, on prenait ça au sérieux. On voulait avoir l’air pas fin, ça fait qu’on s’est fait tatouer comme des pas fins. »
Pas de pieux attachements exprimés à travers le visage de Jésus et celui de sa mère. Ce que Guillaume recherche dans sa jeunesse, c’est plutôt une « esthétique gang de rue, latino, tout ça. Moi, j’écoutais beaucoup de rap quand j’étais plus jeune. Ce n’était vraiment pas en lien avec l’Église. […] Dans le milieu hip-hop, on voyait souvent ça [les tatouages religieux] ».
Si dans le passé les tatouages ont été « associés avec la criminalité ou la marginalité », les dernières décennies ont été marquées par un « processus de normalisation », m’explique Samuel Beaudoin, chargé de cours en anthropologie à l’Université Laval. Il poursuit : « On est parti de la marge vers la norme. Puis, plus que de la marge vers la norme, on en est aujourd’hui à une valorisation. On aime ça, c’est même bien vu, ça fait partie de la création de soi. »
Se dire par sa peau
Quelles causes trouve-t-on à l’origine de ce changement de paradigme? « D’une part, je pense qu’on peut considérer la désacralisation du corps. Il y a un processus de distanciation avec la religion au Québec, par exemple, qui fait en sorte que, prenant une distance par rapport aux dogmes et aux normes associées à la religion […], le corps peut [désormais] être modifié. »
Le professeur Beaudoin indique une deuxième cause qui rendrait compte de la montée en popularité du tatouage : « Il y a un changement de statut relié à l’étranger. L’étranger, ce n’est plus le bizarre, l’autre absolu, c’est quelque chose qui prend une certaine valeur. Paraitre différent – tu sais, je ne dis pas être différent, ça, c’est autre chose –, ça devient possible. La diversité est devenue quelque chose de recherché. On veut avoir une image extérieure qui se distingue. Il y a eu un certain moment où l’on pouvait commencer à tolérer les différences. Là, on n’en est plus à tolérer des écarts, des marges, des différences : on est à leur faire une place, dans l’idée d’inclusion. »
Chercher le motif qui se distingue par son originalité, c’est quelque chose qui caractérise le choix des tatouages de Charlot. Le marquage corporel est une manière de se raconter. Pour le jeune finissant en soins infirmiers, les tatouages sont « comme des cicatrices. Dans le sens que si tu as une cicatrice sur le corps, quelqu’un va voir ça, pis te dire: “Eille, c’est quoi, ça ? Conte-moi l’histoire de ta cicatrice.” Moi, les gens, quand je les rencontre, ils sont comme: “Eille! Pourquoi tu as ces tatouages-là?” Puis tu peux vraiment conter ton histoire. »
La mise à distance du religieux conduit nos sociétés non seulement à revoir le statut du corps, mais aussi à s’extirper du christianisme comme grand récit dans lequel la destinée de chacun se retrouvait jadis inscrite d’emblée. Beaudoin s’avance : « On pourrait dire que le grand récit existe encore, mais c’est comme s’il avait été vidé de sa substance. » Or, le besoin qu’a l’humain d’ancrer sa vie dans quelque chose qui le dépasse est tenace. Si le récit fédérateur qui existe maintenant est la supériorité de la diversité, si ce qui reste, c’est l’unicité de son histoire individuelle, c’est toujours mieux qu’une absence totale de récit. La nature a horreur du vide.
Les moments importants de la vie sont ainsi signifiés : deuil, voyage, rupture, etc. « Le premier que j’ai fait, ce sont mes ailes dans le cou », me dit Charlot en pointant le dessin gravé sous sa nuque blonde. « Celles-là, je les ai faites quand ma tante est décédée, parce que toute ma vie, elle a été un ange gardien pour moi. » Sans dire que le tatouage est un rite – puisqu’il ne s’inscrit pas dans un cadre religieux –, il constitue un « acte de passage », souligne M. Beaudoin, empruntant les mots du sociologue David Le Breton. L’être humain ressent la nécessité de poser des gestes qui marquent le poids, la valeur des choses.
Manier l’aiguille, de père en fils
Au Proche-Orient, une tradition familiale qui perdure depuis maintenant vingt-huit générations révèle un tout autre visage du tatouage. Il s’agit là de s’insérer dans la grande histoire chrétienne. C’est ce dont témoigne Wassim Razzouk, tatoueur et propriétaire d’une petite boutique de tatouages à Jérusalem. Il y a de cela cinq-cents ans, ses ancêtres – une famille de chrétiens coptes – ont quitté l’Égypte pour la Palestine afin d’y faire un pèlerinage. Ils s’y sont finalement établis.
« En Égypte, ma famille avait l’habitude de tatouer les chrétiens coptes sur le poignet, comme ceci », m’explique-t-il en me montrant son propre poignet, où je repère une toute petite croix de Jérusalem. D’abord un signe d’exclusion imposé par le régime qui dominait alors la région, la marque d’une croix était imposée aux chrétiens qui refusaient de se convertir à l’islam. Plus tard, ces derniers en ont fait un signe d’appartenance.
« Je t’ai gravé sur les paumes de mes mains. »
Is 49,16
Arrivés en Terre sainte, les ancêtres de Wassim découvrent une pratique semblable à la leur : les chrétiens qui viennent en pèlerinage reçoivent un tatouage pour marquer leur appartenance au Christ et signifier qu’ils ont foulé le sol sacré. « La seule famille qui a perpétué la tradition, c’est la nôtre. Et pour cette raison, nous sommes considérés comme la plus ancienne famille de tatoueurs au monde! » affirme avec fierté ce représentant de la 27e génération. Ses deux fils travaillant avec lui depuis quelques années, la relève semble assurée.
Depuis Athènes où il séjourne au moment de notre conversation, Wassim m’explique, un bol de café à la main, ce qui l’a poussé à poursuivre la tradition de ses ancêtres: « Au début, je ne voulais pas faire ça. Je voyais faire mon père et ma tante, qui était aussi tatoueuse, mais je n’aimais pas ça, parce qu’il y avait beaucoup d’encre et de sang. Je trouvais ça sale. Mais un jour, quand j’ai eu trente ans, je roulais sur mon Harley près du lac de Tibériade et j’avais cette voix dans ma tête qui me répétait : “Il faut commencer à tatouer.” Je ne savais pas à l’époque ce que c’était, mais plus tard, j’ai compris que c’était la voix de Dieu, que Dieu voulait que je continue. D’une certaine manière, c’est ainsi que Dieu nous parle, je crois. Je suis donc rentré à la maison, après ce voyage – qui a duré deux jours, ou quelque chose comme ça –, et j’ai dit à mon père: “D’accord, je veux commencer à tatouer.” Il n’en revenait pas, bien sûr! Il a pris tous les outils et il a commencé à m’enseigner. »
La filiation au Christ… jusque dans la chair
Une rencontre le marque d’une façon particulière. Un jour où il est occupé à tatouer un groupe de pèlerins en provenance d’Éthiopie, une femme s’avance et lui demande de tatouer sa mère. Décontenancé, Wassim croit avoir mal compris, puisque la femme devant lui est elle-même fort avancée en âge: « Elle avait 80 ans. Elle me dit: “Voici ma mère.” Cette mère avait 101 ans. » Sa peau était si ridée, ses poignets si fragiles que l’artiste refuse pour éviter de la blesser. « Sa fille, qui parlait anglais, m’a alors répondu: “Vous allez la tatouer parce que ma mère est venue ici, elle a fait son pèlerinage, et elle ne retournera pas à la maison sans le tatouage.” »
Cette expérience est un tournant dans la vie de Wassim. Il prend conscience de ce que ce geste symbolise pour les pèlerins: « C’est une expérience spirituelle. Ce n’est pas seulement pour commémorer leur pèlerinage, mais c’est aussi pour s’unir aux souffrances de Jésus, parce qu’il est mort sur la croix pour nous sauver. »
Si le tatouage peut être une « façon de se produire soi-même », comme le décrit M. Beaudoin, il semble aussi pouvoir réaffirmer chez les pèlerins une identité reçue: celle de l’appartenance au Christ.
Image : Laurence Bédard-Lamarche