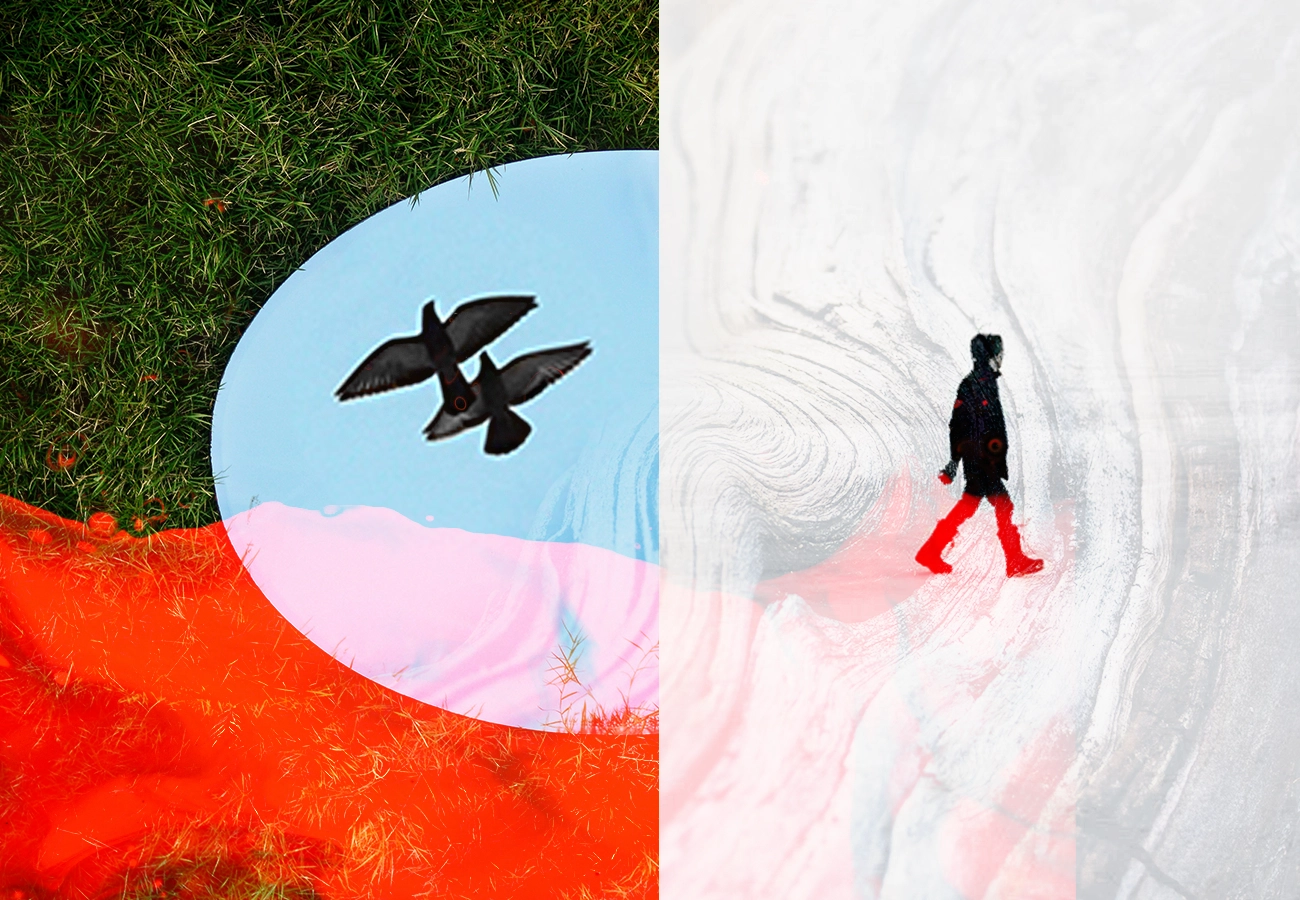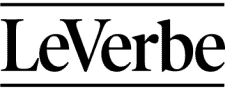Pendant 35 ans, Emmanuel Godo, poète et professeur de littérature au lycée Henri-IV à Paris, a travaillé à une somme sur l’écrivain Maurice Barrès (1862-1923). Publiée l’an dernier aux éditions Tallandier, elle force en quelque sorte la réouverture du procès (parodique) intenté à Barrès en 1921 par les jeunes surréalistes en devenir. Par son verdict de culpabilité, ce procès a contribué à faire de Barrès ce traitre à l’idéal littéraire qui aurait troqué le génie primesautier de l’irrévérence poétique pour l’office dégradant de vil propagateur des vérités officielles du régime.

Mon intérêt pour Barrès – dont j’ignore à peu près tout, que je n’avais jamais lu jusqu’à tout récemment, dont j’ai encore à peine effleuré l’œuvre – vient du fait qu’il est connu pour avoir été lu et aimé de grands écrivains comme Mauriac, Drieu La Rochelle, Aragon ou Malraux. Il vient aussi du fait qu’il a été, avec Charles Maurras, au tournant du XXe siècle, un des deux grands accoucheurs du nationalisme moderne en France. Pour ces deux raisons, j’avais envie de lire le livre d’Emmanuel Godo, qui m’est apparu comme une excellente façon d’entrer dans l’univers barrésien. J’étais aussi curieux de savoir à quoi pouvait bien ressembler 35 ans de travail patient et dévoué sur un même écrivain. J’ai été édifié !
Le Verbe: À l’évidence, Emmanuel Godo, vous avez su trouver, dans l’œuvre de Barrès, une abondante nourriture. Pouvez-vous nous dire laquelle?
Emmanuel Godo: Barrès, non seulement n’a pas trahi l’idéal littéraire d’un Baudelaire ou d’un Hugo, mais l’a admirablement servi : c’est le prosateur le plus exceptionnel du tournant des XIXe-XXe siècles, que Proust lui-même admirait. Les grandes pages de Barrès tiennent la comparaison avec celles de Bossuet ou de Chateaubriand : on ne peut pas en dire autant de la plupart des représentants de la « modernité » littéraire, n’est-ce pas ?
Et, qui plus est, c’est un écrivain qui aurait pu faire le choix de la distance ironique, voire du retrait désenchanté, mais qui a préféré être au plus dru des combats de son temps, des questions et des maux de son époque, non seulement pour y réfléchir, mais pour agir sur eux. Si notre pays avait encore le sens de la littérature, et du courage de la pensée, Barrès serait sur l’estrade de notre mémoire collective, juste à côté de Gide ou de Camus.
Pouvez-vous nous dire un mot du climat intellectuel et moral qui prévalait à l’époque du jeune Barrès ? Rappelons que la génération de Barrès a été formée à l’école des deux maitres à penser : Ernest Renan , qui distillait dans ses œuvres un scepticisme desséchant, et Hyppolite Taine , qui, lui, répandait un pessimisme pesant. Quels rapports Barrès a-t-il eus avec ces auteurs ? Qu’a-t-il reçu d’eux et que leur reproche-t-il de ne pas lui avoir donné ? Enfin, comment cette insatisfaction a-t-elle orienté toute sa vie d’écrivain ?
Barrès a assimilé la pensée de Taine comme celle de Renan et il a pris leurs instruments de pensée pour en faire autre chose. Barrès est un génie, l’un de ces esprits de haut vol qui regardent les angles morts de leur époque, la disette politique et spirituelle qui la mine. La pensée critique, le dilettantisme, la faculté de l’esprit humain à trouver un plaisir intellectuel à humer toutes les civilisations, toutes les cultures, Barrès les fait siens et il les retourne contre ses maitres. Car Taine et Renan produisent une vision relativiste, là où Barrès sent bien, dès le départ, que son époque manque d’absolu, d’un idéal à galvaniser les peuples. Le dandysme fait bon ménage avec la prudhommie : Barrès caricature Renan, dans son pamphlet, Huit jours chez M. Renan, en bourgeois ventru, ronflant de contentement de soi. C’est le « Monsieur Prudhomme » des Poèmes saturniens de Verlaine ou le Homais de Flaubert dans Madame Bovary.
Le premier état d’achèvement de la quête barrésienne nous est donné dans la trilogie du Culte du moi, par laquelle Barrès s’est imposé d’un coup (avec le premier titre) et pour de bon (avec les deux autres), comme une figure incontournable de la vie littéraire de l’époque. Par quoi cette œuvre a-t-elle su s’imposer esthétiquement ? À quelles aspirations a-t-elle su répondre à l’époque ? Quel message permanent délivre-t-elle ?
La notion de message est vraiment problématique quand on veut parler sérieusement de littérature, pardon de vous le dire. La littérature, au sens fort du terme, est strictement incompatible avec l’idée de message. Écrire, pour quelqu’un comme Barrès, comme pour Rimbaud ou Proust, cela ne signifie pas communiquer, sur un mode transitif, un message. C’est même tout le contraire ! Écrire, c’est chercher ce qui ne peut se dire à travers la messagerie sociale. Ce n’est pas ajouter du discours au discours : c’est creuser du côté de l’illisible et de l’incommunicable pour en tirer de nouveaux espoirs.
Le Culte du Moi est une longue quête : le moi ressemble trait pour trait à un dieu caché. Il est une œuvre à venir, qui n’obéit pas à des recettes ou des injonctions. La trilogie répond d’abord à l’angoisse d’être des jeunes gens au moment de ce que Barrès nomme magnifiquement le « départ pour la vie », c’est-à-dire le tournant de la vingtième année, la transition entre les études et la vie dite active.
On ne se représente pas, aujourd’hui, l’appel d’air extraordinaire qu’a constitué la trilogie du Culte du moi. Blum, Maurras, Mauriac, entre autres, en ont témoigné. Des milliers de jeunes gens qui se croyaient seuls découvrent que l’un des leurs parle d’eux d’une façon non trompeuse : de leur gouffre intérieur, de leur désir, du grand devoir que signifie l’acheminement vers soi.
Entre la légitime quête de compréhension et de maturation du moi, à laquelle nous sommes tous tenus, et l’enfermement dans une complaisante et inassouvissable recherche du moi qui tourne à l’idolâtrie, où se situe la frontière et où situeriez-vous Barrès par rapport à elle ?
Aucune idolâtrie du moi chez Barrès, je ne peux pas vous laisser utiliser ce terme ! Le moi n’est pas constitué, il se cherche, il est l’élan de sa propre recherche et il découvre, très vite, qu’il n’est que l’instant d’un long développement qui le précède et lui succèdera. Le moi barrésien est ouvert : il est un nous en attente. L’individualisme barrésien est un transindividualisme, dès ses premières œuvres. Il est en dialogue, en confrontation, toujours soucieux de ne pas être happé dans des totalités sans nom. Le culte du Culte du moi est à prendre au sens liturgique, non comme la vénération d’une idole, mais comme l’appel à l’absent.
Comment, dans la décennie ‘90, l’individualisme égotiste de Barrès a-t-il fini par déboucher sur le nationalisme ? Est-ce explicable par une sorte de volteface ?
Aucune volteface – c’est ce qui est terrible quand on veut parler d’un auteur sans l’avoir lu. C’est cela le grand malheur de Barrès : la mémoire collective voudrait bien le cantonner à des lieux communs, une dramaturgie décidée de l’extérieur, de loin, sur la base de clichés généraux répétés à l’envi par le discours en usage – et surtout s’épargner de le lire.
Le moi barrésien, comme je vous le disais, est ouvert, il sait qu’il est constitué d’autre chose que de lui seul. Les racines, la terre, ce ne sont pas des concepts chez Barrès, mais des réalités bien vivantes : le moi égotiste découvre qu’il appartient au pays où se trouvent les tombes de sa mère et de son père. C’est la vie qui le lui apprend.
Le nationalisme, c’est l’attachement aux paysages premiers : pour Barrès, il passe par la Lorraine. Le nationalisme barrésien ne demande pas la fusion du moi dans un tout : c’est tout le contraire. La pensée de Barrès ne fait pas de sauts ni de marche arrière : elle se développe. Au soir de sa vie, Barrès dira qu’Un homme libre (Culte de Moi, tome 2) reste son expression centrale. C’est un arbre qui a poussé en suivant le sens de sa soif.

Ce qui m’a frappé à la lecture de votre somme, c’est à quel point le nationalisme a pu servir, pour Barrès et ses contemporains, de religion de substitution dans un monde sans Dieu. Et comment Barrès a assumé, comme tous les grands écrivains modernes désormais porteurs de la seule “Parole” encore quelque peu inspirée, un rôle de prophète que la société moderne a sacré à travers une autre forme de rituel que celui proprement religieux, et qui a fait de la littérature le dernier refuge de la grâce.
Aujourd’hui, le nationalisme garde encore cette fonction. Il est une sorte de culte du moi collectif, offrant un horizon de sens assez vaste, apte à orienter l’existence individuelle, et offrant aux cœurs épris de grandeur des occasions d’engagement et de dépassement d’une vraie noblesse. Ses propagateurs, quand ils manient bien le verbe, sont aussi capables de communiquer une forme d’enthousiasme profond.
Cependant l’amour de la patrie qui minore ou fait carrément oublier l’importance de la patrie céleste a quelque chose de désordonné, de néfaste. En nous incitant encore aujourd’hui, par son œuvre, à nous satisfaire de cette religion séculière, Barrès ne contribue-t-il pas à la désertification moderne qu’il voulait contenir grâce au supplément d’âme qu’offre la ferveur patriotique?
Je vais réécrire mon livre, car visiblement j’ai mal exposé ce qu’est le nationalisme barrésien. Barrès se rend compte que la troisième République est une structure juridique à laquelle il manque une âme. On ne peut mobiliser le peuple pour une architecture de lois et de règlements. Regardez, c’est une question dont nous ne sommes pas sortis. On aurait intérêt à relire Barrès aujourd’hui. Il manque à notre pays un projet mobilisateur : Barrès est convaincu, et il a raison, que la politique se nourrit d’abord de passion. Pour éviter que cette passion soit mortifère, il faut qu’elle soit plutôt un amour. Barrès, dans l’antisémitisme, a cru, un temps, trouvé ce que Drumont nommait une « belle haine ». Il faudra du temps à Barrès – cela, on peut légitimement le lui reprocher – pour se rendre compte que l’amour est plus fécond que la haine.
Le nationalisme barrésien c’est cet amour de la nation qui rend possible non pas la guerre avec les autres – selon la doxa antinationaliste contemporaine – mais le dialogue. Ce n’est en rien une religion de substitution. Ce dont vous parlez, c’est de ce que deviendra le nationalisme chez ceux qui en feront un totalitarisme. Vous ne parlez pas de Barrès qui, lui, ressentira le caractère incomplet de son propre nationalisme. C’est ce qui le fera évoluer vers le catholicisme dans les années 1910, avec comme point d’orgue l’admirable Colline inspirée.
Abordons maintenant la question des rapports de Barrès avec la religion en général et avec le catholicisme en particulier. Barrès a quelque chose de convaincant, de réjouissant quand il parle de religion, parce que d’abord il a été lucide sur la dimension “religieuse” de l’idéologie socialiste qu’il a combattue à la Chambre des députés ; parce qu’ensuite il a su “mettre en avant l’importance politique, culturelle et sociale du catholicisme” (p 361) ; parce qu’enfin il a été lui-même porté par un véritable sentiment religieux.
Mais voilà, cette adhésion reste sur le plan du sentiment. Et cette sentimentalité s’accommode aussi bien des ébranlements que produisent les puissances chtoniennes (du grec, relatif aux divinités infernales ou souterraines) toujours à l’œuvre dans la nature vénérée des païens, que de l’élévation spirituelle et de la conviction chrétienne d’un Pascal.
Pour le dire un peu brutalement, Barrès me semble s’ébrouer complaisamment dans un syncrétisme sirupeux en se dérobant à Dieu, en restant étranger au Christ, en ignorant tout de la vraie vie de l’Esprit. Suis-je trop sévère ?
Nous sommes, décidément, radicalement en désaccord. C’est très bien ! Très barrésien, justement, très vivant, loin de la langue de bois des entretiens habituels : sincèrement, merci. C’est à cela qu’on voit que Barrès est vivant, paradoxalement : il suscite encore le débat, il n’est pas enveloppé dans la naphtaline de la reconnaissance universelle. Je vais encore me montrer très sévère à l’égard de votre propos, qui me parait témoigner d’une profonde incapacité à comprendre Barrès et, par-delà, son œuvre et peut-être le tragique de son époque, qui est encore largement le nôtre. Vous me pardonnerez cette brutalité, à mon tour.
Il n’y a aucun syncrétisme – et encore moins de sirop ! – chez le Barrès « religieux » ou « spirituel », mais un dialogisme exigeant, instable : le dialogue de la prairie et de la chapelle, qui clôt La Colline inspirée, est celui de l’enthousiasme et de la discipline, de l’énergie et de l’ordre. C’est justement cela la vie de l’Esprit, non ? Et celle de celui qui chemine avec le Christ, qui en intériorise la parole de feu, réfractaire, totalement libre, révolutionnaire, rétive aux mises au pas et pourtant en quête d’un partage, d’une communion. Se dérober à Dieu ! Mais je crois que vous le lisez depuis une représentation de ce qu’est le don à Dieu, une définition préalable, celle que vous-même avez forgée au cours de votre expérience. Henri Bremond ne le lisait pas ainsi, lui qui considérait que Barrès était plus authentiquement chrétien que Bloy, par exemple.
Lire un écrivain, ce n’est pas le juger à partir de catégories extérieures, c’est, au contraire, se laisser interroger par ce qu’il dit, par ce qu’il incarne. Si on ne se laisse pas lire par un écrivain, à proprement parler on ne le lit pas. Je vous fais ce reproche, amical, mais, au fond, ne vous blâme pas : notre époque désapprend ce rapport aux œuvres, et c’est mon métier que d’essayer de le faire entendre.
Quelle place occupe l’Orient dans l’imaginaire barrésien?
L’Orient est essentiel : c’est la poésie à l’état pur. C’est, pour l’Occident, l’autre. L’autre désirable autant qu’inquiétant. La pensée de Barrès a besoin de grands et francs antagonismes. Car la vie est conflit, dialogue, il y a toujours du risque et de l’encontre dans la rencontre. L’Orient de Barrès, c’est l’Orient musulman, un Orient venu dans sa vie à travers la lecture par sa mère, quand il était enfant, de Richard cœur de Lion en Palestine de Walter Scott. L’Orient de Barrès, c’est l’inconvertible, une sorte de réserve inépuisable d’énergie créatrice. Tout le contraire d’un orientalisme figé dans ses poncifs. C’est parce que l’Orient et l’Occident sont incompatibles que la vie peut se maintenir dans le monde.
Durant toute sa carrière, Barrès a exercé, avec une grande sollicitude, un magistère intellectuel et moral auprès de la jeunesse. D’où vient cette fidélité ? Peut-il encore, de quelque manière, jouer ce rôle à travers son œuvre aujourd’hui (moyennant la critique lucide des options idéologiques malheureuses qui furent parfois les siennes) ?
Oui, je vous remercie d’avoir été attentif à ce point. Barrès est à l’écoute de la jeunesse. Toute sa vie, il répondra aux demandes d’inconnus par milliers. Encore pendant la guerre de 14-18, que de courriers reçus, lus avec attention, auxquels Barrès répond toujours. Mauriac lui apporte Les mains jointes, son premier recueil de poèmes. Barrès « lance », littéralement, ce jeune homme à qui il ne doit rien, simplement parce qu’il est touché par la force et la profondeur de ses mots. Les surréalistes, qui se montreront, comme vous le rappeliez, si impertinents – et injustes – envers lui, viennent d’abord lui présenter leur hommage, Aragon bien sûr, Cocteau, mais même Breton.
Les options idéologiques malheureuses ! Je retiens cette expression : même quand on veut parler d’un point positif chez Barrès, il faut toujours ajouter un petit signe de reproche. Vous voulez parler de quoi, en particulier ? Son antisémitisme, probablement : oui, il s’est trompé à propos de Dreyfus, mais il a remarquablement rectifié cette erreur dans Les grandes familles spirituelles de la France. On oublie toujours cette rectification. Je crois, vraiment, que notre époque ne souhaite pas lire Barrès. Pourquoi ? Parce qu’elle ne tient pas à être lue par Barrès, par être confrontée à ses insuffisances politiques et à ses apories spirituelles. L’époque invente un Barrès infréquentable pour s’éviter le danger d’être mise en question par ce redoutable critique.
Selon que l’on a telle ou telle sensibilité (littéraire, philosophique, religieuse), telle ou telle préoccupations (esthétique, politique ou civilisationnelle), par quel titre conseilleriez-vous de commencer la découverte de l’œuvre de Maurice Barrès ?
Je ne vous proposerai pas de typologie de lecteurs. Car il n’y a qu’un lecteur qui compte : le lecteur de bonne foi, celui qui est prêt à entrer dans une œuvre pour la comprendre, pour se laisser soi-même dépayser. À ce lecteur-là, tout Barrès est utile, les chefs-d’œuvre ne manquent pas chez lui : Le Culte du Moi, bien sûr, même si Sous l’œil des barbares est difficile, car très ancré dans l’esthétique de l’époque. Peut-être aura-t-on avantage à commencer par Un homme libre. Et l’envoutant Jardin de Bérénice. Il y a, aussi, toutes les proses poétiques du voyageur sensible, de l’amateur d’art, de paysages italiens, allemands ou espagnols : Du sang, de la volupté et de la mort ou Amori et dolori sacrum. Pour les amoureux de peinture, on rappellera que Barrès est l’un des réintroducteurs du Greco : lire Greco ou le secret de Tolède. Et pour ceux qui s’intéressent à l’histoire du roman : les Déracinés est le premier roman politique et documentaire. Les lettres à Anna de Noailles, qui fut le grand amour de sa vie, sont d’une beauté à couper le souffle. Et Un jardin sous l’Oronte. Et Colette Baudoche. Même Au service de l’Allemagne comporte des leçons inattendues pour un lecteur d’aujourd’hui.
Emmanuel Godo, merci de vous être si généreusement prêté à cet exercice de “défense et illustration” de Maurice Barrès.