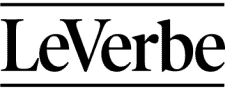Ancien directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales, Pierre Manent est l’un des plus importants intellectuels français de sa génération. Disciple de Raymond Aron, héritier de Leo Strauss, acquis à la tradition aristotélicienne, il a participé à la fondation de la revue Commentaire, dont il est membre du conseil de rédaction. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages majeurs, dont La loi naturelle et les droits de l’homme (2018) et Pascal et la proposition chrétienne (2022) sont les plus récents. Membre de l’Académie catholique de France, le philosophe politique nous a fait le plaisir et l’honneur de cet entretien.

Le Verbe: Alors que le christianisme est en voie de marginalisation en Occident, nos sociétés ont-elles quelque chose à gagner – ou à perdre – d’une conception judéo-chrétienne de la loi?
Pierre Manent: Je crois que l’essentiel de la notion, c’est l’idée simplement que l’être humain nait sous la loi.
Nous sommes des êtres libres, mais d’une liberté qui est en principe normée par une loi qui est donnée avec la vie humaine. Alors donnée par qui? C’est à la fois par Dieu et par la nature, ou par la nature telle que Dieu l’a créée. Il y a une liberté sous la loi, et cette loi est présente à la conscience de chaque être humain. Cette notion suffit à distinguer ce qu’on peut appeler la conception judéo-chrétienne de la loi de la conception moderne de la loi, et peut-être aussi de la conception de la loi d’autres régions du monde, d’autres civilisations.
L’enjeu, s’agissant de la question de la loi, est celui-ci: est-ce que la loi est quelque chose que les hommes fabriquent souverainement ou est-ce qu’à la base de toutes leurs inventions ou créations législatives, il y a une loi qui est donnée avec l’humanité même, donnée avec la liberté, donnée avec la naissance?
Dans le récit biblique, Dieu donne au peuple une loi. Cette loi, à bien des égards, nous l’avons naturalisée, c’est-à-dire que nous l’avons souvent traitée comme une expression des principes qui gouvernent fondamentalement l’être humain. N’y a-t-il pas un autre sens à l’avènement historique de la loi divine?
Pierre Manent: Bien sûr, la loi n’est pas simplement faite pour guider, ordonner la vie humaine. Elle est faite pour conduire l’être humain vers Dieu. La loi a un double visage: visage d’organisation de la vie humaine et visage d’orientation de la vie humaine vers Dieu. C’est là que la conception judéo-chrétienne se divise, parce que, dans la conception chrétienne, il y a – c’est particulièrement clair chez saint Paul – quelque chose que l’on pourrait appeler une critique de la loi, une insuffisance de la loi telle que l’Ancien Testament la déploie, selon la formule fameuse de saint Augustin: «La loi ne donne pas ce qu’elle ordonne.»
La loi ne donne pas ce qu’elle ordonne, c’est-à-dire qu’elle est incapable par elle-même de produire cette transformation de l’être humain qui le rend capable d’obéir à la loi, qui le rend capable d’être perfectionné par la loi. La loi, pour saint Paul, c’est ce qui fait apparaitre le péché. La loi, c’est ce qui nous révèle notre condition de pécheur, mais ce n’est pas elle qui peut corriger le péché qu’elle révèle. Seule la grâce peut accomplir le vœu, ou le propos, de la loi.
Il y a à l’intérieur de la révélation judéo-chrétienne une tension entre la loi et la grâce. La perspective chrétienne a cette complexité. Elle maintient la loi, elle maintient le rôle de la loi, elle maintient le caractère décisif de la loi dans la vie humaine. Elle amène une conception très échelonnée de la loi: la loi naturelle, la loi divine, la loi éternelle. En même temps, elle admet – c’est un élément doctrinal important – l’insuffisance de la loi réduite à elle-même. La loi n’est véritablement accomplissante que lorsqu’elle est accomplie par la grâce, lorsque la liberté humaine s’attache directement à la grâce de Dieu. Cette modulation entre la loi et la grâce est très variable selon les écoles, les confessions chrétiennes et selon, à l’intérieur d’une même confession, les écoles spirituelles.
Le don de la loi lors de l’épisode du mont Sinaï est aussi le moment où Dieu fait alliance avec son peuple. Quelle est la signification de ce lien entre loi et alliance? La portée juridique de la loi n’entre-t-elle pas en contradiction avec une conception plus relationnelle du lien entre Dieu et les hommes? Une loi qui vient ainsi d’en haut n’est-elle pas nécessairement impersonnelle, voire le symptôme d’une défaillance relationnelle?

Pierre Manent: Le Dieu d’Israël, qui est aussi le Dieu chrétien, a la caractéristique d’être à la fois infiniment élevé au-dessus des choses humaines et infiniment proche des êtres humains. C’est ceci qui le caractérise, ce mélange de distance, de sublimité, de sainteté et de proximité. Rien n’est plus éloigné de l’homme que Dieu, rien n’est plus proche de chacun de nous que Dieu aussi. C’est ce mystère que les Écritures juives et chrétiennes ne cessent de moduler, d’expliciter, de rendre sensible aux croyants.
Si on prend les textes, il est clair que les livres de la Torah mettent l’accent sur la distance, sur la sublimité de la loi et de Dieu, tandis que les prophètes mettent l’accent sur la proximité. Dans mon dernier livre sur Pascal1, je cite quelques extraits des prophètes. Ce sont véritablement des déclarations d’amour que Dieu adresse à l’être humain, et pour moi, c’est cette dualité qui est le propre de la révélation judéo-chrétienne, le propre des Écritures juives et chrétiennes.
C’est la chose qui est totalement étrangère aux Grecs. Le monde chrétien a énormément reçu du monde grec: la philosophie grecque, les historiens, Homère, Sophocle, Euripide. Si vous vous demandez ce qui est au centre des Écritures juives et chrétiennes et qui est impossible à trouver chez Homère ou chez Virgile, c’est cette caractéristique du Dieu d’Israël – qui est aussi le Dieu chrétien –, à savoir que le Très-Haut, le Tout-Autre, est aussi le plus proche.
C’est ce qui est à l’œuvre, ce qui devient sensible, perceptible, palpable dans ce qu’on peut appeler la prière commune des juifs et des chrétiens que sont les Psaumes. C’est dans les Psaumes en effet que l’âme s’adresse au Très-Haut, à celui qui jongle avec les montagnes comme avec un ballon, celui qui crée, qui est à la source de toutes choses et en même temps celui qui est au plus près de l’âme, qui est auprès de l’âme qui veille, qui est auprès de l’âme qui dort, et qui est l’objet de cette tendre adhésion de l’âme humaine qui prie en chantant les Psaumes. Voilà, pour moi, comment se pose la question de l’alliance, voilà le noyau de l’alliance.
J’ai laissé de côté la question politique. Je n’ai évoqué que la relation de l’âme individuelle avec Dieu. Il est évident que, dans le texte de la Bible, il y a aussi l’alliance collective: «Je serai ton Dieu, tu seras mon peuple.» L’alliance juive passe par la médiation du peuple de Dieu, et l’alliance chrétienne, qui accomplit l’alliance juive selon les chrétiens, passe par une autre médiation que celle du peuple juif.
Peut-on dire que la loi dans une communauté politique – comme l’alliance dans l’histoire sainte – ouvre la porte à une relation?
Pierre Manent: Oui, d’abord parce que la loi commande d’avoir un Dieu, d’avoir foi en lui, d’adhérer à Dieu, d’honorer Dieu, de ne pas prononcer son nom en vain. La loi institue une relation étroite à Dieu; ça, c’est un point que les chrétiens, et surtout les chrétiens devenant modernes, si j’ose dire, ont de la peine à percevoir. Ils sont encore plus pauliniens que Paul. Ils ont tendance à considérer que la loi est séparatrice: celui qui me commande, je ne peux pas vraiment adhérer à lui, notre relation est trop inégale pour que l’amour existe entre nous.
Mais l’Ancien Testament et les Psaumes, et une bonne partie de la spiritualité chrétienne, partagent cet esprit. La méditation de la loi fait partie de la vie spirituelle. La vie spirituelle consiste en un certain sens à prendre plaisir à la loi. Un des commandements de la loi, c’est que l’être humain prenne plaisir à la loi et mesure combien la loi est douce, combien la loi est instructive, combien la loi est nourrissante, combien la loi tourne l’homme vers Dieu et le dispose vers Dieu.
C’est ce qui fait que, pour le juif pieux, l’accomplissement de toute sa vie est une liturgie d’hommages et d’éloges de Dieu, puisque chacun de ses gestes est normé par un des commandements de la loi, un des 613 commandements. Mais cette idée est préservée d’une autre façon dans le christianisme parce que la loi éduque en retranchant tout ce qui gêne le mouvement de l’âme vers Dieu. La loi est essentiellement éducatrice. Au stade suprême du développement spirituel, l’âme croyante obéit à la loi sans s’en rendre compte, le côté commandant de la loi lui devient imperceptible. L’âme croyante est toujours obéissante à la loi. Il n’y a pas de mouvements bons de l’âme qui l’autorise à oublier la loi.
C’est là que certains mouvements spirituels gnostiques ou autrement hérétiques se sont manifestés, en postulant qu’à un certain degré de développement spirituel, l’être humain peut se débarrasser de la loi, d’où les débordements fameux de certains épisodes historiques où les gnostiques ou autres hérétiques manifestaient leur supériorité spirituelle par leur indifférence aux règles morales élémentaires. Je crois que c’est un point important qui est difficile à percevoir pour les modernes, même s’ils sont par ailleurs bien disposés à l’égard du christianisme.
Les hommes ont toujours eu de la peine à obéir à la loi, mais les modernes, c’est autre chose. Ce n’est pas seulement qu’ils ont de la peine à obéir à la loi, c’est qu’ils ont une sorte d’horreur de la loi. La loi en tant que telle leur parait marquer une conception mutilée de la vie humaine. Pour organiser une vie humaine satisfaisante, il faut l’organiser sans la loi, indépendamment de la loi. La vie la plus désirable, la vie la plus proprement humaine, c’est une vie sans loi. Ça, c’est le sentiment des modernes, la tendance dominante.
L’expérience politique contemporaine est marquée par la préséance du droit sur la loi, notamment à travers la notion de droits de la personne. Quels sont les effets de ce revirement sur notre compréhension de la loi, sur notre vie politique?
Pierre Manent: La notion absolument centrale de la conception morale moderne, la catégorie significative et positive de la vie humaine, qui permet de l’ordonner, qui permet de la penser, c’est la catégorie du droit. Non pas le droit comme règlement des disputes entre les hommes, mais le droit comme attribut enraciné dans l’être humain.
Il y a un pouvoir de commandement de l’individu, en tant que titulaire de droits, sur l’État. Il a le droit d’exiger de l’État qu’il satisfasse l’idée qu’il se fait de son droit. Il y a désormais un face-à-face entre l’État des droits et l’individu titulaire de droits, l’État des droits étant l’instrument de l’individu titulaire de droits.
L’ordre collectif s’ordonne maintenant autour de ces deux instances: les individus titulaires de droits égaux et l’État des droits, qui n’a de sens que par rapport à eux. Quelle est la conséquence de cela? C’est que tout le reste tombe dans les limbes, dans une indétermination ou dans un flou qui pèse sur la vie collective. Quand je dis tout le reste, c’est quoi? Tout ce qui échappe à ce face-à-face des individus titulaires de droits et de l’État des droits, c’est-à-dire ce qu’on peut appeler les choses communes.
Dans la société telle qu’elle s’est développée, telle qu’elle s’impose à nous, on ne sait plus parler des choses communes parce que ces choses communes ne peuvent pas être traduites dans le langage des droits de la personne. Quel est le statut des choses communes, quelles sont les raisons communes, quelles obligations peut-il y avoir au nom du commun quand les seules obligations sont enracinées dans les droits individuels? La conséquence, c’est que, dans la société telle qu’elle s’est développée maintenant – c’est ce qu’on dénonce sous le nom d’individualisme –, on ne sait même plus en quels termes formuler ce qu’on peut appeler des raisons communes ou des commandements liés au fait que nous partageons un commun.
L’Église a longuement polémiqué contre la philosophie des droits de l’homme. À bien des égards, elle semble maintenant l’avoir faite sienne. Est-ce vraiment le cas? Comment comprendre ces récents développements à la lumière de ses enseignements plus anciens?

Pierre Manent: Je pense que l’Église a renoncé à sa critique de principe des droits de l’homme pour deux raisons. D’abord parce qu’elle n’a plus l’envie ni la force de combattre frontalement la philosophie politique moderne, la philosophie morale moderne. Les papes du XIXe siècle étaient encore dans une posture où ils opposaient l’autorité de l’Église à l’autorité de la modernité politique. Ils étaient encore engagés dans un combat qu’ils pensaient pouvoir gagner.
Aujourd’hui, l’Église a renoncé à ce combat frontal parce qu’elle est beaucoup plus faible et parce qu’elle a trouvé un accommodement. Certains aspects des craintes des papes du XIXe siècle ne se sont pas réalisés. Elle a jugé qu’il n’était plus indispensable de faire une critique de principe des droits de l’homme.
Je pense qu’il n’est pas indispensable qu’elle fasse une critique de principe, mais elle n’était pas obligée non plus de dire qu’au fond, les droits de l’homme, c’était le christianisme qui les avait inventés. C’est ce qu’a dit déjà Jean-Paul II, et c’était aller beaucoup trop loin. Atténuer la critique, soit, adhérer aux droits de l’homme, c’est inutile.
De fait, l’Église a renoncé à critiquer de front et par principe les droits de l’homme, mais en pratique, elle est quand même dans une position critique à l’égard des conséquences de la philosophie des droits de l’homme. Sur toutes les questions qu’on dit sociétales – les questions concernant la famille, la vie sexuelle, l’avortement, la transsexualité, par exemple –, l’Église est pour le moins réservée.
Elle a donc renoncé à la critique de principe des droits de l’homme, mais en pratique, dans un certain nombre de domaines, elle continue malgré tout à critiquer les conséquences qu’on en tire, à critiquer une certaine interprétation des droits de l’homme. La question est de savoir si, en ayant renoncé à une critique de principe, elle n’a pas affaibli sa critique de certains aspects de la philosophie des droits de l’homme. Comment défendre la famille traditionnelle, par exemple? Comment critiquer l’euthanasie, si l’on n’est pas capable de montrer à quel point l’idée d’un droit enraciné uniquement dans l’individu humain est une notion insatisfaisante?
Je crois que l’Église défend de façon souvent courageuse certains «invariants anthropologiques», des règles qui sont supérieures à l’interprétation contemporaine des droits individuels: il y a des choses que l’on ne peut pas ruiner, abolir, effacer, au nom des droits individuels.
Je pense qu’elle le mènerait mieux si elle essayait non pas de reprendre le langage des papes du XIXe siècle – de fulminer contre l’orgueil humain qui s’attaque à la parole de Dieu, selon le style de l’époque –, mais d’exposer de façon un peu plus cohérente et systématique à quel point la doctrine des droits de l’homme telle qu’elle s’est imposée parmi nous est une doctrine contestable du point de vue de la raison. Ça, c’est quelque chose de très important, parce que l’Église se trouve prisonnière du fait qu’à tout ce qu’elle dit, on lui répond: «Mais ça, c’est une conception religieuse, et notre société est une société laïque.»
L’Église est dans une situation très difficile avec les droits de l’homme. Elle a quand même le courage de défendre un certain nombre de règles, de normes qui donnent sens à l’existence humaine et de mettre en garde contre les excès des droits individuels. Elle pourrait le faire de façon peut-être parfois plus cohérente, mais voilà. Il est par ailleurs difficile pour elle de faire admettre que ce qu’elle dit peut être plus raisonnable, plus rationnel que ce que disent ses critiques.
Souvent, l’Église a été perçue comme l’institution qui commande. Peut-elle encore enseigner sur le sens de la loi? S’est-elle disqualifiée? Dans une société où chacun fait comme bon lui semble, la parole de l’Église est-elle encore décisive pour les croyants, ou prend-elle plutôt la forme du conseil?
Pierre Manent: Il est clair qu’elle est de moins en moins audible. Non seulement audible par les incroyants, mais audible par les croyants et par beaucoup de ceux qui sont chrétiens, se veulent chrétiens, se pensent chrétiens ou voudraient être chrétiens. En même temps, on voit bien que, chrétiens ou non, beaucoup de nos contemporains sont troublés par certains développements de la philosophie des droits. Ce qu’on appelle aujourd’hui le wokisme, qui est une forme exacerbée de philosophie des droits, suscite beaucoup de réserve, et pas seulement, pas même spécialement, parmi les chrétiens.
Je crois que l’Église ne peut pas arbitrairement se présenter de nouveau, comme si rien ne s’était passé, comme une institution commandante. D’ailleurs, elle a longtemps été considérée et a longtemps été une institution commandante, mais son commandement a toujours été contesté à la fois à l’intérieur de l’Église et à l’extérieur de l’Église. On a tendance à l’oublier. Après tout, la réforme de Luther est un gigantesque mouvement de contestation de l’institution commandante. Elle s’est ensuite recomposée, les Églises réformées sont devenues elles aussi, à leur manière, des institutions commandantes.
À coup sûr, les institutions commandantes en général sont discréditées, leur droit de commander n’est plus admis dans les sociétés occidentales. En même temps, elles sont confrontées à des difficultés, si bien qu’elles s’interrogent, et vont s’interroger de plus en plus, sur les risques inclus dans un ordre collectif qui se veut fondé exclusivement sur les droits subjectifs. Il y a un moment où il faudra bien que les institutions retrouvent des raisons d’exister, parce que, si elles s’abandonnent à la dynamique des droits individuels, elles vont disparaitre, purement et simplement, y compris les nations.
Je crois que l’Église doit essayer d’être cette partie de la société où l’on s’oriente selon une vue plus complète de la condition humaine, une vue plus équilibrée, plus judicieuse de la condition humaine. Quand même, réduire toute la grammaire de la vie humaine à simplement ceci: «Nous sommes tous des individus égaux, chacun ayant un droit illimité sur lui-même et sur le reste du monde», c’est extraordinairement pauvre et violent.
L’Église comme institution – mais aussi les chrétiens en général – peut être le lieu où l’on regarde le monde humain avec un peu plus du sens de sa complexité, de la place des raisons communes, de la loi, et un sens plus vif des limites de ce que peuvent accomplir les droits individuels ou les droits subjectifs.
Bien sûr, l’Église commande en principe aux fidèles. On sait bien que les fidèles n’obéissent guère, mais là, du moins, elle peut retrouver une certaine rigueur et vigueur. Mais le plus important pour moi, c’est qu’il y ait un pôle qui introduise une façon différente de poser les problèmes. Nous sommes absolument prisonniers d’un langage qui est à la fois de plus en plus dominant et de plus en plus ruineux, tout simplement parce que, quels que soient certains bons effets des droits individuels, on ne peut pas constituer durablement une vie commune, un ensemble d’institution, sur la base d’un principe qui les ruine.
Pouvons-nous être vraiment libres sans loi? D’autres formes de règles ne viennent-elles pas nous rattraper? Une loi dépersonnalisée, qui ne relève plus de l’ordre proprement politique – mais plutôt du mouvement de l’histoire, de la culture, de l’air du temps –, peut-elle constituer une tyrannie masquée?
Pierre Manent: Je pense que oui. En tout cas, ce qui me frappe, c’est à quel point il est impossible de critiquer ces nouvelles libertés, ces nouveaux droits que personne n’envisageait il y a vingt ans. Il y a là quelque chose de très étrange.
Ces libertés adviennent, elles sont institutionnalisées, et avec leur institutionnalisation vient l’interdiction de les critiquer. On norme le langage pour qu’il ne les critique pas implicitement. Voyez à quel point aujourd’hui les pronoms distinguant les sexes sont supprimés, remplacés par des pronoms neutres, et ainsi de suite. Toutes ces choses-là font qu’une discipline de parole s’installe, et progressivement, tout le jeu spontané de l’expression humaine est de plus en plus enserré, entravé. Il est normé d’une façon qui devient à la fois tyrannique, obsédante en tout cas, et en même temps ridicule, parce que ce sont des contraintes ridicules, mais auxquelles les gens s’obligent eux-mêmes pour bien montrer qu’ils sont du bon côté du progrès. Il y a là quelque chose de frappant.
Mais il y a un autre aspect qui est peut-être plus intéressant politiquement. Quand les institutions politiques sont vivantes, quand le débat sur le commun est vivant, ce débat produit de la liberté parce qu’il faut que tous les aspects de la société, que toutes les opinions, d’une certaine façon, trouvent à s’exprimer. Il s’agit de déterminer la forme de la vie commune. En revanche, le langage qui repose de plus en plus exclusivement sur les droits est un langage appauvrissant, parce qu’il est censé reposer sur une évidence qui est ou bien partagée ou bien refusée. Le débat est fermé au moment d’être ouvert.
Je crois que, nos sociétés étant de plus en plus dominées par le langage des droits, il est de plus en plus difficile de débattre de la vie commune, de la forme de la vie commune, parce que les raisons communes ne sont plus validées. Le langage public est dominé par cette discipline de parole qui est justifiée au nom d’une évidence morale, l’évidence de l’égalité des droits, et nous en sommes là, avec un rétrécissement considérable du domaine de la libre parole dans nos sociétés.
1 Pour poursuivre la réflexion, notre collaborateur Olivier Duchesne-Pelletier a fait la recension du dernier ouvrage de Pierre Manent, Pascal et la proposition chrétienne (2022). À lire sur notre site Web.