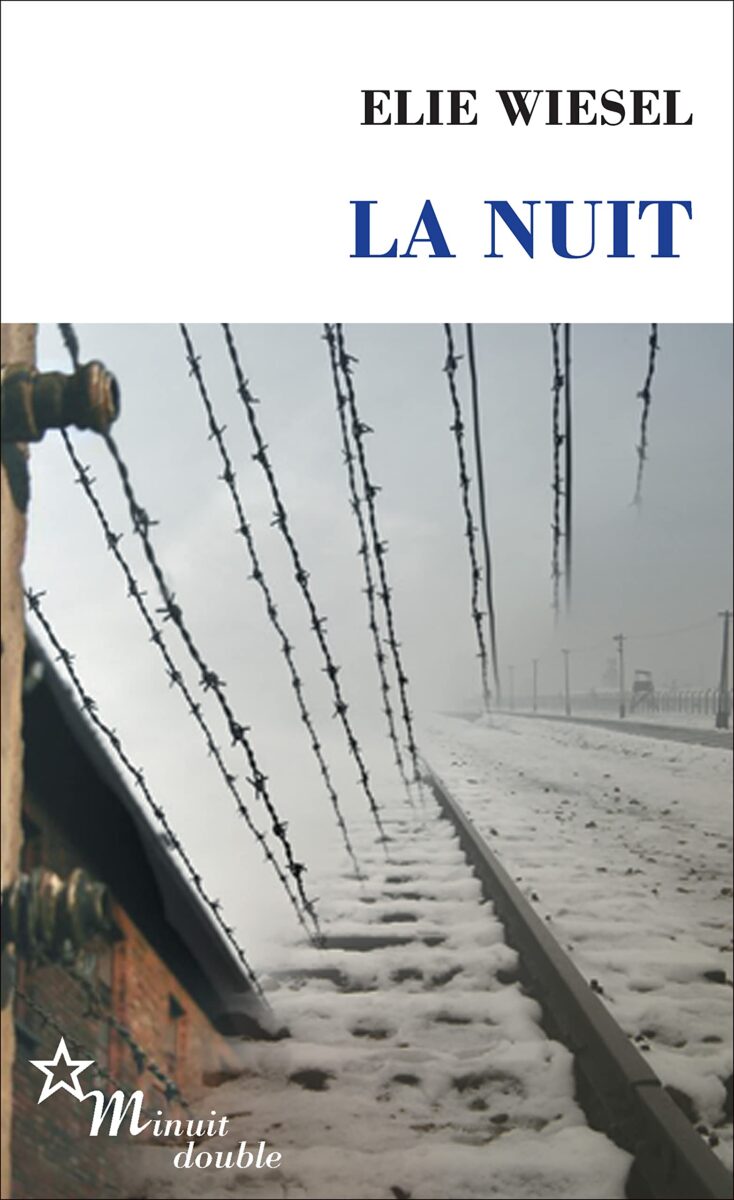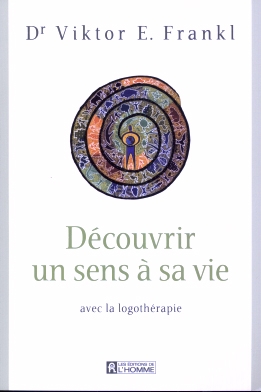Comme le note au passage la philosophe Chantal Delsol dans Les pierres d’angle (2014), la prise de conscience de ce qui s’est passé dans les camps d’extermination comme Auschwitz, Treblinka et autres ne s’est véritablement faite, à l’échelle de l’Occident, que dans les années 1960. Y ont contribué, en France, en 1956, le documentaire Nuit et brouillard d’Alain Resnais et la publication de La nuit, d’Élie Wiesel, aux Éditions de Minuit, en 1958.
Personnellement, c’est le documentaire De Nuremberg à Nuremberg (1989), diffusé à la télévision québécoise alors que j’étais adolescent, qui m’a fait prendre conscience de l’horreur des camps, et particulièrement de la Shoah.
En hébreu, la shoah, c’est la «catastrophe». On préfère ce terme, dans le monde francophone, à «holocauste», qui a un sens biblique précis, inapplicable en réalité à l’évènement historique abominable qu’il est censé décrire.
J’aime beaucoup les livres. J’ai des milliers de livres chez moi, mais il n’y a qu’un seul documentaire parmi ces milliers de livres: De Nuremberg à Nuremberg. Par la force évocatrice de ses archives visuelles, la sobriété de son commentaire, la puissance de sa trame sonore (signée Vangelis), il a permis à l’adolescent que j’étais de découvrir simultanément les abimes du mal et les sommets de la bonté humaine.
Quelques années plus tard, la lecture de Face à l’extrême (1991) – essai dans lequel Tzvetan Todorov (1939-2017) tente de tirer d’une méditation sur divers témoignages de rescapés des camps «une morale quotidienne à la mesure de notre temps» – m’a aussi laissé une profonde impression et a eu la vertu de m’initier à la «littérature des camps». Je m’étais alors promis de lire Antelme, Lévi, Tillion, Buber-Neumann, etc.
Retour
Il n’en fut pas ainsi, finalement. J’ai lu L’écriture ou la vie (1994), de J. Semprun, mais je me suis par la suite détourné du sujet. D’autres questionnements se faisaient plus pressants. J’ai beaucoup lu, par exemple, pour comprendre les raisons de la perte de la Nouvelle-France aux mains des Anglais. Puis il y a eu les années Malraux, les années Bernanos, les années Leys, etc. Cependant, l’idée de faire à ma manière mon devoir de mémoire ne m’a jamais quitté.
À ma manière, c’est-à-dire en me penchant, par la lecture, sur la réalité historique des camps de concentration ou d’extermination. C’est plus tard que j’ai finalement repris, grâce à deux livres, le chemin de cet espace clos, le camp, qui se situe, d’une certaine manière, en dehors de l’Histoire, du fait de sa densité existentielle, en même temps qu’il en constitue un des pivots essentiels, puisqu’il y a bel et bien, en ce qui concerne les camps, un avant et un après.
J’ai donc lu L’espèce humaine (1947), œuvre de Robert Antelme, dont j’ai fait une petite présentation ici, et Si c’est un homme (1947), de Primo Lévi. Et puis, au printemps dernier, mon ancien travail pastoral m’a offert une occasion d’élargir mes connaissances historiques sur les camps, mais aussi sur les ghettos, cette autre abomination à laquelle ont été confrontés les Juifs, sorte d’antichambre de la première. J’en ai tiré trois invitations à la lecture.
Je les offre ici, non pas en connaisseur de ces sujets – car ma fréquentation des œuvres qui en parlent est extrêmement limitée et le demeurera fort probablement –, mais parce que, marqué durablement par l’image quintessenciée du bien et du mal offerte par un film il y a 30 ans, je vois dans ce partage un moyen de maintenir en moi, et en d’autres peut-être, une claire et vive conscience de l’ampleur qu’ont pris et que peuvent encore prendre et le bien et le mal dans l’âme humaine.
Première invitation: Elie Wiesel, La nuit [1958], Les Éditions de Minuit, Paris, 2019 (basée sur la nouvelle édition de 2007 revue par l’auteur dans sa version anglaise), 208 p.
Sighet est une petite ville de Transylvanie (aujourd’hui située en Ukraine, mais alors hongroise), dont la population de près de 30 000 habitants était plus qu’au tiers juive en 1930. C’est là qu’est né et qu’a grandi, dans la ferveur de la religion juive et le gout de la mystique, le jeune Elie Wiesel. Mais au printemps 1944, alors qu’il avait 15 ans, sa lecture du Zohar a été interrompue par l’arrivée des SS, dont la mission était d’entasser tous les Juifs dans deux ghettos et de préparer leur déportation.
Le premier chapitre de La nuit, dans lequel Elie Wiesel raconte le début de l’enfer vécu par sa communauté, nous communique l’angoisse qui s’est emparée des Juifs de Sighet, depuis le jour où ils ont appris la nomination d’un fasciste au poste de premier ministre (22 mars 1944) – jour au lendemain duquel l’armée allemande est entrée en Hongrie -, jusqu’au départ du dernier train à bestiaux, qui achevait de vider la ville de ses Juifs, pour les conduire vers une destination inconnue.
Chose stupéfiante: l’espérance d’un dénouement heureux, aussi soudain qu’improbable, est venue, durant les jours d’incertitude au ghetto, et même durant le déplacement en train, comme envelopper dans l’illusion des âmes qui pourtant, au fond d’elles-mêmes, étaient conscientes de la gravité du sort qui les attendait. Ainsi, à propos de ce temps durant lequel les Juifs ont pu penser qu’il ne leur arriverait rien de plus grave que le confinement dans un ghetto, Wiesel note que «ce n’était ni l’Allemand ni le Juif qui régnait dans le ghetto: c’était l’illusion».
«Dans le domaine de la psychiatrie, explique le psychiatre Viktor Frankl, lui aussi rescapé d’Auschwitz, il existe un phénomène qu’on appelle “l’illusion de sursis”. Le condamné, tout juste avant son exécution, caresse l’illusion qu’à la dernière minute on lui accordera un sursis.» Parlant de l’arrivée de sa cohorte de déportés au camp d’extermination, le psychiatre observe ainsi: «Nous conservions nous aussi un espoir et nous nous accrochions à l’idée que notre situation n’était pas aussi mauvaise que nous le pensions.»
Pour E. Wiesel, l’arrivée à Auschwitz-Birkenau, relatée au chapitre 3, fut cependant le moment où se dissipèrent, pour lui et les siens, les dernières illusions. «Les objets chers que nous avions traînés jusqu’ici restèrent dans le wagon et avec eux, enfin, nos illusions.» La sélection débuta, qui conduisait, dès la descente du train, les jeunes enfants et les plus vieilles personnes à la chambre à gaz. Elie perdit de vue pour toujours sa mère et sa plus jeune sœur, Tsipora, 7 ans. Et tandis qu’en marchant vers la sélection, il s’agrippait à son père, un détenu l’interrogea:
- Hé, le gosse, quel âge as-tu? [...] - Quinze ans. - Non. Dix-huit. - Mais non, repris-je. Quinze. - Espèce d’idiot. Écoute ce que moi je te dis. Puis il interrogea [son] père, qui répondit: - Cinquante. Plus furieux encore, l’autre reprit: - Non, pas cinquante ans. Quarante. Vous entendez? Dix-huit et quarante. Il disparut avec les ombres de la nuit.
Quand le «fameux docteur Mengele», responsable du tri, lui demanda son âge, Elie Wiesel répondit: dix-huit ans. On lui indiqua de se diriger vers la gauche.
Il venait d’éviter la chambre à gaz.
Le calvaire du camp allait durer onze mois pour lui, et il en sortirait sans son père.
Deuxième invitation: Marek Edelman, Mémoires du ghetto de Varsovie [1945], Édition Liana Levi (coll. Piccolo), Paris, 2002, 128 p.
Varsovie comptait, avant l’invasion allemande de 1939, 400 000 habitants de confession juive sur une population totale de 1 300 000 habitants. Dès septembre 1939, l’occupant nazi projette la construction de ghettos juifs en Pologne. Un an plus tard, ce sont 380 000 Juifs qui sont forcés de s’installer dans un quartier bientôt entouré d’un mur de briques et de barbelés, complètement fermé à la mi-novembre 1940. Débute alors l’histoire terrible du ghetto de Varsovie.
Comme tel, le ghetto forme la plus importante communauté juive d’Europe, qui sera d’ailleurs la seule à trouver en elle la force d’opposer à l’entreprise de déshumanisation et d’extermination nazie une résistance armée. Ses chefs («dirigeants politiques, animateurs sociaux et intellectuels») ayant quitté la ville dès le 7 septembre 1939, la masse des Juifs de Varsovie mettra toutefois du temps à se sortir de l’hébétude pour s’organiser et s’équiper pour la lutte.
Entretemps, c’est l’action culturelle, éducative et caritative qui occupe les Juifs du ghetto. Et tandis que 80 000 personnes y meurent de faim et d’épuisement de novembre 1940 à juillet 1942, les Allemands continuent d’y acheminer des Juifs, si bien que l’on y compte encore près de 400 000 personnes lorsque, le 22 juillet 1942, le décret de déportation des habitants est publié. Il ne faudra pas longtemps pour que les habitants du ghetto comprennent que de Treblinka, au bout du chemin de fer, l’on ne revient pas.
De juillet à septembre 1942, plus de 300 000 Juifs sont déportés. Quand cesse cette première rafle, il reste environ 65 000 habitants dans le ghetto. Naissent alors, à l’initiative de partis politiques, deux groupes armés, dont l’Organisation Juive de Combat (OJC). L’un des cinq membres de la direction est Marek Edelman, membre du Bund, le parti socialiste juif de Pologne. Le rapport qu’il rédigea pour son parti à l’issue de la guerre, Le ghetto lutte, a été traduit en français en 1983.
Les Éditions Liana Lévi l’on rendu de nouveau disponible sous le titre Mémoires du ghetto de Varsovie en 1993 (réédition en 2002). On y lit avec émotion la relation des évènements qui ont conduit à l’insurrection du ghetto, et de ceux qui se sont déroulés durant l’insurrection elle-même, du 19 avril au 10 mai 1943, date à laquelle Edelman est parvenu à s’échapper par les égouts avec une poignée de compagnons, après le suicide, le 8 mai, des derniers dirigeants de l’OJC, encerclés par les SS.
Sur quelques centaines d’insurgés, quelques dizaines seulement ont survécu. Cette survie relève du miracle. Ces insurgés n’avaient pas prévu survivre, mais «mourir avec honneur». Comme le firent un jour une soixantaine d’entre eux, capturés et conduits à la gare pour être déportés.
«À la porte du wagon, B. Pelc [un insurgé] prononce quelques mots. Ces mots sont si forts qu’aucune des soixante personnes qui sont avec lui ne monte dans le wagon. Van Oeppen, le commandant de Treblinka, les abat tous lui-même sur-le-champ. Le groupe de Pelc montre aux Juifs qu’en tout lieu, à tout moment et dans n’importe quelles conditions, on peut et on doit s’opposer aux Allemands.»
Troisième invitation: Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie [1946], Les éditions de l’homme, Montréal, 2021, 144 p.
Découvrir un sens à sa vie est un livre hybride. Il est composé du témoignage personnel de l’auteur sur son expérience des camps de concentration nazis, et d’une brève présentation de la démarche thérapeutique novatrice dont il a accouché, en sa qualité de psychiatre, à la suite de sa terrible plongée dans l’enfer concentrationnaire.
Le témoignage de V. Frankl est centré non sur les faits survenus durant son internement, mais sur l’impact psychologique de celui-ci. Il porte aussi sur les réactions morales et spirituelles que la confrontation à l’extrême pouvait susciter chez les détenus, réactions qui pouvaient aller du désespoir à l’espoir, du suicide au sacrifice, de l’avilissement à la sainteté.
L’expérience de l’extrême, qui a conduit ce savant juif de Theresienstadt à Dachau en passant par Auschwitz, et qui a couté la vie à ses parents, à son frère et à sa femme, lui a fait voir avec des yeux d’épouvante la plus abyssale inhumanité. Mais là n’a pas été sa plus importante «découverte». Au bout de la nuit nazie, c’est pour lui le soleil de la dignité humaine qui s’est finalement levé, éclairant l’expérience de la condition humaine d’un jour nouveau: celui d’une liberté sinon intacte, du moins toujours vivante, toujours possible, toujours offerte, malgré toutes les violences et humiliations infligées par d’impitoyables bourreaux.
«Même si on le brutalise physiquement et moralement, l’homme peut préserver une partie de sa liberté spirituelle et de son indépendance d’esprit»: tel fut l’enseignement des camps. Et Frankl d’expliciter:
«Ceux qui ont vécu dans les camps se souviennent de ces prisonniers qui allaient, de baraque en baraque, consoler leurs semblables, leur offrant les derniers morceaux de pain qui leur restaient. Même s’il s’agit de cas rares, ceux-ci nous apportent la preuve qu’on peut tout enlever à un homme excepté une chose, la dernière des libertés humaines: celle de décider de sa conduite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles il se trouve.»
La substantifique moelle de Découvrir un sens à sa vie est sans conteste contenue dans une phrase qui, par sa puissance de vérité, confine au sublime. Elle mériterait d’être inscrite au fronton de toutes les institutions. La voici:
«Il fallait que nous apprenions par nous-mêmes et, de plus, il fallait que nous montrions à ceux qui étaient en proie au désespoir que l’important n’était pas ce que nous attendions de la vie, mais ce que la vie attendait de nous.»
Viktor Frankl, Découvrir un sens à sa vie
Il n’est pas exagéré de dire que de la compréhension ou non de cette vérité dépend le sort de la civilisation. La comprendre et l’accepter nous fera vivre à la hauteur de notre humanité et éloignera de nous le spectre du totalitarisme, système qui se nourrit autant de notre appétit de jouissance à tout prix et de notre gout de la tranquillité que de nos peurs. À l’inverse, la mépriser et la rejeter pourrait nous faire sombrer politiquement, et pour longtemps, dans l’ignominie.