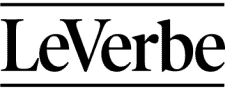Les nouvelles générations d’agriculteurs ont mis la main à la charrue sur une terre qui n’a à peu près rien à voir avec celle de leurs parents. Mondialisation, fusions, mégafermes, monocultures, endettement: la liste des enjeux s’allonge chaque année. Dans ce contexte, Le Verbe a voulu savoir comment se portait cette génération d’agriculteurs, et à quels sacrifices ils devaient consentir pour répondre à leur vocation de nourrir le monde.

Trouver des agriculteurs pour témoigner, c’est chercher une aiguille dans une botte de foin. Ce n’est pas qu’ils ne sont pas bavards, c’est seulement qu’ils préfèrent se taire plutôt qu’être incompris.
Régulièrement, la nouvelle du taux de suicide anormalement élevé des producteurs agricoles fait la manchette, mais s’arrête-t-on pour comprendre pourquoi? Imagine-t-on le quotidien des agriculteurs en 2023?
Arrêtons-nous devant une ferme de 300 veaux, vaches et cochons. Elle appartient à une famille qui, pour celle-ci, renonce à presque tous ses loisirs, se prive de vacances, et travaille 80 heures par semaine pour 24 000$ par année. On lui demande de remplir nos panses et nos frigos tout en respectant les standards les plus élevés en matière de technologie, d’écologie et d’économie. Cette ferme est une véritable entreprise, mais sans personnel administratif. Les agriculteurs opèrent la machinerie lourde et doivent maitriser l’intelligence artificielle. On exige en plus qu’ils soient gestionnaires de ressources humaines et conseillers en immigration sans leur donner le temps ou les ressources pour se former.
Autrefois, on les appelait des fermiers.
Culture de performance
Il y a moins de fermes aujourd’hui. Celles qui restent sont immenses et manquent de main d’œuvre. «Il y a une financiarisation de la situation agricole qui fait en sorte que [les fermes] sont en compétition les unes contre les autres, avec de très longues heures de travail.» Voilà un aperçu de la situation, selon Vincent Giard, ancien vice-président de Financement agricole Canada. Issu d’une famille agricole de la Montérégie, il connait cette vie: «Les producteurs agricoles sont devenus des PME emportées dans le tourbillon de l’économie de marché. On les a tenus pour acquis longtemps; la pandémie les a ramenés à l’avant-scène.»
Après la Deuxième Guerre mondiale, la surproduction agricole a entrainé une chute des prix, poussant les fermiers vers les villes. L’agriculture de subsistance est ainsi devenue une agriculture de performance. Ceux qui ne sont pas entrés dans le système n’ont pas survécu. Et ça continue.
«Entre 1996 et 2016, 7000 fermes ont disparu du paysage québécois», rapporte Martine Fraser, travailleuse de rang en Mauricie. «Pour certains, c’est difficile; pour d’autres, c’est un soulagement.» Fille d’agriculteurs, Martine Fraser comprend la réalité du terrain. Sa mission est d’établir une relation de confiance et d’apporter son aide dans une foule de petites choses. C’est l’Union des producteurs agricoles (UPA) et l’organisme Au cœur des familles agricoles (ACFA), lequel offre des services psychosociaux de première ligne, qui ont élaboré le projet des travailleurs de rang. Ils sont maintenant dix-huit au Québec.
Selon elle, on ne peut pas tout mettre sur le dos d’une mauvaise gestion. «La majorité des gens n’accepterait jamais ce genre de train de vie pour le salaire qu’il rapporte! Si nous pouvons, chaque matin, vous et moi, nous lever et travailler, c’est parce qu’il y a des gens comme eux. On n’y pense pas. Il y a une déconnexion entre le producteur et le consommateur. Pour plein de monde, les œufs, ça pousse à l’épicerie!»
Ce n’est pas de la mauvaise volonté, précise-t-elle, c’est le système qui est en cause: «On peut gérer la détresse psychologique, mais devant la structure économique, la paperasse, les soucis financiers, l’accessibilité aux terres, les programmes d’aides inadéquats, les pressions sociales et les hausses des taux d’intérêt, je suis impuissante, et c’est frustrant. Le pouvoir est dans les mains des politiciens qui promettent beaucoup et font peu.»
Culture du stress
On s’inquiète chaque jour des dommages causés à l’environnement, mais des dommages affectifs et psychologiques causés aux personnes, qui s’en soucie? Des familles travaillent jour et nuit sous le poids d’une pression sociale et économique constante, elles sacrifient souvent leur vie de couple et de famille, qui en parle? Voilà le genre de question que pose Michèle Salmona, pionnière de la question de la souffrance en milieu agricole, dont les recherches sont rapportées dans la thèse de Ginette Lafleur, directrice adjointe de l’ACFA.

En mai dernier, la chercheure en psychologie Ginette Lafleur a soutenu la thèse : Facteurs de risque et de protection de la santé mentale et des conduites suicidaires des agriculteurs québécois et suisses romands: une étude par méthodes mixtes, UQAM, 405 pages.
Cette thèse est basée sur deux études indépendantes: une enquête par questionnaire autoadministré auprès de 1074 exploitants agricoles québécois et suisses romands actifs en production laitière (fin 2010 – début 2011); une analyse des données documentaires tirées de 93 dossiers de suicide d’agriculteurs entre 1998 et 2013 de façon à identifier les éléments ayant contribué à divers niveaux à leur décès par suicide.
Une trentaine de facteurs de risque et de protection au niveau professionnel, individuel, relationnel, culturel et sociétal qui peuvent mener à des conduites suicidaires sont identifiés par la chercheuse dans le but d’élaborer une stratégie nationale de prévention du suicide.
Pourquoi ces gens travaillent-ils ainsi, dans de telles conditions? La réponse est dans nos assiettes.
Pour Hélène Cadieux, agricultrice à Normandin, être agriculteur, c’est être gambler. D’une année à l’autre, il est impossible de prédire la météo ou la demande du marché. «Les gens peuvent difficilement comprendre. On nous trouve fous, alors on finit par se taire», laisse tomber celle qui a démarré sa fromagerie artisanale La Normandinoise, pour pérenniser la ferme familiale qu’elle opère avec son mari Yvon Fortin.
L’agriculture de subsistance est ainsi devenue une agriculture de performance. Ceux qui ne sont pas entrés dans le système n’ont pas survécu.

«Il y a des choses qui ne se disent qu’entre agriculteurs… Là, c’est une période de sacrifice plus grand. Il faut faire plus d’heures. Il manque de main d’œuvre. Des fois, je me lève à 2h et je me couche à 21h. Ma famille à Montréal, j’aime autant ne pas leur dire le nombre d’heures qu’on fait parce qu’on va faire rire de nous autres!»
Guillaume Paradis, 40 ans, producteur laitier célibataire, aussi de Normandin, a créé un concept de «ferme à partager» qui consiste à s’associer pour échanger des temps de gouvernance, question de se libérer un peu, et de vivre.
«J’arrive à la croisée des chemins. J’aime la terre, le mode de vie. Ça fait dix ans que je développe ce concept. Là, je me demande pourquoi. Mon père a 72 ans. Ma mère 67. Ils travaillent 40 heures par semaine, moi 80… Je ne veux même plus d’une femme qui voudrait travailler 80 heures – ça n’a pas de sens! Pour qu’une ferme fonctionne, ça prend une femme qui travaille pour faire vivre la famille. Tous les fermiers sont pognés comme ça. Tu n’as pas le choix, sinon tu n’arrives pas! Et si je faisais 120 000$, je n’aurais même pas le temps d’en profiter! Ça ferait longtemps que j’aurais une famille, si je n’avais pas de vaches!»
Lisanne et Mathieu ont quitté l’agriculture l’an dernier. Lisanne a refusé de témoigner; l’aventure «a brisé trop de choses en elle». Mathieu, lui, a vidé son sac: «Je gagnais 20 000$ par année. Ma femme me faisait vivre. J’ai sacrifié 20 ans de ma vie pour préserver le patrimoine familial.» Associé avec son père et son frère, il s’est senti exploité. «C’est la plus grosse ferme de la région, sauf qu’on n’a pas de main-d’œuvre. J’en connais beaucoup, de fermes laitières comme ça. Je n’ai jamais pris plus de trois jours de congé. Je n’ai pas souvent vu mes enfants. J’ai connu la dépression. Mon seul regret, c’est de ne pas avoir lâché ça avant. Ma femme me suppliait de quitter la ferme. Notre couple survit. C’est extrêmement difficile.»
Culture du «pas dans ma cour»
Quelles que soient les productions agricoles, les constats sont les mêmes: l’agriculture et les agriculteurs dérangent.
Martine Fraser dépeint la situation en ces termes: «On ne veut pas les voir ni les entendre. La cohabitation est parfois difficile avec les néoruraux. Les tracteurs et les troupeaux dérangent et ralentissent le trafic. On veut manger local et pas cher, mais on ne veut pas que ça se passe près de chez nous. On mange de la viande, mais on leur reproche de faire l’élevage et on leur dit qu’ils maltraitent les animaux.»
Alors que le travail des agriculteurs consiste à nourrir le monde, ce qui est la base même de la vie – faut-il le préciser? – on ne reconnait pas la valeur de leur travail.
Selon une étude 72,5% des répondants travaillent 80 heures et plus par semaine. Un trouble dépressif est diagnostiqué chez 44,3% (31/70) des agriculteurs québécois, toutes productions confondues. L’agriculture de subsistance est ainsi devenue une agriculture de performance. Ceux qui ne sont pas entrés dans le système n’ont pas survécu.
Le manque de reconnaissance est d’ailleurs un facteur important qui contribue à la montée des dépressions et des suicides en milieu agricole. L’ingratitude s’est même transformée en haine, un phénomène appelé «agribashing». Par exemple, en France, l’Observatoire de la santé du dirigeant agricole soulignait que «le monde agricole a assisté à l’émergence d’un courant sociétal fortement dénigrant de l’agriculture et des agriculteurs pouvant aller jusqu’à l’intimidation verbale ou physique. […] 40% des agriculteurs déclarent avoir vécu au moins une situation de harcèlement en 2019».
Culture du contrecourant
Marie Campagna et René Harton ont dû agrandir leur ferme de Saint-Épiphane puisque les enfants ont choisi une autre voie. «Nous avons construit quatre bâtiments avec 5500 porcs en engraissement. C’est beaucoup d’ouvrage, mais ça fait partie du sacrifice qu’il faut faire si nous voulons être rentables», confie Marie. «Nous devons organiser notre entreprise pour qu’elle survive. L’intelligence artificielle calcule l’eau, le calibrage de la moulée, la ventilation. Ça pallie le manque de successeurs.»
Pour leur équilibre de vie, René a construit un chalet sur les terres. «Nous nous y retrouvons en amoureux. Nous avons tout. Une porte patio sur la forêt, une mezzanine. Ce sont nos voyages! Voyager avec six enfants, c’était trop compliqué, en plus que notre dernière est née avec une maladie génétique. Nous avons adapté notre maison pour sa chaise roulante en plus de sa diète qui est très stricte.»
La ferme permet aussi de donner au suivant. «Nous payons un homme qui vient faire la boucherie et nous donnons aux voisins, ou aux communautés religieuses. Ça fait partie du deal qu’on a, René et moi, avec le Bon Dieu!»
À Hérouxville, à la ferme laitière et bovine de Nicolas et Nicole Roland, parents de quatre enfants, ce qui donne du sens à une vie exigeante, c’est l’amour de la terre et la simplicité. «Il faut être mordu. Si tu fais ça pour l’argent ou la qualité de vie, tu ne dureras pas! Ce n’est pas un métier, c’est une vocation!», lance Nicolas, 56 ans, avec sa verve imagée.
«Quand il y a un party avec mes chums, je pars plus tôt pour la traite. Il m’arrive de sacrifier ma messe! Avant, je culpabilisais, puis j’ai compris que travailler avec amour, c’est prier deux fois!»
Pour lui, l’important, c’est de tout mettre en œuvre pour être bien chez soi: «Pas besoin d’aller à Cuba. Trois jours à la maison avec ma femme, c’est le meilleur voyage! Tu répares un petit truc. Tu te fais à manger. Nous faisons notre viande et notre fromage; nous ne voulons plus aller au restaurant parce que nous sommes toujours déçus. Nous invitons les amis. Oui, c’est beaucoup de boulot, nous n’arrêtons pas, mais rien ne vaut la tranquillité d’esprit.»
Et le tourbillon économique? «Nous avons toujours acheté de vieux tracteurs, de vieux pickups. Il ne faut pas entrer dans la game.»
C’est quoi, la game? «La performance! L’autre jour, la publicité de la coop titrait: «La passion de produire». Ils visaient 10 000 litres de lait par année. Ça signifie beaucoup de moulée à faire manger aux vaches, ça. Qui fait les profits? Pas moi! Le truc est d’arriver à faire ton quota sans trop dépenser. Si tu veux faire 100 000$ par année en donnant 60 000$ en moulée, il ne te reste que 40 000$. Ça ne va pas suffire à payer tes frais. Ça donne quoi? L’idée, c’est de traire plus de vaches, avec moins de moulée. Moi, je fais manger mon foin aux vaches, pas de la moulée de la coop! Il me reste 70 000$ dans mes poches. C’est ça, ne pas suivre la game. C’est la meilleure façon de se protéger.»
*
Il n’y a pas si longtemps, chaque famille avait son fermier. C’était ce lien, ce contact, qui nous gardait sur le plancher des vaches. Le suicide n’est que la pointe de l’iceberg. En dessous se trouvent des vies de femmes et d’hommes, qui cultivent le sacrifice, qui donnent leur vie pour nous faire vivre.
Illustrations: Matthieu Lemarchal