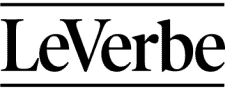En 1989, René Pétillon est condamné à perpétuité pour double meurtre. Ce qu’il découvre de lui-même et de la vie, en dedans, lui rend sa liberté, bien avant qu’il ne sorte du pénitencier. Parcours d’un homme sans espoir, devenu semeur d’espérance.

La nuit où il assassine son compagnon de fortune et la revendeuse qui vient d’entrer, René n’est pas qu’un peu sous l’effet de la drogue; tous ses pores en sont imbibés, chacune des parcelles du peu d’esprit qui lui reste est percutée.
Les médias le saisissent sur le vif alors qu’il sort du fourgon de police, en ce matin du 2 avril 1989. «Le retour de Freddy», «Jason n’aurait pas fait pire!» peut-on lire sous sa photo. Regard perdu, visage maculé de sang, menotté: il a pour seul vêtement une petite couverture blanche que les policiers lui ont laissée après l’avoir fouillé.
Deux jours plus tard, en plein sevrage, il tient à peine debout devant le juge. Pieds nus et sale, encore menotté, avec le sang séché de ses victimes sur ses cheveux, il écoute la description horrifiante de ses crimes. Il s’efforce de se rappeler, mais ne se souvient de rien. C’est le noir total dans sa tête.
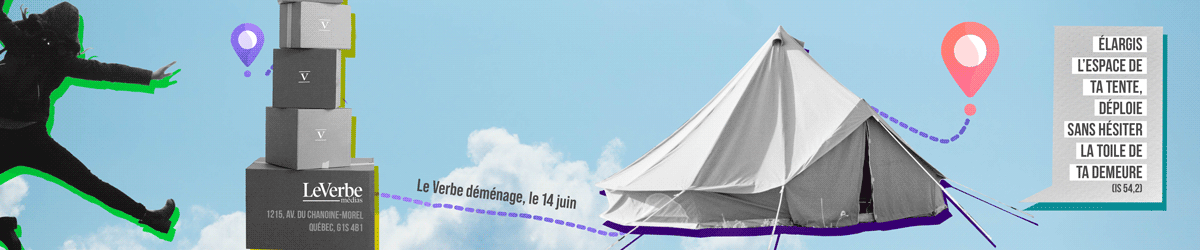
Après neuf jours de piquerie sans dormir, René sort de l’appartement en courant. «J’aurais dû me rapporter à la police», laisse-t-il tomber avec un soupir empreint de tristesse. «J’étais en liberté surveillée. En non-respect des conditions.
En prison depuis huit ans; je ne voulais pas qu’on en rajoute. Je souhaitais plutôt aller en désintox. J’ai appelé des centres; personne ne pouvait me recevoir. L’Hôpital Saint-Luc non plus. Ils m’ont renvoyé en me disant que j’étais correct. Je voulais dormir. Je n’étais plus capable. Je frisais la folie; je me serais piqué n’importe où, et avec n’importe quoi… Au moment où j’ai décidé de me rendre à la police, le gars avec qui je me piquais est passé en auto. J’ai embarqué.»
De retour à l’appartement, ils cherchent la drogue, mais ne la trouvent pas. Jacob accuse René de l’avoir volée. Une escarmouche s’ensuit. Le premier la retrouve. «Il bredouillait des excuses, explique René, mais moi, je bouillonnais de rage en dedans. Il m’a fait deux injections – moi, je tremblais trop. Il criait. Je suis allé à la cuisine et là, j’ai senti quelque chose, je ne sais pas trop. Je me suis senti menacé, comme par-derrière. J’ai pris un couteau et je l’ai poignardé. Je me suis rendu dans le salon. La revendeuse venait d’entrer. Je l’ai poignardée. J’ai dû me dire que je ne voulais pas de témoin… je ne sais pas… mais… je ne les ai pas juste tués… J’étais fou. Ç’a été un vrai carnage.»

Un silence s’installe après la brève description. Le soleil d’automne traverse la porte-fenêtre. Sur le balcon, quelques plants de tomates portent encore leurs fruits. Il fait un peu trop chaud. René frissonne.
— Ces images te hantent?
«C’est flou… La fille, elle – j’en ai longtemps rêvé –, me suppliait de ne pas la tuer…»
René se retrouve dans un bar, assis à une table, où il se réveille brusquement. Il court aux toilettes et se rend compte qu’il est couvert de sang de la tête aux pieds.
— Tu ne te souvenais de rien?
«Non. Je croyais m’être battu. Ce n’était pas la première fois que je me réveillais plein de sang en blackout.»
La police l’arrête alors qu’il déambule en pleine rue. «Quand ils m’ont embarqué, c’était comme si je sortais de mon corps; je voyais, de haut, ma première arrestation.»

À 13 ans, René consomme déjà des drogues hallucinogènes, sans être pour autant un délinquant. Il rentre à 20 h 30 pile, tous les soirs. Une fois, il dépasse l’heure. Par crainte de son père, il ne veut pas revenir. Des copains qui s’apprêtent à commettre un vol l’incitent à les suivre. Pleine aux as, la petite bande quitte La Tuque en train et finit par se faire pincer à Longueuil.
«C’est comme ça que tout a commencé, conclut René. Mes deux frères et moi, on se faisait battre souvent, mais mon père ne s’en souvenait jamais. À huit ans, j’ai vu ma mère se faire battre à coups de pieds au visage… Je pense que c’est là que j’ai perdu tout contact avec le réel, à vivre en dehors de moi, avec un ami imaginaire.»
À 17 ans, après avoir battu son père avec fureur devant ses amis, il quitte la maison pour ne plus jamais y revenir.
À bout de souffle
Ce matin d’avril 1989, âgé de 27 ans, René est condamné à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans.

Quatre ans plus tard, par un matin ordinaire, la panique le saisit à la gorge; son corps lui crie: «Tu ne sortiras plus jamais d’ici!»
Les crises de panique et d’hyperventilation deviennent son lot quotidien pendant neuf ans. Il est si tendu que ses dents volent en éclats l’une après l’autre. Pendant ses crises, il hurle à genoux en suppliant ses geôliers de le laisser sortir. «Les médicaments auraient certainement aidé, mais fondamentalement, mon problème, c’est que je refusais de changer quoi que ce soit en moi», avoue-t-il.
En 2001, il est une loque humaine. On le transfère dans un établissement à sécurité minimale. Les crises s’espacent, mais René ne songe encore qu’à s’évader, à tuer le plus de personnes possible, et à se tuer ensuite. «C’était la folie dans ma tête. Je n’avais plus d’espoir. J’étouffais et je voulais juste que ça s’arrête. J’étais pris avec tous mes mensonges.»
— Et la thérapie?
«Quand t’es en dedans pour des meurtres aussi crapuleux, t’es rempli de remords, en plus de l’infériorité morale que tu ressens devant les travailleurs sociaux, les thérapeutes. J’étais incapable de verbaliser quoi que ce soit. C’était eux contre moi. Il y a eu des personnes qui ont été bonnes envers moi, mais je ne les voyais pas. Je les ai vues après. Je n’étais digne de rien, sauf de mourir. C’était mon discours intérieur, dès mon réveil, depuis toujours.»



Délivrance
Dans la cour du pénitencier, les mains dans les poches, en alerte, René s’agrippe à son sac en plastique dans l’éventualité d’une crise d’hyperventilation. Un gars, pas loin devant, lui fait un signe de la main amicalement. René détourne le regard et s’éloigne de lui. Il ne parle à personne depuis neuf ans, enfermé dans sa prison intérieure, plus imprenable encore que le pénitencier.
Le lendemain, le même homme s’avance et lui tend la main en souriant: «Salut! Comment ça va?»
«Je lui ai donné la main», raconte René, encore ému par cette rencontre. «C’est là que ma vie a commencé à changer. Avant, je ne méritais rien. Si j’avais su que cette poignée de main allait me mener au bonheur, je ne l’aurais pas prise, tellement j’étais persuadé que je ne méritais pas de vivre, et surtout pas d’être heureux.»
L’homme en question est un membre des Alcooliques Anonymes qui vient chaque semaine visiter les détenus. Il accompagnera René à sa première réunion. «Je trouvais ça beau de voir les gars parler, montrer leur vulnérabilité. Moi, j’en étais incapable. Avec le temps, j’ai compris pourquoi j’étouffais.»

Le téléviseur est allumé en permanence dans sa cellule, comme un pansement sur son insoutenable solitude, mais il lui arrivera, pendant de brefs instants, de gouter à quelque chose d’inconnu jusqu’ici: la paix.
«J’avais pris conscience de tout le mal que j’avais fait… et je n’étouffais plus! Je n’avais jamais été aussi libre. Le plus dur?
Ç’a été d’accepter la grâce d’être heureux.»
Après une année complète à écouter les autres et à parler de soi, René se met soudainement à pleurer, un matin, pour la première fois de sa vie. «Tout a crashé en dedans. Puis, j’ai entendu: “Ta vie peut changer.” Soudainement, je me suis senti envahi par cette espérance-là. Je suis sorti de la wing [l’aile de la prison] et, par les fenêtres de la cafétéria, je voyais les arbres et toutes les nuances dans les feuilles… Je voyais la vie! C’était une illumination! Depuis ce jour, c’est simple, je veux juste aimer. Je n’ai plus de haine. C’était facile tout d’un coup de croire en quelque chose.»
— Peux-tu l’appeler «Dieu»?
«Oui. Je n’avais pas accès à Dieu. Avant, je ne voulais rien savoir. Maintenant, je sais que je ne comprenais rien; je priais certainement Satan! Jésus, lui, c’est l’amour. Il est venu nous dire qu’on avait accès à ce à quoi il avait accès. Pour nous aussi, c’est possible. Il est venu détruire mon ordinateur intérieur, qui répétait que je n’avais pas droit à la vie, à l’amour, à la paix.»
Tout s’enchaine par la suite. Il démarre un atelier de méditation et un journal pour les détenus. L’idée de quitter la prison se volatilise. «J’avais pris conscience de tout le mal que j’avais fait… et je n’étouffais plus! Je n’avais jamais été aussi libre. Le plus dur? Ç’a été d’accepter la grâce d’être heureux.»

Il fait ensuite une première sortie sans menottes, pour les funérailles de sa mère. Peu de temps après, à la cafétéria, un codétenu raconte qu’il revient d’un rendez-vous avec un prêtre, qu’il participera à un face-à-face en justice réparatrice. René se sent interpelé. «Je suis parti direct voir le prêtre. Quelques semaines plus tard, je rencontrais une femme dont le fils avait été assassiné. En tant qu’agresseur, je te dis que je n’étais pas gros dans mes souliers. Pour elle, entrer dans un pénitencier, faire cette démarche, c’était très impressionnant.»
Au fil des rencontres, ils apprennent à voir la société comme une grande courtepointe. Quand un crime est commis, un trou se crée dans la courtepointe et les conséquences peuvent être funestes. Nous avons tous la responsabilité de nous unir pour réparer la déchirure.
«On était là pour réparer, poursuit René. La dame racontait que c’était la première fois qu’elle se sentait entendue. Avant, elle fréquentait un groupe composé uniquement de victimes, où l’on versait souvent dans le ressentiment. Là, c’était différent. Son visage se détendait à chaque rencontre. Elle perdait la charge émotive qu’elle avait ravalée pendant vingt ans. Il y avait eu des impacts négatifs sur sa propre famille. On prenait conscience de toutes les répercussions sociales, aussi.»
René sort de ces rencontres transformé. Il n’y a pas eu d’illumination ni de grand pardon, mais il en ressort libéré, lui aussi, de cette charge émotive qu’il a entretenue sa vie durant. «Ça m’a permis de sortir de mon état de “victime”. C’est comme ça que j’ai vécu un second réveil spirituel.»

Libérations
En 2006, René vit deux miracles: il est libéré, sous conditions évidemment, et il se réconcilie avec son père.
«Mon père venait d’entrer à l’hôpital. Depuis toutes ces années, j’avais tué mon père un million de fois dans ma tête, mais maintenant, je n’étais plus le même. J’ai décidé d’aller le visiter. La dernière fois qu’on s’était vus, je l’avais battu. Une fois devant lui… je l’ai serré dans mes bras… J’ai dit: “Merci, papa. Merci de m’avoir donné la vie, c’est le plus beau cadeau que j’ai jamais eu.”»
En pleurant doucement, René raconte qu’il a pris soin de son père jusqu’à la fin. «Je l’ai aimé, cet homme-là. J’ai réussi à lui parler avec ce qui est Dieu en lui. J’allais le voir, je lui coupais les cheveux, la barbe. Je me suis occupé de lui du mieux que j’ai pu.»
Ce pardon envers son père, c’est une autre grâce. Trois ans après sa libération, les autorités invitent René à être intervenant accompagnateur auprès de condamnés à perpétuité pour l’organisme Option-Vie. (Le groupe formé d’anciens condamnés à perpétuité travaillait à la réinsertion sociale d’autres criminels en partenariat avec le Service correctionnel du Canada, la Commission nationale des libérations conditionnelles et des organisations non gouvernementales. Créé en 1991, Option-Vie a été aboli en 2012 à l’initiative du gouvernement fédéral.

Il aide alors ceux qui ont commis les plus horribles crimes. Il les serre dans ses bras; eux fondent en larmes. «Dans leur tête, ils sont des monstres. Moi, je les aime. Il y a quelque chose en moi qui s’est installé, qui est plus fort que moi. C’est ce qui fait que je suis capable de les aimer, pas moi.»
«La poignée de main dans la cour du “pen”, elle n’était pas la première; elle était la centième! C’est elle qui m’a tiré du trou, grâce à toutes les autres qui l’ont précédée. Comme une grande chaine. Je leur suis toutes redevable.»
Même si René est libéré depuis dix-sept ans, chaque nouvel employeur doit faire enquête. René ne sera jamais complètement libre. Il le sait et il l’assume. Ses employeurs lui font confiance, malgré son passé. «Ce sont les conséquences de mes actions. Je ne devrais même pas être dehors! Quand je suis porté à m’apitoyer, je pense aux victimes… Je suis en vie, moi, alors que je les ai tuées! Je ne peux pas me plaindre!»
Lors de sa révision judiciaire en 2004, il aperçoit la mère et la fille de la femme qu’il a assassinée. Leur douleur semble aussi vive qu’en 1989. René souhaite encore ardemment qu’elles puissent connaitre le pardon. Pas pour lui, mais pour elles-mêmes. «C’est le seul moyen par lequel elles pourraient se libérer de moi», confie-t-il, ému.
— Et toi? Est-ce que tu t’es pardonné?
«Au point de dire: “Ah! je me suis pardonné”? Non. Et ce n’est pas si important que je me pardonne à moi-même. Je sais que Dieu m’a pardonné. C’est ça l’important.
«Avant, je ne voulais pas faire d’entrevue comme on fait là. Je ne voulais pas afficher mon bonheur. J’ai tellement travaillé fort pour essayer de me racheter! Et puis, finalement, je me suis aperçu que ça ne m’appartenait même pas, tout ça. Si Dieu m’a pardonné, je n’ai plus besoin de courir partout pour me racheter.»