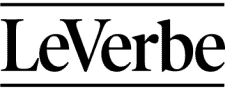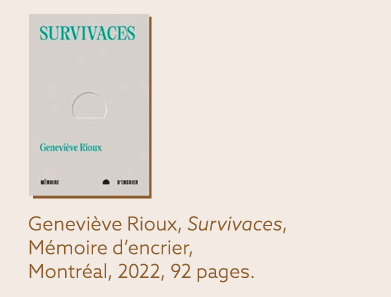Sur les tapisseries du café où nous nous rejoignons, des fougères, vivaces et résilientes comme la poétesse devant moi, feutrent le décor. Je sors mon calepin, puis démarre l’enregistrement. La voix et le regard sereins de Geneviève Rioux ne laissent en rien transparaitre l’agression d’une rare violence qu’elle a vécue il y a quelques années. Ils concordent toutefois parfaitement avec l’histoire d’une femme qui a transformé une nuit d’horreur en puissance créatrice.
Dans ton recueil de poèmes, tu fais référence à un évènement survenu alors que tu étais enfant et qui t’a préparée à ce qui allait suivre dans ta vie. Qu’est-ce qui s’est passé?
Quand j’avais sept ans, dans la nuit, un individu s’est introduit dans notre maison familiale. Ma sœur et moi dormions au sous-sol, ma mère dormait à l’étage et mon père était absent pour le travail. L’agresseur lui donnait des ordres, ma mère s’est débattue, elle a réussi à sortir de la chambre puis finalement elle a crié, ce qui a fait fuir l’agresseur. Ma mère n’a jamais vu son agresseur, il n’a jamais été traduit en justice.
Jeune adulte, j’ai commencé à consulter. En thérapie, je travaillais beaucoup sur le sentiment d’insécurité qui était vécu dans famille. Je me souviens que la toute première psychologue que j’ai rencontrée en thérapie m’avait dit: «Tu sais, Geneviève, il ne s’est rien passé depuis 15 ans. C’est un peu excessif d’avoir peur 365 jours par année depuis tout ce temps-là.» Les chances que ça arrive sont minces.
Pourtant, dans la nuit du 7 avril 2018, c’est arrivé de nouveau.
Je rentrais du travail, j’étais bien fatiguée parce que j’avais eu une grosse soirée la veille. Je me suis couchée directement, je me suis endormie comme une buche.
Je me suis réveillée parce que j’ai entendu mon plancher grincer et j’ai vu un individu foncer sur moi. Il était cagoulé, habillé en noir. J’étais assez déboussolée du fait que je venais de me réveiller. Il s’est tout de suite mis à me donner des ordres. J’ai essayé de savoir qui c’était, sa voix me disait quelque chose. Il a rapidement compris que je ne collaborerais pas, donc il s’est mis à me frapper au visage avec une lame. Rapidement, j’avais beaucoup de sang au visage, ma vision était troublée, je ne voyais plus rien.
Un combat s’en est suivi. J’ai réussi à le pousser, à me lever. Il m’a rattrapée, il m’a lacérée encore. Je l’ai supplié de me laisser partir. On s’est battus. J’ai réussi à m’accrocher au cadre de porte, puis à me projeter dans les escaliers, et j’ai déboulé les marches. Rendue en bas, il m’a étranglée et j’ai perdu connaissance. Alors qu’il pensait que j’étais morte, il s’est poussé.

À mon réveil, quelques instants plus tard, j’étais sure que je venais de faire un cauchemar. J’ai réussi à remonter les escaliers à quatre pattes. Je me suis dit: «Si je ne fais rien, je vais me vider, personne ne viendra m’aider, je vais mourir.» Je ne voyais plus rien parce que j’avais perdu trop de sang. J’ai réussi à traverser mon appart’ à tâtons, à pogner mon cell sur ma table de chevet; je me suis écroulée au sol et j’ai appelé le 911. La police est arrivée tellement vite que je pensais qu’il revenait. J’étais encore au téléphone avec le 911. J’ai dit: «Il est revenu, j’ai entendu une porte.» Finalement, après quelques secondes, on a crié: «Police» et j’ai dit que j’étais en haut.
Les ambulanciers sont arrivés au bon moment pour arrêter la perte de sang. J’ai perdu beaucoup de sang. Du fait que j’étais nue, il y en avait partout. Il n’y avait aucune partie de mon corps qui n’était pas couverte de sang, c’était une scène d’horreur.
Arrivée à l’hôpital, je puais la mort, j’étais vraiment une morte vivante.
C’était tellement miraculeux d’être encore en vie que, à l’hôpital, j’étais dans ma force de vie, dans une espèce d’humour particulier qui déstabilisait tout le monde autour de moi. C’était un mélange de drogues et d’adrénaline. C’est un peu comme l’armistice, quand on finit une guerre. On fête même si on a tué du monde, même si on vient de vivre les pires traumatismes de notre vie. On a survécu. Je me suis dit: «Il faut que je fasse de quoi avec ma vie, je ne peux pas rien faire.»
D’ailleurs, tu en as fait un puissant recueil de poésie intitulé Survivaces. Comment les gens autour de toi ont-ils accueilli ton récit?
Les jeunes hommes sont bien intimidés par ce récit. Je ne pense pas que tous les hommes sont des agresseurs potentiels. C’est un peu le message de société qui est livré en ce moment. J’espère qu’on va déboucher sur un message plus positif sur la canalisation de l’agressivité, parce que l’agressivité, ce n’est pas mauvais en soi, ça en prend. Ça en prenait pour me défendre. Ça en prend aussi pour créer, pour avoir une relation sexuelle; c’est une énergie, l’agressivité, ce n’est pas négatif en soi. C’est la violence qui est négative. J’espère qu’on va être capable de parler d’agressivité sans avoir l’étiquette de la violence, pour que les jeunes hommes puissent se sentir à l’aise avec leur testostérone.
Ce que je trouve un peu dommage aussi, c’est que certaines femmes [qui ont déjà été agressées] vont se sentir un peu écrasées: «Toi, tu as combattu et pas moi; je ne sais pas comment tu as fait pour traverser ça.» C’est dommage parce que c’est le travail de toute une vie. C’est arrivé en 2018, mais je ne travaille pas ça depuis 2018, je travaille ça depuis l’âge de sept ans, le rapport à l’agression. Selon moi, il n’y a pas de mauvaise réaction: c’est tout à fait normal, face à un ours, de figer, c’est même souhaitable de faire le mort. Il y a un instinct de protection, de se détacher de son corps. On n’est pas moins bon, moins courageux, c’est un instinct de survie comme un autre. C’est la menace qui n’est pas normale, pas la réaction de la victime.
Tu étudies maintenant au doctorat en psychologie. Comment vois-tu le rôle de la liberté humaine, de l’âme (psychè en grec)?
Pour bien des gens, la question qui se pose c’est: «En quoi peux-tu avoir foi après un tel évènement?» Il y a quelque chose de l’ordre de la foi en l’humanité. Pour moi, ça passait vraiment par mon réseau immédiat. Combien d’hommes et de femmes m’ont tendu la main après ça! Je ne peux pas faire un entonnoir et réduire ça au mal que j’ai vécu.
Juste pour revenir sur la question du mal, je ne peux pas être naïve, je sais que le mal existe. Mais il y a de la beauté à plein d’endroits, et cette beauté, elle gagne. Je décide qu’elle gagne parce que je ne pense pas que le monde, en soi, est complètement bon ou complètement mauvais. Il y a des pulsions de vie et des pulsions de mort, mais l’être humain a besoin de sens aussi, c’est vital et ça en fait partie.
« Je sais que le mal existe. Mais il y a de la beauté à plein d’endroits, et cette beauté, elle gagne. »
Dans le christianisme, les cicatrices du Christ sont le signe d’une violence atroce envers un innocent, d’une violence gratuite. Mais les évangiles rapportent que, lorsque Jésus ressuscite, les marques sont encore là dans ses mains, ses pieds, son côté. Quel est ton rapport à tes cicatrices?
Dans mes mots, je dirais plutôt: «Thug life!» Comme des traces d’une vie à la dure, mais je les assume. Au début, c’était très laid. À l’hôpital, quand je me suis vue dans le miroir après trois jours, je ne me suis pas reconnue. Toutefois, elles ont bien guéri et j’ai eu un bon plasticien. La dernière fois, il m’a dit: «Ah! je pensais que tu avais des plis d’oreiller dans le visage.»
En même temps, il y avait une fierté qui ressort de cela, d’avoir gagné contre la mort. Je ne m’identifie vraiment pas à Jésus Christ, mais je me suis sentie un peu en résurrection. Une espèce de sentiment de victoire, d’armistice.
Qu’est-ce que ça te fait de raconter ton histoire?
Ça ne me met pas dans un espace traumatique quand j’en parle, je suis bien à l’aise. Au contraire, je ne veux pas qu’il y ait de tabou; c’est une des choses les plus importantes.
Dans ma démarche, c’est surtout important de parler de ma réparation, qui ne passe pas par le système de justice; ne pas mettre l’accent là-dessus, ça démontre bien qu’il y a quelque chose à faire avec une expérience comme ça, même si le système est défaillant.
« Devant l’adversité, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse surmonter seul. »
Ce qui m’aide à donner du sens, c’est que ce n’est pas tant le résultat qui compte, plutôt que le processus que je traverse. Être accompagnée par mes proches, c’est ce qui est important depuis le début. C’est propre à différentes démarches, mais, devant toute adversité, il n’y a pas grand-chose qu’on puisse surmonter seul. L’humanité que j’ai sentie autour de moi est réparatrice.
Après les évènements, j’ai été hébergée par Mario et Mylène, qui sont l’oncle et la tante de mon ex-copain. J’étais censée vivre là pendant cinq jours. Finalement, j’ai habité là cinq mois. Je les côtoie encore régulièrement chaque semaine. Ils n’ont jamais eu d’enfants. Pour eux, je suis leur «enfant de cœur» aussi. Il y a de quoi de puissant dans ça.
Est-ce que tu penses au pardon?
J’ai aucune idée où je peux être par rapport à ça, je ne sais pas. C’est bizarre parce que, d’un côté, je ne suis vraiment pas quelqu’un qui vit dans le ressentiment. Pour moi, la vengeance, ça ne m’effleure vraiment pas l’esprit. D’un autre côté, comment je peux pardonner à quelqu’un qui n’a pas reconnu la faute? Ce n’est pas que je ne veux pas. En psychologie, on appelle ça des unfinished businesses, qu’on n’arrive pas à boucler.
Aussi, à deux reprises récemment, j’ai fait une lecture de mon recueil dans des églises. Cet été à la Grande nuit de la poésie de Saint-Venant, et cet automne lors d’un hommage de Gilles Vigneault, j’ai lu des passages de Survivaces. Il y a dans une église quelque chose de sacré qui donnait une ambiance vraiment intéressante.
J’ai été baptisée; dans ma vie, il y a comme quelque chose d’un passage. À Saint-Venant, c’était la première fois que je «performais» le recueil; l’église était pleine, il y avait quelque chose de puissant dans ça. Dans cette performance, à cet endroit spécial, je voyais des évocations fortes en lien avec la réparation, le pardon.