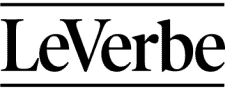Une punk dans les salons du livre, c’est presque un chien dans un jeu de quilles. Sauf qu’Emmanuelle Pierrot, malgré son look de dure à cuire, ne mord pas. Bien au contraire, attablée au stand de la maison d’édition Le Quartanier, elle dédicace, tout sourire, des exemplaires de La version qui n’intéresse personne, son premier roman paru l’automne dernier. La lauréate du Prix littéraire des collégiens et du Prix des libraires cherche désormais à composer avec sa nouvelle vie publique… À mille lieues des bécosses sauvages du Yukon.

Le Verbe : Ça va mieux ?
Emmanuelle Pierrot : Je suis juste contente d’être allée dans une toilette où personne ne me parlait. Pendant le Salon du livre, même aux toilettes, je me faisais reconnaitre. Le monde est là : « J’ai vraiment aimé ton livre. » Puis je suis comme : « Je veux juste chier, genre. » Je ne veux pas me vanter. Toutes les autres fois dans ma vie où je suis allée aux toilettes, à part dans les deux derniers jours, personne ne m’a parlé, donc ça ne va surement pas devenir comme ça. Je ne suis pas Taylor Swift.
Comment te définis-tu ? Est-ce que tu te considères comme une artiste ? Une militante ? Une punk ?
J’ai l’impression d’être marginale, mais je suis comme persuadée que tout le monde a l’impression d’être marginal aussi. Mon but, c’était de vivre dans la société, mais j’ai eu beaucoup de difficulté au début. Je me heurtais tout le temps à des murs, c’était vraiment tough. J’ai pris chimie, maths et physique en 4e secondaire; j’ai tout coulé. Après ça, j’ai essayé d’avoir des jobs; je me suis tout le temps fait renvoyer. J’ai essayé d’être sédentaire pendant longtemps; ça ne marchait pas. J’ai fait deux retours aux études; ça n’a jamais marché, je n’ai jamais décroché de diplôme.
À un moment donné, j’ai comme compris que j’allais être nomade toute ma vie, et que mon pied-à-terre, ce serait Dawson au Yukon. C’est le paradis des marginaux. Je vivais dans une cabane, je n’avais pas d’électricité, je n’avais pas d’eau courante. Il y a deux-mille habitants, et tout le reste, c’est la nature sauvage. Je trouvais que c’était ça, la vraie vie. Après, tu reviens en ville et tu trouves que tout est dénaturé, bétonné, clôturé. Pour vivre dans un monde dénaturé, il faut que tu le sois aussi. L’aliénation était tellement grande que je devenais rapidement dépressive.
Je me considère comme quelqu’un qui ne se reconnaissait pas dans la société qu’on lui proposait. Je suis allée en chercher une où j’avais ma place. Mais j’ai finalement dû partir. Il n’y a aucune communauté parfaite. Ça va être dur partout, je pense. C’est dur d’être un humain, c’est dur de vivre en communauté. Puis moi, à un moment donné, j’ai plafonné dans cette communauté. Il a fallu que je parte, j’étouffais. Mais maintenant, je veux y retourner plus que tout. Il faut juste que je prépare un peu mon retour.
Avant d’aller à Dawson, est-ce que tu croyais que ça allait être le paradis sur terre ?
Je n’avais aucune attente, parce que je ne connaissais pas. Je me suis retrouvée là un peu par hasard. En arrivant, je trippais parce que personne ne me regardait croche. Je ne me sentais pas sale, inadéquate. On m’a engagée tout de suite. Tout était possible. Je n’avais plus honte de rien : de comment je parlais, de ce dont j’avais l’air, de mes odeurs. Tout le monde me ressemblait et voulait la même chose. J’y ai trouvé ma place, alors j’ai décidé de rester.
En vivant sept ans là-bas, tu vois plein de choses et tu te dis que c’est vraiment plus de la merde que ce que tu pensais. Mais tu te dis aussi que Montréal, c’est pire. Tant qu’à me faire chier quelque part, je préférais me faire chier là. Je n’aimais pas la vie. J’ai tout le temps été un peu nihiliste. Mais être nihiliste, ça ne te protège pas contre les violences systémiques. À un moment donné, tu peux bien te dire que tu te fous de tout, mais quand tout le monde se revire contre toi, il faut quand même que tu partes.
On ne sait pas exactement ce que tu as vécu là-bas, mais le livre, du moins, ne se termine pas dans l’amertume ou la colère. On sent presque un pardon envers les personnages.
Je n’ai pas d’amertume. Ce sont des personnages que la lectrice, le lecteur vont côtoyer pendant 368 pages. Moi, c’est ma famille. Ce sont des gens que j’ai côtoyés pendant sept ans. Quand tu parles de ta famille, même si tu décris les erreurs que des membres ont faites – ou même des atrocités, de la violence –, c’est quand même ta famille. Je ne pense pas que je les excuse, parce que j’ai raconté sans filtre ce que chaque personne a fait. Mais je les aime toutes, je ne vais jamais arrêter de les aimer.
Te considères-tu toujours comme nihiliste ? Si oui, qu’est-ce qui te motive à te lever le matin et à faire ce que tu fais ?
C’est une bonne question. J’ai longtemps pensé que j’allais mourir à 27 ans, après avoir tout essayé pour être heureuse. Après, moi, j’ai quand même une passion, l’écriture, qui a tout le temps été présente. Une envie irrépressible d’écrire à tous les moments de ma vie. Même hospitalisée, j’ai déjà négocié pour avoir accès à mon laptop parce que je voulais écrire. Dire que c’est ma raison de vivre, c’est trop fort, mais c’est quand même un ancrage, même quand je ne vais pas bien.
« J’ai deux ou trois personnes en qui j’ai confiance, et ces liens font en sorte que je ne peux pas dire que je suis nihiliste. Ils sont précieux. Aussitôt qu’il y a des choses qui sont précieuses dans ta vie,
tu n’es pas tout à fait nihiliste. »
Sinon, en ce moment dans ma vie, ça va quand même bien grâce à quelques relations significatives. J’ai deux ou trois personnes en qui j’ai confiance, et ces liens font en sorte que je ne peux pas dire que je suis nihiliste. Ils sont précieux. Aussitôt qu’il y a des choses qui sont précieuses dans ta vie, tu n’es pas tout à fait nihiliste. L’être pleinement, c’est dire que tout est de la merde, que rien n’est une raison de vivre et que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue. Si j’apprenais en ce moment que je devais mourir aujourd’hui, je serais quand même triste, alors je ne suis pas nihiliste. Je ne le suis plus. Il y a des choses qui m’apportent du bonheur.
Comment fais-tu pour concilier ce que tu es en train de vivre – les salons du livre, les prix, etc. – et le fait que tu te sois toujours considérée comme « hors système » ?
Moi, si j’avais eu le choix, j’aurais choisi d’être dans le système. Ça n’a jamais été un choix. C’est juste que le système me rejetait. En ce moment, on ne me demande pas de me dénaturer, surtout à ma maison d’édition, qui est super. Ils ne m’ont pas refusée parce que je n’avais pas de parcours universitaire en littérature, même si j’ai sans doute créé un manuscrit avec beaucoup d’imperfections qui est plus exigeant pour eux.
Je me fais un peu chier dans les salons du livre à cause de la sensation d’être dans un centre commercial, mais c’est très peu de jours dans l’année. Ce qui compense tout ça, c’est que tu rencontres des gens qui sont passionnés de littérature, qui ont des histoires à partager ou qui veulent juste te dire : « ton histoire m’a touché ». Ce n’est pas du tout en contradiction. Je suis capable de recevoir, de m’assoir derrière un stand et d’entendre des gens me dire qu’ils ont aimé mon livre. Ce n’est pas très difficile.
Le fait que je sois sortie de l’underground, c’est vraiment cool, mais tant que je vais pouvoir écrire et qu’il y aura quelques personnes avec qui je vais pouvoir partager, ça va être nice. Au pire, je me mettrai sur le « BS », je retournerai sur le chômage, je redeviendrai guide. Je n’ai pas de garantie que je vais pouvoir vivre de la littérature, je ne suis pas autrice de romans policiers.
Pour moi, c’est vraiment important de garder un lien avec ma communauté, avec des gens qui n’ont aucune idée de ce qu’est le Prix littéraire des collégiens, qui n’ont aucune idée de qui sont les auteurs connus en ce moment. Ça fait du bien de se rappeler que, pour bien du monde, le milieu littéraire n’existe pas.
En revenant du Yukon, je suis allée habiter dans un genre de punk house où je me suis fait des amis. Ça fait en sorte que je peux garder des liens avec des personnes qui sont critiques du capitalisme et qui valorisent un peu plus l’entraide, même si tout est très imparfait. On a quand même tous des iPhones. Ce n’est vraiment pas à la hauteur de nos idéaux et on est tous un peu incohérents, mais il y a certaines valeurs de base qu’on partage qui me tiennent sur terre, qui me font vraiment du bien.