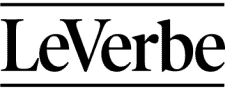David B. Ricard est un artiste difficile à classer. Jonglant avec la vidéo, le théâtre, la danse et la performance, il les combine en un tout organique. Par ses essais documentaires, il déroute le spectateur. Et les thèmes qu’il aborde ne sont souvent qu’un prétexte pour partager son introspection, ses questionnements existentiels. Son plus récent long métrage, David contre Goliath, à la manière d’un journal intime, ne traite pas seulement des films inaboutis qui le hantent. Il nous rejoint aussi à travers une adaptation originale du récit biblique: c’est le combat contre nos propres Goliath.
Le Verbe: Tu t’es filmé presque tous les jours, durant six ans, pour réaliser ce film. Le processus créatif ayant abouti à ton long métrage Surfer sur la grâce a aussi été très long. Comment caractériserais-tu ta démarche artistique?
David B. Ricard: Je m’intéresse à l’intime, à ce qui se passe à l’intérieur, à ce qui est petit, ce qui semble anodin. C’est ce qui fait en sorte que les sujets ne sont pas trop en dehors de moi.
J’ai besoin d’être dans des processus qui me font du bien, dans lesquels j’ai l’impression que c’est vrai, que je n’ai pas à faire semblant d’être quelqu’un d’autre, de me faire violence ou de faire violence à quelqu’un.
Il y a parfois de la déception par rapport à mes sujets. Avec mon film Surfer sur la grâce, les gens s’attendaient à voir un film de skate. Le sujet m’a plutôt permis de réfléchir à quelque chose de plus grand, de partager des constats sur moi-même.
Tes films sont le fruit d’une démarche d’introspection, voire d’une quête spirituelle?
Il y a dans le genre de l’essai un processus autoréflexif qui porte un questionnement sur ce à quoi sert l’acte de créer.
L’introspection, c’est prendre un temps pour ritualiser le regard tourné vers l’intérieur. En installant le matériel de son, en configurant ma caméra pour faire la mise au point, je sais que mon attention va servir le moment, être au service de quelque chose de plus grand que moi. La quête spirituelle, oui, je pense que c’est là-dedans.
Dans ces moments-là, il se passe des choses qui me surprennent, et j’essaie de me mettre dans un état pour les remarquer, les recevoir et dialoguer avec elles.
L’introspection qui vient après l’élément filmique et qui permet de m’analyser, j’essaie de la vivre avec bienveillance. Quand je me mets en scène, ça peut être un couteau à deux tranchants. Souvent, les gens ne s’aiment pas à l’écran. Au lieu de développer de la haine envers moi-même, j’essaie de développer un amour. Ce n’est pas du narcissisme, je ne le fais pas pour mon image. Mais parce que ce n’est pas facile de s’aimer.
Comme pour la photo de la couverture de ce magazine, où j’ai un effort à faire pour ne pas essayer de contrôler mon image… [rires]
David contre Goliath est né de l’angoisse de voir trois de tes films inachevés, relégués aux calendes grecques. On voit des extraits de ces films comme des fantômes qui te hantent. Tu rencontres tes anciens collaborateurs à qui tu n’as jamais donné suite. Le tout est entrecoupé de chapitres du récit biblique que tu interprètes. Pourquoi?
Je voulais faire du cinéma muet, avec beaucoup de métaphores. Le récit de David contre Goliath, c’est un mythe fondateur. Beaucoup de symboles m’interpelaient dans ce récit et font sens encore aujourd’hui.
Pour moi, Goliath est à l’intérieur de nous. Il représente ce qui nous met des limites, nous donne l’impression que le moindre obstacle devient une montagne. Il n’est pas si sophistiqué que ça. C’est davantage un construit que l’on se fait. Mais si on use de ruse envers nous-mêmes, on est capable de l’abattre.
David représente ce que l’on n’attend pas. On ne s’attend pas à ce que quelqu’un aille se battre, à cette époque-là, avec un lance-pierre dans un combat au corps à corps. Qu’il ne mette pas d’armure, alors qu’il est le plus petit, qu’il n’a jamais été entrainé pour aller à la guerre.
Sa seule chance était de le battre à distance. Il a donc utilisé son lance-pierre, ayant l’habitude de s’en servir pour tuer des ours et des lions. Il a usé de ruse.
Oui, il a eu l’aide de Dieu, mais ce n’est pas un Deus ex machina. Mon interprétation, c’est que oui, il faut rester humble et reconnaitre qu’il y a des choses qui nous dépassent. Mais dans nos actions, on a accès à des possibilités. En faisant confiance et en ayant la foi, David a été capable de rassembler les éléments qui l’amèneraient directement vers une victoire.

En allant vers tes anciens collaborateurs, tu tentes de te réconcilier avec toi-même, avec eux. Qu’est-ce que le pardon pour toi?
Parfois, je peux avoir du ressentiment, sentir que quelqu’un agit moins bien, et ça me rend mal à l’aise. Je rétrécis un peu mon amour pour la personne ou ma manière de le voir. Mais ce n’est pas le genre de regard que j’ai envie de poser sur mes amis ou sur mes collègues.
Le pardon, pour moi, c’est ne pas laisser ce rétrécissement-là déterminer notre regard. C’est donner une chance et croire que la personne dépasse mon jugement. C’est en faisant ça qu’on permet probablement à l’autre personne de le faire aussi. Les personnes le sentent quand on les catégorise.
Quand il y a comme une ombre sur le cœur, puis qu’on réussit à y mettre de la lumière, j’ai l’impression qu’il y a du pardon. Il y a plusieurs façons de le faire: la gratitude, la vulnérabilité ou la créativité en sont de bonnes pour moi.
Dans ta démarche artistique, le combat contre Goliath est aussi un combat contre les conventions de l’industrie du cinéma. Comment fraies-tu ton chemin, comme artiste qui se veut authentique, dans ce milieu très compétitif?
Dans mon film, il y a une scène où David tombe avec l’armure du roi et se rend compte, étant tombé, qu’il voit les personnages à l’envers. Ça lui fait voir le monde à travers un autre regard, c’est comme une nouvelle étape dans son parcours.
Ça me fait penser aux conventions du cinéma. Je me dis que je n’en ai pas besoin pour faire des films, comme David n’a pas besoin d’armure pour se battre.
Mais il n’y a jamais de liberté complète. Une institution qui facilite la production de quelque chose va nécessairement imposer des limites. Je ne m’empêche pas de tourner quand je n’ai pas d’argent, mais ça m’use beaucoup, et ça use tout le monde à qui je le demande. J’ai fait mon film Vocalités vivantes en un an et demi. Être dans un rythme où tu n’as pas tellement d’autoréflexion et de recul, ce n’est pas mon rythme.

C’est clair que dans l’industrie – si on parle [du soutien fourni par des organismes comme] la SODEC ou Téléfilm Canada –, on voit beaucoup de biais. Elle déploie des efforts pour susciter plus de diversité, mais il reste que la fiction est plus représentée que le documentaire, ou le cinéma de Montréal plus que celui des régions.
J’ose croire qu’il existe des manières de faire. Je n’ai pas l’impression de m’émanciper de l’industrie, mais d’en faire partie, un peu en marge.
Ton film se termine par un geste de gratitude, devant un miroir qui prend la forme d’une étoile de David. Que représente ce symbole, qui revient à quelques reprises dans ton film?
Au début de mon film, je dis que je travaille trop, que j’ai besoin de sortir cette lourdeur de moi. Dans le milieu des arts, j’ai eu à travailler parfois 120 heures par semaine durant des mois.
La fin du film montre que j’ai fait ce parcours d’affronter mes peurs pour me sortir de cette anxiété-là, de la paranoïa, de la charge qui venait avec la responsabilité de ne pas avoir fini quelque chose. C’est là que je suis allé chercher l’image de David, pour combattre avec courage en disant: «Advienne que pourra, envoyez-moi tous les coups que vous voulez!»
Dans l’étoile de David, il y a un triangle qui pointe vers le haut et un autre vers le bas. La merkabah, en hébreu, c’est un symbole qui veut dire sur la terre comme au ciel. Entre le spirituel et le concret.
Nous, on se situe entre les deux, au milieu. C’est là que ce symbole est vraiment intéressant. Ne pas rester avec le poids des fantômes et des peurs sur mes épaules, mais ne pas non plus être le surhomme invincible.
Dans ton long métrage, tu rencontres ta grand-mère à sa résidence, avant sa mort. Vous visitez ensemble la chapelle et la salle de cinéma. Que voulais-tu montrer avec ces deux scènes mises en parallèle?
L’autel d’une chapelle, c’est un endroit de recueillement, comme l’est, en un certain sens, une salle de cinéma pour moi. S’arrêter pendant deux heures pour écouter un travail d’écriture, je trouve qu’il y a un rituel là-dedans, comme l’acte de créer.
Ma grand-mère, c’est aussi la seule personne qui m’a amené à l’église durant longtemps. J’y allais l’été, le dimanche, quand on allait au chalet avec elle. Mon frère préférait aller se baigner. Moi, je trouvais quelque chose de vraiment beau dans ce recueillement-là. Il n’y avait pas beaucoup d’endroits où je pouvais, à cet âge, faire de l’introspection.
Outre les dorures et les grands espaces d’une église, on sent qu’un lieu a été sacralisé. Vivre dans des lieux qui sont constamment profanes, je pense que ça nous coupe de quelque chose.
+ La première du film aura lieu durant les Rencontres internationales du documentaire de Montréal, du 17 au 28 novembre.