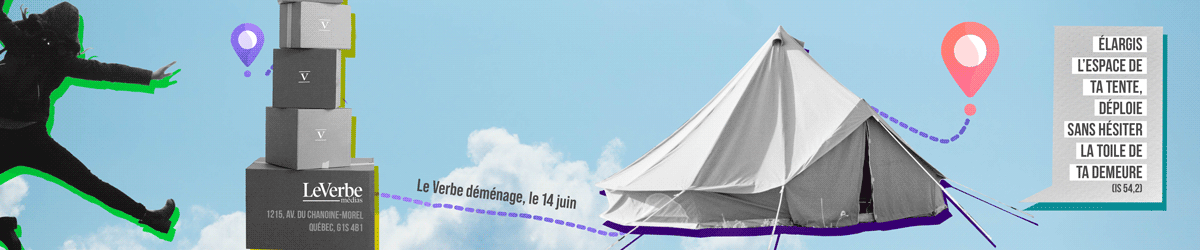
En 1968, Robert Charlebois, Yvon Deschamps et Louise Forestier lançaient L’Osstidcho. À l’époque, sacrer publiquement brisait un tabou. Aujourd’hui, l’usage des mots sacrés dans l’espace public est devenu banal. D’où vient cette mauvaise habitude proprement québécoise de jurer avec des mots d’Église? Serions-nous le plus religieux ou, au contraire, le plus mécréant de tous les peuples?
D’où viennent tous nos sacres?
Si partout dans le monde on jure, le sacre québécois demeure un cas particulier. Dans le film Bon cop, bad cop, une scène d’humour emblématique présente cette particularité de la Belle Province, alors qu’un policier québécois tente d’expliquer les subtilités des déclinaisons des sacres en verbes, adjectifs et substantifs à son collègue ontarien.
L’origine des sacres du Québec est un mystère qui fascine et divise les spécialistes. Pour répondre à la question, les chercheurs doivent faire appel à l’histoire, à la linguistique, à la sociologie et à la psychologie. Surtout, ils doivent déterminer ce qui est unique au peuple québécois, ce qui peut expliquer cette marque distinctive.


Puisque, avant le XXe siècle, il était pratiquement impossible d’écrire de tels mots, les preuves manquent et les hypothèses divergent. L’opinion la plus répandue de nos jours est que nos sacres nous viennent de la Révolution tranquille. Voulant contester le pouvoir de l’Église catholique, les Québécois se seraient mis à retourner contre elle ses mots les plus sacrés.
Cette idée populaire n’explique toutefois pas pourquoi c’est seulement au Québec que le rejet d’une institution religieuse aurait engendré des jurons. L’explication ne résiste pas non plus à la critique de l’historien, car des preuves de l’existence des sacres précèdent les années 1960. Ce que la Révolution tranquille a plutôt fait, c’est de sortir de la clandestinité ces mots jadis interdits.
Théories multiples
Dans son ouvrage Contrôle social et mutation de la culture religieuse au Québec, l’historien René Hardy conserve l’idée d’une réaction du peuple devant l’accroissement des contraintes issues du clergé, mais situe plutôt son origine après la défaite des patriotes, autour des années 1840.

En réaction à l’Église ultramontaine de Mgr Bourget, qui devient de plus en plus un agent de contrôle social, les bucherons, qui pratiquaient des concours de sacres dans leurs camps forestiers, auraient ramené cette pratique à la maison. Le phénomène se serait ainsi répandu uniformément sur l’ensemble du territoire, ce qui n’est pas facile à expliquer d’un point de vue linguistique avant l’arrivée des moyens de communication modernes.
D’un point de vue linguistique, en revanche, cette théorie oblige à envisager la transmission, en seulement une ou deux générations, de plus de 400 mots de vocabulaire, ce qui est hautement improbable, puisque la création d’un si vaste champ lexical se produit généralement sur une période beaucoup plus longue.
Pour Jean-François Joubert, professeur au Cégep Garneau à Québec, qui a publié à compte d’auteur en 2002 Le sacre du Québec, il faut remonter beaucoup plus loin pour expliquer le phénomène. La thèse qu’il défend dans son livre, et qui ne fait pas l’unanimité, a de quoi bouleverser notre conception de l’histoire du Québec.
L’opposition à l’Église catholique qui se manifeste dans nos jurons remonterait selon lui au temps de la colonie. Les premiers habitants de la Nouvelle-France n’auraient pas été d’aussi «bons catholiques» qu’on l’imagine. Le roi Henri IV, protestant d’origine, envoie Samuel de Champlain, lui aussi protestant, fonder Québec en 1608, possiblement afin d’en faire une porte de sortie «tolérante» pour les huguenots, disciples de Jean Calvin, fortement persécutés en France.

Des colons protestants
Les premiers missionnaires se sont souvent plaints du manque de piété et d’instruction religieuse des premiers colons. L’historien François-Xavier Garneau avait déjà remarqué que les catholiques émigraient peu au Canada. Une importante proportion des arrivants en Nouvelle-France provenaient des régions à forte concentration protestante qu’étaient le Poitou et le Pays de Caux. Une fois arrivés en Amérique, ils se mariaient et baptisaient leurs enfants à l’Église catholique parce qu’ils n’avaient pas vraiment d’autres choix. Ils devenaient ainsi catholiques sur papier, mais pas nécessairement de cœur.
Parce qu’ils étaient obligés de pratiquer un culte auquel ils ne croyaient pas ou peu, ces colons «faussement catholiques» auraient fini par développer des jurons presque tous liés au culte sacramentel de la messe, que les protestants considéraient comme une cérémonie superstitieuse.
«Nos blasphèmes, note Jean-François Joubert, ont été créés comme outils d’expression de la dissidence contre les communautés religieuses catholiques. Ils se sont transformés en marqueurs identitaires par un peuple fatigué des persécutions religieuses et en situation de force en Nouvelle-France.»

Cette situation de force explique selon lui pourquoi ailleurs dans le monde des protestants minoritaires n’ont pas développé de pareils jurons. Leur grand nombre aurait favorisé chez nous une plus grande tolérance à leur égard, accrue et maintenue ensuite par l’arrivée du régime anglais.
En somme, que l’on situe très tôt ou très tard dans notre histoire l’origine des sacres, il semble qu’ils apparaissent toujours comme une sorte de refoulement d’une obligation à pratiquer le culte catholique. L’absence de contrainte religieuse à notre époque risque toutefois, sur quelques générations, de faire de nos jurons caractéristiques une espèce menacée d’extinction.
Un manque de vocabulaire?
On entend parfois dire que ceux qui sacrent manquent de vocabulaire, comme s’ils n’arrivaient pas à trouver les justes mots pour exprimer leurs idées et leurs émotions. Mais pour le linguiste Jean-François Joubert, c’est tout le contraire: nos jurons sont un aspect du vocabulaire des langues vivantes, et puisque la culture québécoise a longtemps été préservée par l’oralité, il n’est pas étonnant qu’elle soit si riche en ces mots normalement interdits à l’écrit.

Selon Jean-Pierre Pichette, professeur retraité du département de folklore et d’ethnologie de l’Université de Sudbury et auteur du Guide raisonné des jurons, chaque Québécois possèderait en moyenne un riche répertoire d’environ 130 jurons. Citant le frère dominicain Benoît Lacroix, le spécialiste remarque que, si l’on remplaçait dans la langue des Français de France «tout l’espace occupé par les “merdes” et expressions du même genre, on s’apercevrait qu’en matière d’intensification, nous avons un vocabulaire plus riche que le leur».
Jean-François Joubert tient aussi à rappeler qu’aucun mot n’est un juron en soi, c’est le contexte et l’intention qui le déterminent. «C’est un petit Christ» n’a pas le même sens lorsqu’il est entendu au musée des beaux-arts devant un tableau de la Sainte Famille que dans une cour de récréation lors d’une bagarre.
Mais pourquoi jure-t-on?
Pour Joubert, les jurons ont d’abord une fonction sociale. Ils servent à se reconnaitre en tant que membre d’une même communauté. Des adolescents jurent entre eux afin de bien marquer leur sentiment d’appartenance à une sous-culture; des coéquipiers sportifs le font afin de manifester une complicité.

En règle générale, on ne jure ni en public ni par écrit. Le juron est un marqueur d’identité et d’intimité, une manifestation de confiance. En effet, qu’on les approuve ou les désapprouve, seuls des Québécois peuvent reconnaitre comme jurons les sacres propres à notre culture.
Ailleurs qu’au Québec, les jurons proviennent généralement des tabous sexuels et scatologiques (putain, merde, etc.). Anthropologiquement, cela s’explique par le fait que ces mots jouent sur la distinction publique/privée de la vie humaine. En introduisant dans la sphère publique ou semi-publique un mot normalement réservé à la sphère privée, le juron brise un interdit. D’un point de vue psychologique, jurer serait donc une manière d’affirmer son indépendance vis-à-vis d’une autorité.
Au micro de Radio-Canada, à l’émission À échelle humaine, Jean-Pierre Pichette remarque aussi que l’on jurait traditionnellement entre soi au Québec, et surtout entre hommes, pour impressionner et avec la volonté de choquer. On pensait ainsi montrer que l’on était indépendant de la religion, de nos parents ou de nos patrons. Mais aujourd’hui, selon lui, on ne choque presque plus personne en sacrant, tellement cela est rendu commun et public, mais on démontre plutôt une certaine vulgarité.

Bien souvent, en revanche, lorsqu’un mauvais mot s’échappe de notre bouche, c’est aussi parce que nous sommes contrariés par les évènements. Les jurons sont alors signes d’une résistance, voire d’une révolte, par rapport à notre condition de créature limitée. Nos impatiences et nos colères langagières révèlent un certain orgueil qui souhaiterait contrôler l’ensemble de la réalité. On jure alors, plus ou moins consciemment, contre la volonté de Dieu. Comme disait un Père du désert: «Le moine qui soupire n’a pas atteint la perfection.»
L’attitude opposée consiste alors à s’abandonner à la Providence. Si la charité chasse la crainte, elle chasse aussi les jurons. C’est la qualité de notre relation à Dieu qui nous permet d’observer ce commandement libérateur, comme tous les autres d’ailleurs.
Une faute très grave?
Selon le sens des mots, jurer n’est pas toujours l’équivalent de blasphémer. Au sens strict, jurer, c’est décider ou promettre solennellement. On jure, par exemple, au tribunal de dire toute la vérité, rien que la vérité. On ne doit pas jurer à la légère, car cela engage l’honneur et la fidélité. Rien à voir ici avec l’usage de mots tabous.

Blasphémer, cependant, consiste à proférer contre Dieu des paroles de haine, de reproche ou de défi, à manquer de respect envers Dieu, à dire du mal de lui ou à abuser de son nom. Puisque Dieu est Parole, salir son nom ou les mots qui lui sont associés, c’est attaquer directement sa personne, et c’est pourquoi un commandement proscrit le blasphème: «Tu n’invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom» (Ex 20,7).
Mais pourquoi le deuxième commandement est-il le seul dont il est dit que Dieu «ne laissera pas impuni» celui qui le transgresse? Blasphémer serait-il le pire de tous les péchés? Dieu serait-il plus indulgent pour un vol, un adultère et même un meurtre, que pour des gros mots?
«Prends-moi [Dieu] sur toi, parce que je t’ai pris sur moi.»
Tout est une question de traduction. Plutôt qu’«invoquer» ou «prononcer» le nom de Dieu, l’original hébreu devrait être traduit par «porter» ou «abuser». Que signifie alors abuser du nom de Dieu? Cela veut dire, dans la tradition juive, commettre le mal en son nom.
Ceux qui justifient des abus sexuels ou des actes terroristes au nom de Dieu commettent l’un des pires crimes, car il dénature Dieu, qui est justice et bonté. «Quand des personnes religieuses commettent le mal, surtout au nom de Dieu, non seulement ils commettent le mal, mais ils causent un terrible préjudice au nom de Dieu. […] Les personnes qui assassinent au nom de Dieu ne tuent pas seulement leurs victimes, elles tuent aussi Dieu», affirme l’écrivain juif Denis Prager, auteur du livre The Ten Commandments: Still the Best Moral Code.
En effet, le «nom» dans la tradition biblique désigne la nature et la mission d’une chose. Révéler son nom est donc un signe de confiance et d’intimité. Dès lors, utiliser le nom de Dieu pour justifier le mal est le pire des mensonges. C’est comme abuser de Dieu lui-même.

Être vrai avec Dieu
Cherchant lui aussi à se rapprocher de l’original hébreu, le pape François proposa lors d’une catéchèse le 22 aout 2018 à Rome de traduire le deuxième commandement par: «Tu ne prendras pas sur toi à vide le nom du Seigneur.»
Comme le dit le pape: «Cette parole du Décalogue est précisément l’invitation à une relation avec Dieu qui ne soit pas fausse, sans hypocrisie, à une relation dans laquelle nous nous confions à lui avec tout ce que nous sommes. Au fond, tant que nous ne risquons pas notre existence avec le Seigneur, en touchant du doigt qu’en lui se trouve la vie, nous ne faisons que des théories. […] Prendre sur soi le nom de Dieu, ajoute le Saint-Père, signifie assumer en nous sa réalité, entrer dans une relation forte, dans une relation étroite avec lui.»
En définitive, le deuxième commandement, en nous interdisant d’abuser le nom du Seigneur, n’exige pas tant de surveiller notre langage que de nous assurer d’avoir une relation authentique avec Dieu. «Cela vaut la peine de prendre sur nous le nom de Dieu, conclut François, car lui a pris la charge de notre nom jusqu’au bout, également du mal qui est en nous. Il l’a pris en charge pour nous pardonner, pour mettre son amour dans notre cœur. C’est pour cela que Dieu proclame dans ce commandement: “Prends-moi sur toi, parce que je t’ai pris sur moi.”»


