Le dossier des terres des Sœurs de la Charité de Québec a fait couler beaucoup d’encre dans les dernières années. Si nous savons, au moment de mettre sous presse, que la vocation agricole des terres sera probablement maintenue, nous sommes toujours dans l’incertitude quant à la nature du projet qui l’encadrera. Une chose est pourtant certaine : le travail assidu des religieuses réalisé jadis sur la ferme et le rôle qu’elles tenaient auprès des patients de l’hôpital psychiatrique avoisinant a de quoi inspirer. Quel potentiel cet héritage porte-t-il pour la communauté et, plus largement, en quoi réside la valeur d’une enclave agricole de cette envergure en plein centre urbain de Québec ?
Non loin des maisons de banlieue et du boulevard Louis-XIV à Québec, la vue des champs jaune moutarde surprend. Les courges en terre, les cordées de bois et une vieille grange évoquent l’appartenance à la terre, le passé agraire, l’appel d’une vie saine et simple.
À la ferme Bédard Blouin, une entreprise familiale voisine des terres agricoles des Sœurs de la Charité, on s’affaire à fermer la boutique avant que l’hiver arrive. L’achalandage de la cueillette des citrouilles étant passé, on se repose avec la terre et on entretient les serres avant de faire repartir le train pour la culture des fleurs annuelles et la saison des petits fruits.
« Les Sœurs de la Charité de Québec ont été pionnières dans le traitement comportemental de la maladie mentale et, comme on le dirait aujourd’hui, dans l’approvisionnement institutionnel “local” en produits frais et de proximité, à partir d’une ferme urbaine diversifiée et tournée vers la collectivité. »
Manon Boulianne, anthropologue
Sarah Bédard, une des propriétaires, me raconte comment son père a travaillé avec acharnement depuis 1990 pour épargner leurs terres agricoles et forestières de l’envahissement urbain. Sur les traces de leur père, et aussi du grand-père qui les a acquises en 1941, Sarah et son frère Nicolas se dévouent à conserver ce riche héritage. « Plus on était gros et plus on pouvait résister en termes d’espace occupé. Plus tu es encerclé de développements urbains, plus tu ressens la pression sociale et démographique. On a acheté une bonne partie de nos terres aux Sœurs de la Charité en 2008. Ça a doublé notre superficie. À l’est, un promoteur voulait construire un ensemble immobilier sur son terrain. En vertu de la loi du territoire agricole, il a fini par nous le vendre, car il savait qu’on voulait l’acheter. »
Une agriculture sociale d’avant-garde
Sur leurs 200 hectares de terres agricoles, à l’ouest de Beauport à Québec, les Sœurs de la Charité assurent la continuité d’un legs matériel et immatériel immense. Propriétaires depuis la fin du 19e siècle de ces terres cultivées en Nouvelle-France, elles les ont labourées et ensemencées pendant plus d’un siècle. Un rare limon que la construction d’habitations détruirait en un processus difficilement réversible.


Mais au-delà de l’étendue des champs existe également un patrimoine social moins connu que les religieuses ont fait croitre au fil des ans avec foi, amour et labeur. Étienne Berthold, géographe et chercheur à l’Université Laval, s’est demandé de quelle manière leur patrimoine n’est pas qu’une simple relique du passé, mais est toujours présent, vivant, agissant. « Les communautés religieuses ont légué des pratiques sociales, des façons de soigner, un sens qu’on donne aux soins. Pour elles, il fallait soigner la personne. Et à travers la personne, on soignait Dieu. »
Dans un faubourg ouvrier où la pauvreté est criante, on confie aux religieuses, dès leur arrivée, plusieurs missions, dont la charge de l’hôpital psychiatrique Saint-Michel Archange, une institution connue plus tard sous le nom de Robert-Giffard, et appelée maintenant l’Institut universitaire en santé mentale de Québec. Les sœurs hospitalières ne chôment pas pour améliorer les conditions des malades. « Notre premier soin fut de diminuer le plus possible les contraintes alors en usage : bracelets, ceintures, manchons et gilets de force. […] Cet état de liberté alla toujours croissant et nos malades en devenaient de jour en jour plus traitables », peut-on lire dans les archives des sœurs.
« On essaie de stimuler une certaine fierté chez des patients considérés comme non récupérables, on essaie de les occuper par le travail. Recourir au travail pour valoriser, c’est un patrimoine social qui est encore très présent. »
Étienne Berthold, géographe
Ainsi, les religieuses font sortir du lit les patients pour les occuper à différentes tâches à la ferme, où cultures fourragères, production laitière et horticulture forment les activités principales. « Pourquoi fait-on travailler les religieux et les patients ? » demande M. Berthold. « On le fait entre autres pour des motifs économiques. On tente d’être le plus autarcique possible. Mais surtout, on essaie de stimuler une certaine fierté chez des patients considérés comme non récupérables, on essaie de les occuper par le travail. Recourir au travail pour valoriser, c’est un patrimoine social qui est encore très présent. »
La modernisation des pratiques agraires et la désinstitutionnalisation des hôpitaux psychiatriques ont transformé le travail à la ferme à partir des années 1960. Moins de main-d’œuvre requise, moins de patients. Dans les dernières années, les sœurs ont collaboré surtout avec des organismes communautaires pour aider à la réinsertion sociale. Mais malgré ces évolutions, on se souviendra que, comme le souligne l’anthropologue Manon Boulianne, « les Sœurs de la Charité de Québec ont été pionnières dans le traitement comportemental de la maladie mentale et, comme on le dirait aujourd’hui, dans l’approvisionnement institutionnel “local” en produits frais et de proximité, à partir d’une ferme urbaine diversifiée et tournée vers la collectivité ».
Se rassembler par la terre
Comment perpétuer l’esprit communautaire que les sœurs ont cultivé durant des années ? Conserver intact le patrimoine agricole de la congrégation, c’est déjà faire un pas en ce sens. « Si l’agriculture urbaine est en train de percer dans nos villes de plus en plus, c’est parce qu’elle répond au souhait de créer la cohésion sociale », estime M. Berthold.
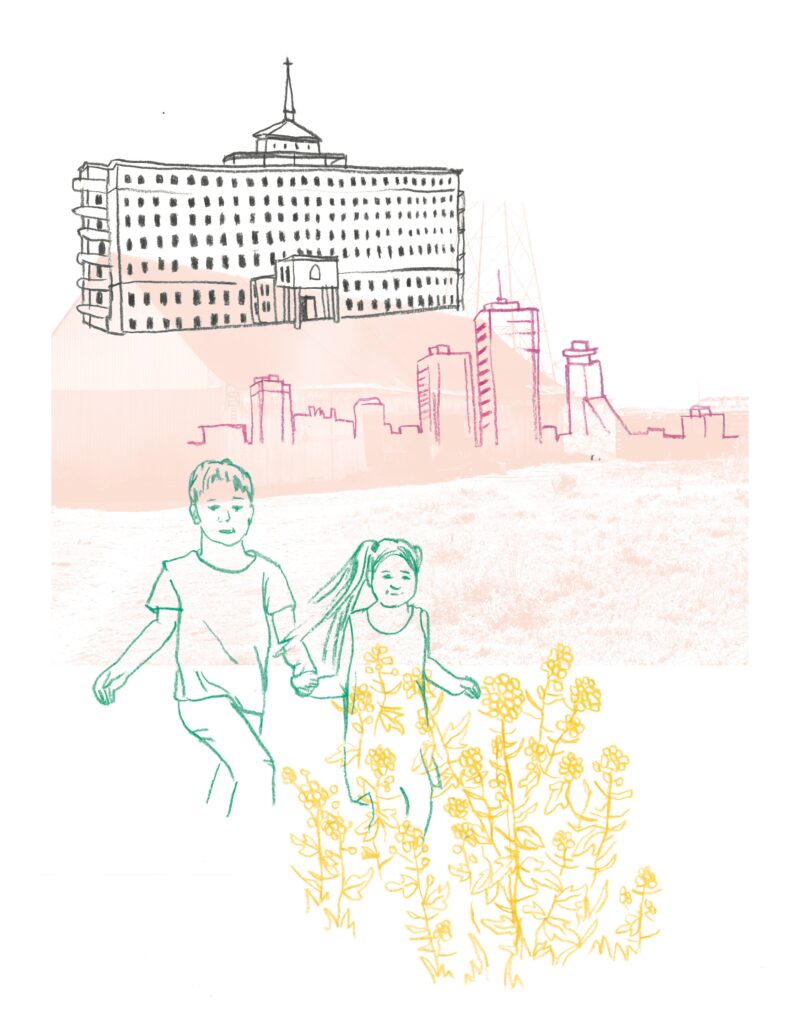
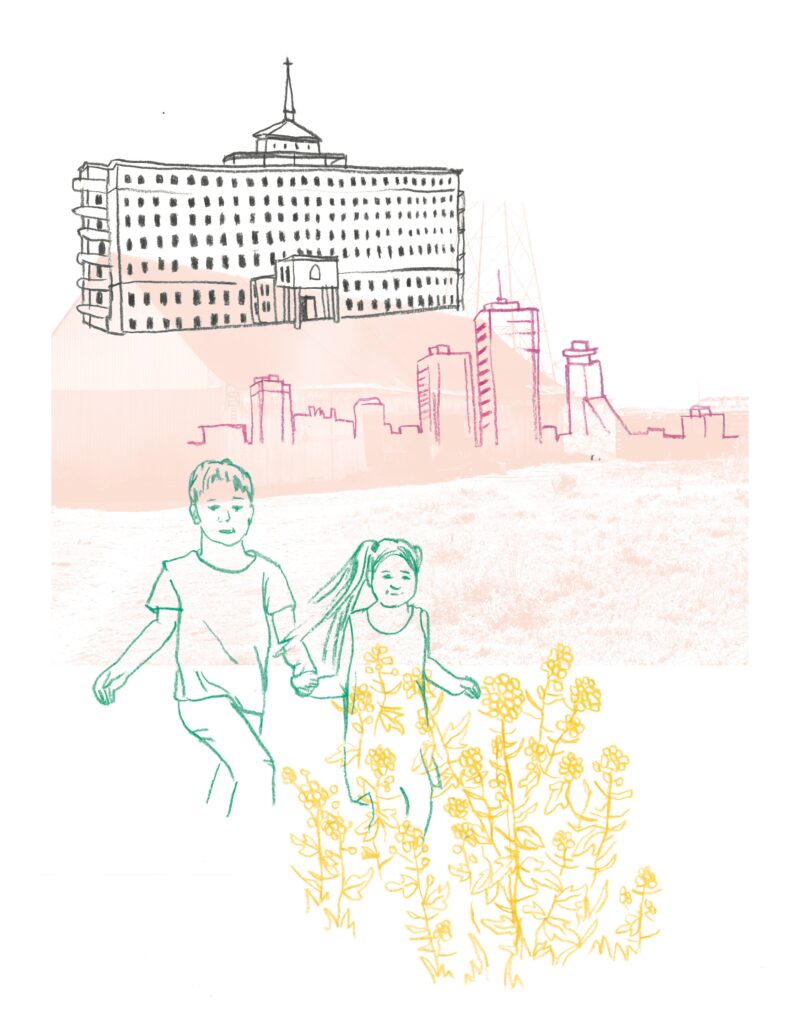
À la ferme de la famille Bédard et Blouin, le lien entre agriculture et communauté est tangible. On y rassemble les générations comme des gens de milieux variés. Des retraités viennent donner un coup de main l’été. Les tout-petits du CPE Les pouces verts courent dans les champs après la sieste. Des citadins viennent s’y changer les idées.
« On garde les terres, mais on les partage en même temps », témoigne Sarah Bédard. « On pourrait produire pour vendre au marché ou à l’épicerie, mais on a choisi de faire de l’autocueillette pour que d’autres en profitent aussi. Il y a une grande demande pour les jardins communautaires. Beaucoup d’organismes qui se développent vont acheter un jardin pédagogique, que ce soient des garderies, des centres de personnes âgées, des organismes de réinsertion sociale. Mettre les mains dans la terre, ça fait du bien à tout le monde. »
Simon Parent, chargé de projet en verdissement et en design urbain, suit de près le dossier des terres des Sœurs de la Charité. Comment habiter autrement le territoire, c’est la question qu’il se pose tous les jours, la question que soulève aussi l’avenir de cette enclave agricole convoitée.
« Le lien à la terre est de nous rattacher tous ensemble au territoire qu’on habite, aux relations que le territoire rend possibles également. Savoir d’où provient notre nourriture, et avec cette nourriture partager des repas. Se partager des tâches dans un esprit convivial, partager des récoltes. Il y a tout un rapport aux cycles des saisons, au temps, à la communauté, qui est retrouvé grâce à l’agriculture et qui est complètement perdu parce qu’on va seulement à l’épicerie, qu’on tend un billet en échange de nourriture. »
Celles qui restent
« Les terres qui restent sont importantes. Avant, tout le monde venait de près ou de loin d’une famille agricole. Les gens se sont extrêmement déconnectés de ça, et pourtant, nous mangeons trois fois par jour. Si on ne peut pas prévoir une pandémie, on ne peut pas prévoir non plus une famine mondiale. Aujourd’hui, l’agriculture québécoise dépend de la main-d’œuvre étrangère parce qu’il n’y a plus beaucoup de personnes qui veulent travailler aux champs. Si l’on est dépendant des autres pays, si les frontières ferment, si le transport devient moins accessible, alors on fait quoi quand on a besoin de se nourrir ? » constate Sarah Bédard.
Simon Parent se désole du peu de valeur accordée aux terres agricoles, surtout en contexte de crise écologique et parce que le Québec produit seulement 30 % de la nourriture qu’il consomme.
« On ne réalise pas à quel point c’est précieux un sol fertile qui a la possibilité de faire pousser d’autres espèces et même de nous nourrir, c’est exceptionnel comme condition territoriale. Mais on est pris dans une logique où tant qu’il n’y a pas une construction dessus, il n’y a pas de valeur au sens de l’économie marchande. »
Selon lui, il s’agirait de renverser la perspective. Il évoque l’image du champ de ruines pour en parler. Comment habiter ces ruines qui traduisent un rapport perplexe entre l’être humain, la technologie et son environnement ?
« Je pense que les communautés autochtones auront énormément de leçons à nous apprendre sur la manière d’habiter un territoire de façon équilibrée. Elles sont encore présentes et elles ont encore ce respect pour la terre. Il ne faut pas qu’on soit dans un rapport productif avec le sol, c’est-à-dire qu’on s’attende à ce que le sol nous livre des marchandises, mais qu’on soit dans une relation de soins avec le sol. Il y aura une reconnaissance des générations suivantes du fait qu’on leur aura légué quelque chose de beau et non pas des ruines. »
* * *
Au moment d’écrire ces lignes, les Sœurs de la Charité de Québec sont toujours en négociation avec le gouvernement du Québec quant à la proposition d’un agroparc. Si elles n’ont pas voulu nous accorder d’entrevue durant leur processus de réflexion, nous pouvions lire dans les pages du Soleil en novembre dernier qu’elles veulent encourager le projet qui « [rejoindra] le plus de gens possible ».
La vocation agricole et sociale de leurs terres, aussi féconde qu’elle l’ait été dans le passé, continue à l’être par les rêves qu’elle fait pousser dans la communauté environnante. Sarah Bédard souhaiterait y voir naitre une école primaire pour éduquer les enfants à l’amour de la terre. Ou voir des légumes cultivés être redonnés aux plus démunis. Simon Parent, lui, rêverait d’y voir des projets ne servant pas la recherche agro-industrielle, mais plutôt encourageant des formes d’agriculture paysanne comme l’agroforesterie.
Pendant ce temps où l’on sème du rêve, alors que se discerne toujours le destin de ces terres d’exception, les champs de trèfle, de sarrasin et de moutarde de la ferme Bédard Blouin ne poussent pas en vain. On les plante à la fin de l’été et on enfouit leur grain au printemps, afin de donner à la terre le repos qu’elle mérite et pour fertiliser le sol pour les futures espèces.
Les sœurs trouveront aussi leur repos mérité. Et leur legs, espérons-le, s’épanouira pour les générations qui suivent, comme les champs de moutarde qui embellissent la ville tout en préparant la prochaine saison des semailles.


