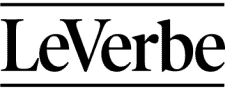Lors de sa visite au Canada, le pape présentait ses excuses aux Autochtones pour la conduite déplorable des membres de l’Église impliqués dans les pensionnats. Il a pris le temps d’entendre les survivants et ainsi de s’engager avec les peuples autochtones sur le chemin de la guérison et de la réconciliation. En amont de cette visite, Le Verbe s’est rendu à Manawan, en territoire Atikamekw, pour prendre le pouls de la communauté.
En 2020, la communauté de Manawan a perdu Joyce Echaquan, dans de tristes conditions. Elle était mère de sept enfants. Jaunie par le soleil, sa photo habite l’espace entre les vitres de leurs fenêtres. Il y a peu d’arbres au village. Il y a la forêt, à perte de vue autour, les lacs, et l’interminable chemin de gravier qu’il faut emprunter chaque fois qu’on veut s’y rendre ou le quitter. Le soleil est aride, l’air poussiéreux, on a le souffle court. Les maisons sont petites, les familles nombreuses. Les enfants jouent dehors.
En ce dimanche de fonte des glaces, la musique joue à tue-tête dans le village: Bieber et un peu de Pink Floyd. Tapis de sable en tous lieux. On se rend à la cantine: on ne sait pas quand, ou même si, la cuisinière rentrera.
Endroit de prédilection pour la rencontre: l’épicerie et son unique pompe à essence. Ici, on connait par cœur le numéro de téléphone du chef, mais aucun réseau cellulaire ne s’y rend. On est 3000 personnes, un peu plus ou peut-être moins, et on se sent loin.
Un rapport plus personnel
Petite sortie de fin de soirée, une urgence médicale ou un suivi de santé? Trois heures de route jusqu’à la ville la plus près. Et ensuite, le retour. «Ça fait des années qu’on demande une route. C’est pas l’argent qui manque, en tout cas!» me dit Jean-Marc. Bière à la main, le regard tourné vers le village, il jase avec nous, et avec tous ceux qui passent devant lui.
Il y a deux écoles primaires et une école secondaire à Manawan, peu ou pas de places en garderie (plus ça change, plus c’est pareil), une église, un CLSC et une nouvelle maison pour retraités. Ça sent le neuf. L’énorme mur vitré de la salle commune donne directement sur le lac. La beauté éblouit. C’est de l’autre côté, sous l’ardeur de l’après-midi, devant la porte d’une chambre donnant sur le stationnement, que nous rencontrons William. «Le pape, c’est juste un homme», lance-t-il dans un calme déconcertant.
Officiellement, il est préposé aux bénéficiaires à la résidence. En fait, c’est un homme à tout faire, et surtout à tout connaitre, ou à peu près. En quelques mots, il nous dresse une carte: qui habite où, quelques lignes de parentés et comment les choses fonctionnent ici.
Il n’a aucun intérêt pour l’église. Il s’y est marié, il y a neuf ans, à la demande de sa grand-mère, qui est décédée maintenant. «Je veux me marier traditionnellement. J’aimerais qu’on se marie pour nous, qu’on célèbre notre union dans un sweat lodge, avec des prières chantées. Moi, je prie au Ciel, dans le bois. C’est un rapport plus personnel.» Traditionnellement nomades, les Atikamekw s’enfuient dans la forêt pour respirer.

«La guérison passe par le pardon»
«Il y a trois groupes ici. Il y en a qui sont très fervents, qui vont régulièrement à l’église et aux soirées de prière. Ceux-là ont généralement 80 ans et plus. Il y a des pratiquants occasionnels, comme moi. Quand je suis là, j’assiste à la messe, mais si j’ai d’autres choses, j’y vais pas, tout simplement. Mais j’ai la foi! Oui, j’ai la foi. Je crois en Kice Manito, au grand esprit qui est partout», raconte Marietta. Avec plus de 50 ans d’expérience, elle enseigne aujourd’hui la langue atikamekw aux élèves d’âge secondaire.
Louis Constantin, originaire du Cameroun, curé résident de la paroisse du village depuis deux ans, nous explique que «les jeunes ne côtoient l’Église que pour ces occasions: les mariages, les baptêmes ou les funérailles. En dehors de ces moments, on ne les voit pas à l’église. Ils n’ont pas été initiés à la vie chrétienne. Pendant que la grand-mère récite le chapelet, ils regardent des films ou ils font autre chose».
Le rapport des Atikamekw à la religion catholique est complexe, ambigu. «En 1975, à peu près, le curé a fait des tentatives d’agression sur ma mère. Elle venait pour se confesser et acheter des objets de piété. Après cet évènement-là, je pense qu’elle s’est éloignée de la religion. Elle priait chez nous, j’entendais ses prières, mais elle a évité l’église. Elle était très surprise que le curé fasse ça. Il était le représentant de Jésus», s’exclame Marietta.
«Durant ces années-là, il y a eu une grosse crise ici. Le curé faisait croire aux femmes qu’en mettant de l’huile sainte sur leur ventre et leurs parties génitales, elles allaient avoir un bon accouchement. Un groupe de jeunes – dont je faisais partie – qui ont écouté les histoires des victimes a fait signer une pétition pour renvoyer le prêtre. Ça a pris un an ou deux, mais ils ont réussi. Le curé est parti. Cela a créé une grande division au sein de la communauté de Manawan. Les personnes âgées étaient très en colère contre les jeunes», poursuit-elle.

Quelle spiritualité ?
«Il y a un renouveau pour la spiritualité autochtone depuis quelques années déjà», nous dit Jean-Marc. «Moi, je suis pour la liberté spirituelle. Dans la religion, tu n’es plus maitre de toi. Ils te disent: “Fais ceci, ne fais pas cela, ne dis pas ceci, dis cela”, ils t’enlèvent toute ta liberté. Ils te conduisent comme des marionnettes.
«Les autochtones ont recommencé à jouer du tambour. Ça a commencé avec les gens de ma génération, et les jeunes s’y intéressent maintenant de plus en plus. Les pow-wow, qui avaient été interdits aussi, reprennent peu à peu. Un pow-wow, ce n’est pas un spectacle, bien que ce soit spectaculaire. C’est un évènement spirituel. On chante et on danse pour remercier le Créateur. Le soleil, les arbres, l’eau. Quand on danse, on touche la terre. On va chercher l’énergie de la terre pour s’en imprégner. On remercie le Créateur pour tous les dons qu’il nous fait: pour les animaux, pour les arbres, pour notre eau, et même pour les maringouins! (rires)»
Rose, fin quarantaine, travaille à la maison de retraite. Elle accepte de nous rencontrer après la messe des ainés. Tous les dimanches, Louis Constantin se rend à la résidence pour 15 h. Il sort sa nappe, sa chasuble et improvise un petit autel dans la salle commune. Une dizaine de résidents écoutent le service et chantent en atikamekw.
Pendant ce temps, Rose termine son diner. Elle a vécu les pensionnats et a essayé de s’enfuir à maintes reprises. «On voulait retourner chez nous. Lorsqu’on nous retrouvait, on nous imposait des punitions corporelles. Mais j’aime beaucoup la prière. La prière catholique, c’est-à-dire. Dans la religion, la guérison passe toujours par le pardon.»

Un long chemin
Les pensionnats pour autochtones représentent un épisode traumatique pour bon nombre de survivants. «J’ai connu les pensionnats. Je savais ce que je devais faire lorsque je voyais quelqu’un aux intentions douteuses s’approcher de moi. J’ai des membres de ma famille qui ont été abusés. Ma mère a eu dix-neuf enfants. À un moment donné, on était une dizaine au pensionnat. Dans cette dizaine, la moitié ont été agressés… pas seulement par des prêtres, mais par des religieuses aussi», nous raconte Marietta.
«Quand le jeune n’est pas traité, aidé, il va poser les mêmes gestes plus loin. […] C’est comme un enchainement», poursuit-elle. Durant sa longue carrière d’enseignante, elle dit avoir reçu beaucoup de confidences en ce sens de la part de ses élèves.
Le prolongement des abus, nous l’abordons aussi le soir même avec Nipica, une jeune maman de trois enfants.
«J’ai toujours eu le mal de vivre. J’avais besoin de l’amour de mes parents, mais mes parents ne m’ont jamais dit: “Je t’aime” parce que leurs parents, à leur tour, ne le leur avaient jamais dit. J’ai appris ce qu’était l’amour à mon grand-père. Les pensionnats ont infecté notre famille et cette maladie s’est perpétuée. Mes parents sont tous les deux alcooliques et malades», me raconte-t-elle, râteau à la main.
Son fils ainé s’occupe du feu. Nipica rêve du jour où elle pourra retourner dans la forêt avec son mari, ramasser de l’écorce d’arbre. L’artisanat leur permet d’arrondir leurs fins de mois, mais la famille ne peut pas se permettre de couvrir les frais exigés pour une demande d’agrandissement de la maison.

Différences générationnelles
Le lendemain, après la messe, nous rencontrons Chantale. Elle lit plusieurs passages durant la célébration.
«Même si je suis allée au pensionnat, je n’ai jamais arrêté de prier et d’aller à l’église», raconte-t-elle. «La Bible nous dit: “Demandez et vous recevrez.” Moi, j’ai obtenu des grâces. C’est pourquoi je suis restée attachée à l’Église. J’intègre la tradition autochtone à mes prières. Je médite au lever du soleil, par exemple, mais j’assiste aussi à la messe. Je récite le chapelet avec ma mère, le soir. Ma mère, elle, a la foi chrétienne, mais aucune relation vraiment aux spiritualités autochtones.»
En parlant des jeunes générations, Chantale confirme ce qu’on nous avait déjà dit: «Je ne connais pas beaucoup les jeunes ici, mais je n’en vois aucun à l’église. C’est peut-être pour cela qu’ils consomment beaucoup d’alcool et de drogues.»
«La guérison est un long cheminement. J’en suis la preuve», dit Jean-Marc. «C’est d’ailleurs pourquoi je fais ça [en désignant sa bouteille]. C’est un cheminement qui va durer ma vie entière. Ça va me suivre jusqu’à ma mort.»
Son neveu, Yvan, poursuit: «C’est difficile de définir la guérison pour tout le monde. Chacun y a vécu ses propres affaires. On ne peut pas imposer la guérison. Tu dois y faire ton propre cheminement. Tu acceptes ou tu n’acceptes pas ce que tu as vécu. On en prend, pis on en laisse, comme on dit.»
Deux jeunes filles se promènent en quatre-roues sur les terrains vagues que nous photographions. Elles s’arrêtent pour jaser, et j’en profite pour me présenter. Elles n’ont pas encore vingt ans. Isayah ne connait rien des pensionnats. Personne ne lui en a jamais parlé. Anisha, quant à elle, m’explique: «Ma mère me racontait des histoires, mais elle en cachait des bouts. Ma kokom [grand-mère] aussi me racontait des trucs, souvent tard le soir, mais on n’en a jamais vraiment parlé. Ma mère a les idées noires. Je l’aide. Je suis comme la mère de ma mère. J’aime aider les gens. Un jour, j’aimerais devenir thérapeute.»

«La réconciliation est urgente»
«Je suis contente qu’il vienne», admet Marietta. «Je suis contente qu’il ait reconnu les agressions. J’ai des cousins qui sont passés en cour, devant un juge, pour raconter leurs histoires, et leurs agresseurs les ont traités de menteurs. C’est ça qui fait mal: le fait qu’ils ne l’admettent pas, qu’ils soient rendus vieux aujourd’hui et qu’ils nient toujours leurs actes.»
«Nous sommes prêts pour la réconciliation, mais les non-autochtones n’ont pas encore l’air prêts. On dirait qu’ils ont peur de perdre ce qu’ils nous ont pris déjà. Ça fait plusieurs années qu’on négocie avec le gouvernement, mais on dirait qu’ils ont peur qu’on se développe. Ils veulent nous garder sous leurs jupes. C’est tout cela qu’il faut démanteler, à un moment donné, toutes les injustices qu’on vit de la part du gouvernement», dit Jean-Marc.
«En ce qui concerne l’Église, il n’y a pas de réconciliation possible dans mon cas. Il y a des gens qui choisissent ce chemin-là, qui cheminent dans la foi catholique, mais pour moi, c’est une religion de la peur. L’enfer et tout: on te fait peur pour te garder là.»
De son côté, Louis Constantin, curé au village, déplore les relations entre les peuples autochtones et les gouvernements.
«La réconciliation avec le peuple autochtone est urgente. Elle devrait passer par des infrastructures plutôt que par des discours. Il faut les aider concrètement, et la meilleure façon de le faire est de leur apporter le développement. On a l’impression que c’est uniquement la faute de l’Église, alors que c’est le gouvernement qui finançait les pensionnats. C’est la police qui venait chercher les enfants! L’Église a une responsabilité certaine, mais les efforts doivent être conjugués à ceux des gouvernements en place.»
«C’est important qu’on connaisse notre histoire, et que notre histoire soit connue aussi par d’autres nations et par les Québécois. On n’est pas seulement des individus, sans émotions, sans sentiments. On est un tout. Une personne, il faut la voir dans sa totalité», conclut Marietta avant de nous quitter.

Entendre et être entendu
Les gens se racontent plus facilement qu’ils ne se montrent, ici. Parmi ces voix, une seule a cherché à nous rencontrer, mais la plupart nous ont bien accueillis. Certains nous ont esquivés. C’est normal: la guérison et la réconciliation ne font pas unanimité de l’autre côté de la forêt. La réalité des peuples autochtones impose du sérieux et beaucoup de respect.
Si toute rencontre interculturelle est en soi délicate, cet échange est particulièrement fragile et complexe à la fois. Nous nous sommes rendus là apeurés, peut-être un peu maladroits (puisque l’autre est toujours un mystère), mais curieux, avec un sincère désir de voir des ponts s’ériger.
Aucun de nos contacts n’a pu nous rencontrer, une fois sur place. Heureusement, il y a eu toutes ces autres voix. Témoignages d’un rendez-vous manqué et promesses d’une prochaine fois: «Si nous l’avions su plus tôt»; «Si vous étiez restés plus longtemps»; «Si on n’était pas la fin de semaine.» Ce qu’on en retient, comme dans tout travail avec ou en communauté, c’est à quel point le temps est nécessaire afin de s’imprégner de ce qui se construit là et de l’honorer.
J’espère que cela, notre pape le sait également, puisque entendre et se sentir entendu, ça se développe en temps long, longtemps.