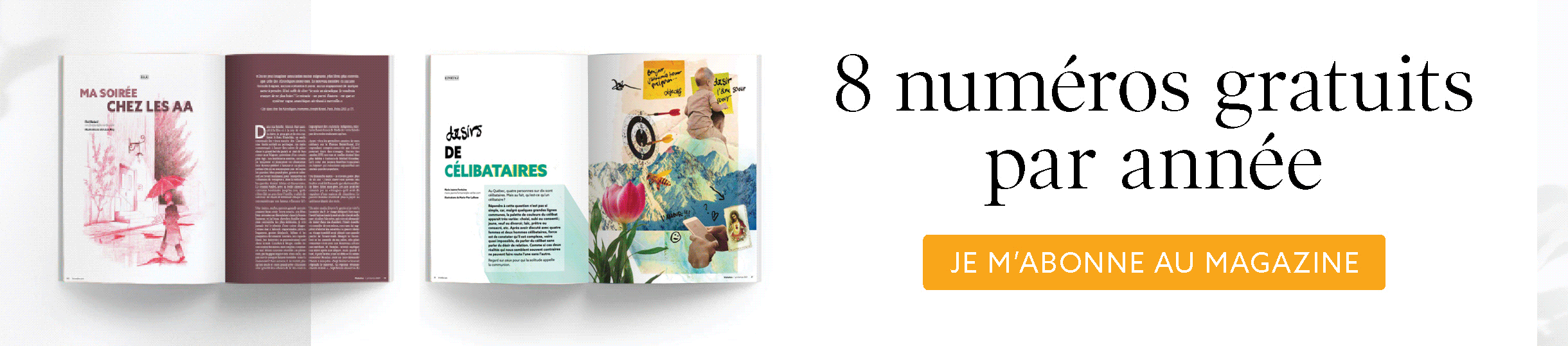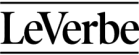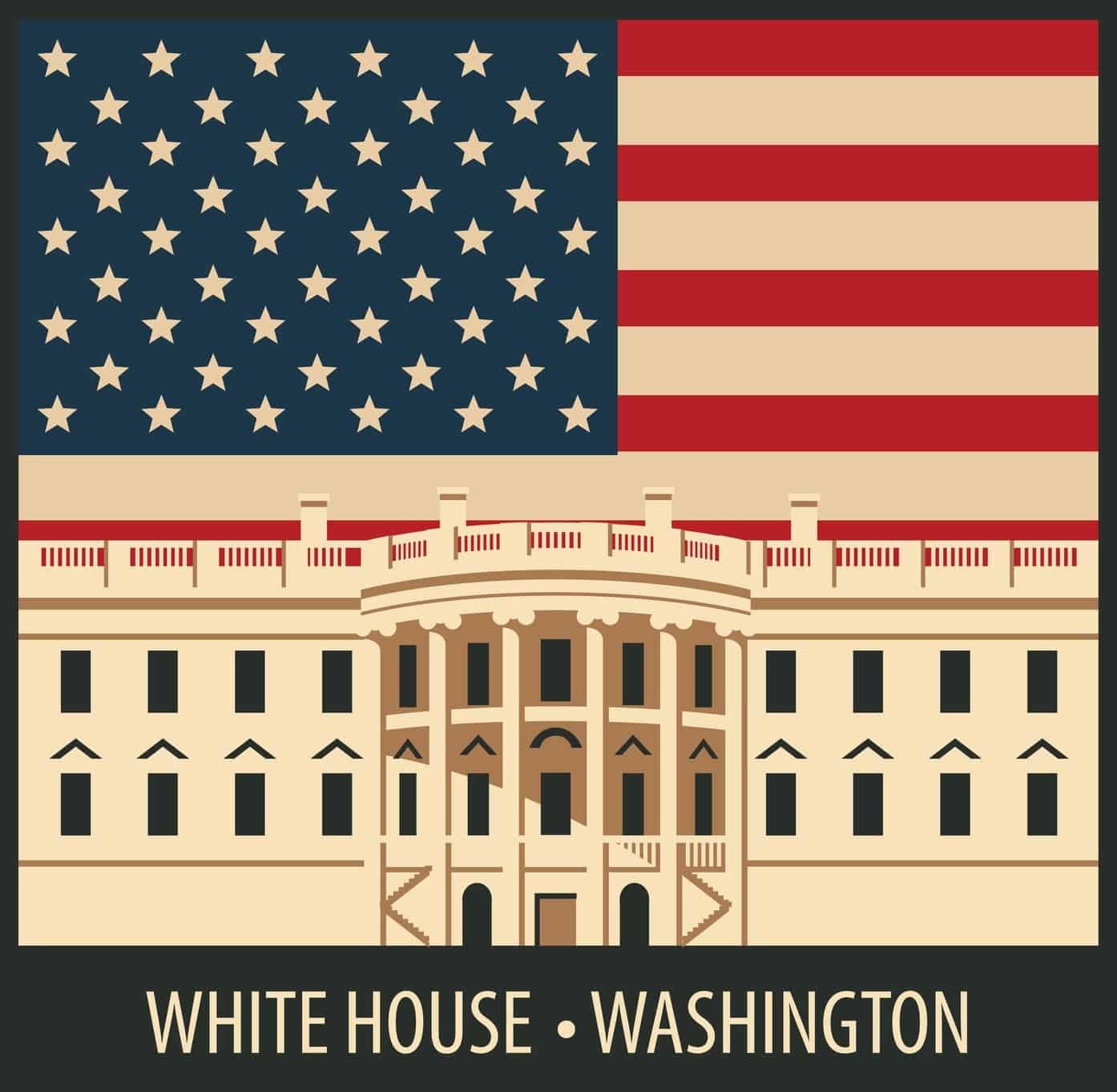Un texte de Jeffrey Elawani
Quand on emploie un outil pour la première fois, il arrive qu’on succombe à une volupté maniaque de l’employer à tout. Je m’explique. Donnez la tâche à votre neveu d’arroser le jardin au boyau d’arrosage. Il donne de l’eau à un premier rang de tomates, comprend comment varier la pression, noie un second rang, arrose la clôture et le chien, mime de pisser au ciel et dirige finalement le boyau contre sa sœur. Ce genre de comportements n’épargne pas les plus sages des hommes adultes. Davantage, il possède un pendant intellectuel : la manie sybarite d’expliquer tout par un même concept.
On n’a de cesse de parler d’oppression systémique de nos jours.
Le racisme est systémique, le sexisme est systémique, l’homophobie comme la grossophobie sont systémiques.
Cette idée d’oppression systémique remonte au moins à Marx. Ses livres expliquent que l’oppression des travailleurs ne dépend pas de la mauvaise volonté des patrons qui leur usurpent illégalement leur dû. Elle dépend plutôt de l’organisation du travail dans une société où les capitalistes achètent la force de travail des ouvriers pour produire des biens.
Cette idée que l’oppression repose sur l’organisation de la société indépendamment des volontés individuelles a un retentissement difficile à apprécier tant elle résonne longtemps dans nombreuses têtes contemporaines. On l’affirme en certains partis avec un enthousiasme qui fait que tous les conflits entre humains semblent des produits de systèmes oppressifs. On y néglige conséquemment la part de responsabilité qui revient à ces humains et leur aptitude à produire un changement par leurs moyens individuels.
Ainsi, le bourgeois ne peut s’empêcher d’être exploiteur. Il exploite dans la mesure où il participe au cercle de production. De même, le raciste discrimine dans la mesure où il appartient au groupe d’identité raciale dominante.
En poursuivant selon cette implacable logique, les attentats comme les moindres incivilités sont expliqués par la position sociale qui définit un individu, sans tenir compte de son caractère moral. Pour leur remédier, il est nécessaire de provoquer des changements sociaux profonds.
Or, plusieurs raisons évidentes demandent qu’on se garde d’employer un tel concept d’oppression systémique avec trop de largesse. Je crois qu’il y a de très bons arguments philosophiques qui nous en préviennent. Par exemple, que l’individu possède un pouvoir d’agir dont les causes sociales ne rendent pas entièrement compte. Sans entrer en débat de philosophie, l’actualité conseille le mieux cette prévenance nécessaire, l’attention bornée à l’explication systémique des relations humaines ayant été récemment confuse par les évènements de société.
Le cas Bissonnette
Considérons le cas d’Alexandre Bissonnette.
Les médias aiguillaient presque exclusivement vers une explication de type systémique. On a parlé de l’élection de Donald Trump, du conservatisme relatif de Québec, de sa police négligeant des accidents antimusulmans, de ses radios qui font leurs choux gras des anecdotes sur la viande halale et le voile intégral.
Comme Bissonnette est un jeune homme blanc de banlieue aisée, tous ces facteurs paraissaient devoir jouer au maximum de leur influence dans son cas.
À l’ouverture du procès de la tuerie, pourtant, le filet de ces analyses a vite révélé ses mailles trop grossières.
À l’ouverture du procès de la tuerie, pourtant, le filet de ces analyses a vite révélé ses mailles trop grossières. On a étudié les intérêts de la recherche internet du jeune homme. Les mots « Hitler » et « nazisme » y apparaissent bien. Mais rien ne convainc d’une adhésion à un système idéologique raciste. Bissonnette n’était pas non plus un auditeur des radios d’opinion. Ses intérêts Facebook ne reflétaient pas une personnalité politique cohérente.
Désespoir nihiliste et désir de gloire
Il est possible de dire que l’influence de l’atmosphère raciste est plus subtile que ne laissent croire les convictions politiques explicites ou les habitudes de consommation d’un individu. Mais alors, on passe outre le témoignage du tueur que confirment ses intérêts de recherche. Celui-ci affirme que la gloire motivait d’abord son meurtre.
En effet, il avait une admiration pour les tueurs de masse. Il recherchait avec une frénésie particulière des informations sur le tueur de Charleston (objet de 201 recherches en un mois). Un désir de geste d’éclat le portait à l’émulation. « Un jeune homme en manque de gloire » titrait Le Devoir. Quelqu’un qui était animé par l’ambition de commettre « un bon massacre » qui lui accorderait une publicité conforme à son idée de lui-même.
Tout cela est cohérent avec sa conviction de pouvoir tromper son psychiatre et avec sa tristesse qui ne semble s’émouvoir que de la situation ruineuse de ses propres parents. Tout cela parait remonter, comme l’effet remonte à sa cause, à la vanité et l’extrême enflure d’une vie brisée.
Il y a présentement une réserve à invoquer la morale quand vient le temps d’analyser des tragédies. Mais le concept moral de vanité est si adéquat ici que les réserves modernes doivent bien céder devant la pénétration qu’il apporte. Ce dernier concept caractérise très justement le mélange de désespoir et de gloire enflée qui engage des gens à commettre des meurtres de masse.
Le dernier film amateur tourné par les tueurs de Colombine les représente en justiciers apostrophant un intimidateur pris sur son fait. Prenant la défense de la victime, ils finissent par liquider tous les personnages de la scène.
Désespoir nihiliste et désir de gloire. Vanité et vanité.
La tragédie de Toronto
La tragédie de Toronto a été commise par un abonné de forums misogynes.
Très vite, on a fait appel à des experts pour juger s’il s’agissait bien d’un attentat misogyne. Dans Le Devoir, une experte des mouvements masculinistes paraissait aussi peu convaincue que convaincante. L’attention médiatique s’est arrêtée sur cette piste qui l’a portée surtout à tourner dans le cercle des mêmes concepts reçus, sans avancer la réflexion d’un seul pas. Les abonnés des forums auxquels le tueur torontois participait partageaient, comme Bissonnette, un désespoir résolu, une haine de leur situation et une volonté de se faire justice.
Il ne faut pas, pour autant, renvoyer au ciel des chimères le concept d’oppression systémique.
Il ne faut pas, pour autant, renvoyer au ciel des chimères le concept d’oppression systémique. Je crois qu’on en use parfois dans son bon droit.
Par contre, l’outrance de son usage récent contribue à obscurcir certains évènements et participe à un mépris funeste de la conception morale. Cette dernière n’a pas moins un objet véritable et une efficacité sur la réalité que la sociologie ne saurait éclipser complètement.
Il y a depuis longtemps des fortifiants contre la misère morale de la vanité.
Toute la discipline stoïcienne agit à cet effet : développer une intelligence contentée de sa place dans l’ordre des choses, une intelligence dont l’affliction et la joie dépendent des limites de sa spontanéité.
Les moyens utiles à ce développement sont concrets : apprendre l’empathie par le savoir et par la fréquentation, attacher la recherche de la tendresse à celle de la satisfaction sexuelle, rechercher à être utile dans les circonstances présentes, résoudre fermement d’être responsable dans les limites connues de son pouvoir d’action, se résoudre à la réalisation de bontés immédiates avant d’envisager réaliser un plan d’envergure pour le bien.
Des approches psychologiques modernes avancent des opinions accordées à celles-ci. Au-delà du pouvoir explicatif intégral de ces premières, il faut retenir, en conclusion, que l’efficacité de nos moyens de prévention des tragédies impose que nous nous retenions de considérer la réalité à travers une seule lunette, peu importe la vogue dont jouit, dans l’opinion, sa monture.