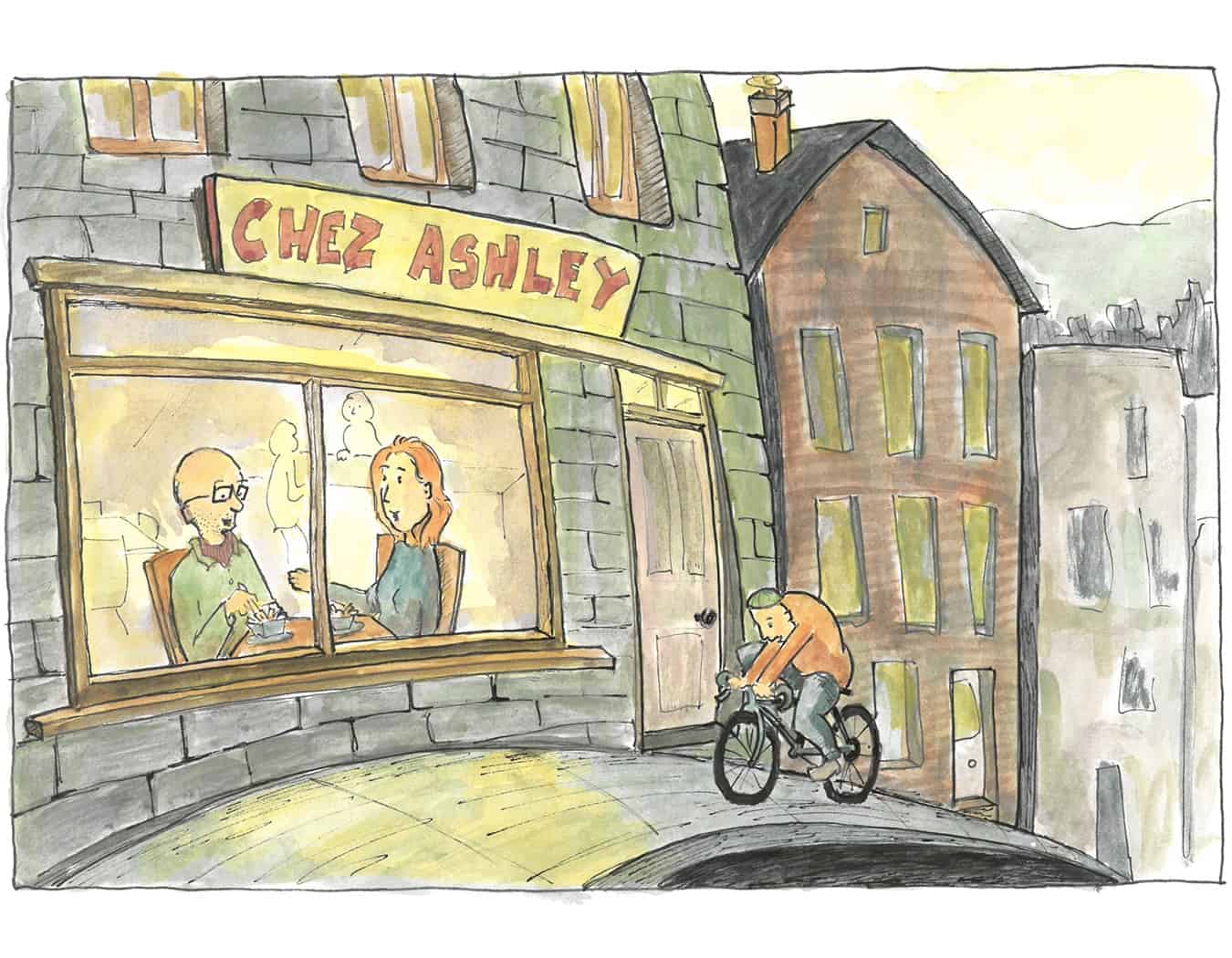La politique québécoise est actuellement le théâtre de nombreux débats sociaux ayant pour objet les politiques de retour à l’équilibre budgétaire du gouvernement. Ces politiques « d’austérité » – certains préfèrent l’euphémisme « rigueur » –, justifiées ou non, opèrent actuellement une transformation plus large de l’État québécois, ce qui n’est pas sans conséquence pour le lien social.
Afin d’examiner cette transformation, un rappel préalable des fins de l’État en général, puis des fins de l’État québécois en particulier, s’impose.
Les fins de l’État
D’un point de vue chrétien, le Compendium de la doctrine sociale de l’Église nous informe d’abord que « la personne humaine est le fondement et la fin de toute communauté politique » (1). Cette dernière existe pour « la pleine croissance de chacun de ses membres, appelés à collaborer de façon stable pour réaliser le bien commun […] » (2).
Le bonheur et la béatitude de la personne sont donc la fin et le critère de la communauté politique, alors que le bien commun est la fin et le critère de régulation de la vie politique.
L’État du Québec participe sans nul doute de cette fin commune à tous les corps politiques. Mais il possède une particularité de par son appartenance à une communauté de corps politiques : la fédération canadienne. En effet, le Québec ne jouit pas des pouvoirs entiers d’un État moderne, mais possède certaines compétences spécifiques qui orientent nécessairement ses fins.
Un peu d’histoire
Retournons un moment dans l’histoire. En 1867, l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, héritier du Canada-Uni, instaure une fédération de quatre provinces et d’un palier fédéral, dotés de compétences propres. Les provinces héritent notamment des domaines de l’éducation, de la santé, de la propriété et des droits civils.
Pour mieux comprendre la nature de ces compétences, référons-nous au tout premier discours du budget de la province, prononcé par Christopher Dunkin, alors ministre des Finances: « Il y a parmi les questions de notre ressort, des intérêts qui touchent de plus près aux sentiments et au cœur de la masse du peuple, qui affectent directement ses intérêts. Les pulsations de la vie sociale seront plus sérieusement affectées par ce qui se fera ici que par les actes du Parlement d’Ottawa. » (3)
Bref, le Parlement provincial prend toute son importance dans la sphère que nous pourrions appeler « sociale ». Dans un ouvrage sur les débuts du parlementarisme québécois, l’historien Marcel Hamelin nous explique qu’avec la fédération canadienne et la création d’un gouvernement provincial, un espoir nait chez beaucoup de Canadiens-français. En effet, ces derniers avaient une forte impression que les gouvernements de l’Union négligeaient « les grands problèmes économiques et sociaux du Bas-Canada et les misères quotidiennes du peuple, pour pratiquer une politique extravagante au profit des commerçants, des financiers et des tripoteurs » (4).
Mais bien qu’il nous informe sur les fins de notre État, ce terme [de social-démocratie] en dit cependant très peu sur les moyens à prendre pour assurer le bonheur et la félicité, et encore moins sur la moralité des dits moyens.
Sans nous prononcer sur le traitement réservé par l’État aux « tripoteurs » contemporains, la question de la redistribution opérée par les politiques économiques de notre gouvernement doit certainement faire l’objet de discussions et être mesurée à l’aune de ce à quoi nous nous réclamons : la « social-démocratie ».
Si le terme de social-démocratie peut référer à l’idéologie socialiste ou à la mise en place de l’État-providence, il prend un tout autre sens dans le contexte précédemment décrit d’une province canadienne, celui de la délibération sur les affaires sociales au sein d’une démocratie. Mais bien qu’il nous informe sur les fins de notre État, ce terme en dit cependant très peu sur les moyens à prendre pour assurer le bonheur et la félicité, et encore moins sur la moralité des dits moyens.
Les moyens de l’État
Pourquoi parler de moralité des moyens? L’État n’est-il pas aveugle aux dispositions morales, coiffé du voile de l’ignorance de John Rawls, vêtu de l’armure du droit et armé d’une bureaucratie neutre et efficace?
Encore une fois, la doctrine sociale de l’Église nous informe à ce sujet : « La démocratie est un système et donc un instrument et pas une fin en soi. Ainsi, son caractère moral n’est pas automatique, mais dépend de la conformité à la loi morale, à laquelle la démocratie doit être soumise comme tout comportement humain. » (5)
Il est clair dans la doctrine sociale que la démocratie ne peut se définir seulement par des règles, mais surtout par l’acceptation de valeurs communes, comme la dignité humaine, le respect des droits de l’homme et le bien commun. Outre la définition souvent divergente qu’ont les Québécois de ces valeurs par rapport à celle de l’Église, elles ne semblent même plus faire l’objet d’un consensus au sein de la société.
Pourtant, une compréhension substantielle de ces valeurs est nécessaire pour faire face de façon commune aux problèmes sociaux et aux « misères quotidiennes du peuple ». Le discours économique est non seulement trop présent chez les élites politiques, mais il fait fi de la Personne dont nous parle la doctrine sociale. Il raisonne en termes de système et non d’individus ou de classes sociales.
Les classes sociales
Certes, la notion de classes sociales semble archaïque, mais cet évincement du débat public est porteur d’un vice pervers pour plusieurs groupes sociaux, celui de l’ignorance. En parlant de classes sociales, on peut notamment examiner la source des valeurs prédominantes dans une société.
Fernand Dumont, sociologue et philosophe québécois du 20e siècle, aborde cette question dans son ouvrage Raisons communes, publié en 1995. Il voit l’utilité d’une certaine notion de classe sociale ou d’élite économique, qui « par leur place dans les mécanismes de décision, par leurs modes de consommation, par toutes leurs pratiques, des ensembles d’individus insinuent dans le quotidien des conceptions de la vie combinées à des objectifs sociaux. » (6)
Ignorer la question des classes sociales en les assimilant au mirage de la classe moyenne homogène équivaut à brouiller les pistes de ces conceptions dominantes, ainsi que des intérêts qui leur sont affiliés. Cet aspect n’a pas non plus échappé à Fernand Dumont : « Le blocage des institutions, le silence pudique sur les nouvelles formes de pauvreté et d’injustice s’expliquent sans doute par l’insuffisance des moyens mis en œuvre, mais aussi par la dissimulation des intérêts. » (7)
Cette dissimulation est également favorisée par un facteur important, celui du développement du Grand État, pour reprendre l’expression du philosophe québécois Charles de Koninck. Le Grand État est celui qui centralise la vie politique, à l’aide d’une bureaucratie toujours plus homogénéisante, s’éloignant inévitablement du citoyen et de ses réalités individuelles. Si Charles de Koninck, lorsqu’abordant la question du Grand État, avait en tête une fédération canadienne trop centralisée, nous pouvons certainement appliquer l’idée à l’État québécois d’aujourd’hui.
Le développement du Grand État va directement à l’encontre du principe de subsidiarité de la doctrine sociale. Si l’objet de toute intervention en matière sociale est d’aider les membres du corps social et non pas de « les détruire ou les absorber », les corps sociaux intermédiaires doivent remplir les fonctions qui leur reviennent, sans devoir les céder injustement à d’autres groupes sociaux de niveau supérieur, lesquels « finiraient par les absorber et les remplacer et, à la fin, leur nieraient leur dignité et leur espace vital » (8).
Il n’est pas surprenant dans ce contexte que les politiques sociales récentes, de par leur caractère trop souvent centralisateur, peinent à offrir une aide concrète et humaine à des groupes et des individus qui sont difficiles à insérer dans une catégorie administrative.
En bref, il est important de rapprocher le plus possible l’aide sociale de ceux qui en bénéficient. La mise en place de l’État-providence canadien après la Deuxième Guerre mondiale a malheureusement provoqué l’effet contraire. En vertu d’un certain pouvoir fédéral de dépenser, les mesures canadiennes, bien que non mauvaises en soi, ont eu pour effet de brouiller les canaux d’aide sociale et d’en éloigner la source, tout en faisant compétition à l’État québécois et remettant ainsi en questions ses propres fins.
Il n’est pas surprenant dans ce contexte que les politiques sociales récentes, de par leur caractère trop souvent centralisateur, peinent à offrir une aide concrète et humaine à des groupes et des individus qui sont difficiles à insérer dans une catégorie administrative.
Retrouver nos valeurs communes
Nous l’avons vu, un projet politique et social réellement humain ne peut pas s’alimenter que de règles de procédure. Comme le dit Fernand Dumont, « il est possible de gonfler de gestionnaires n’importe quelle institution, mais l’administration suppose que les institutions soient aussi des projets » (9). Des projets de société durables et humains nécessitent un ancrage commun et non seulement des sentiments de circonstances.
Nos mesures sociales semblent aujourd’hui s’appuyer malheureusement trop sur ces derniers et peinent donc à s’extirper de la bureaucratie afin de créer une véritable amitié civile. Car c’est ce que font aussi les projets de société, ils animent l’amour de la patrie d’abord, puis l’amour de l’autre conséquemment.
Mais pour que cette amitié civile puisse surgir, les citoyens doivent se reconnaitre et puiser à la même source. « Ce qui caractérise en premier lieu un peuple, c’est le partage de vie et de valeurs, qui est source de communion au niveau spirituel et moral » (10), nous dit la doctrine sociale de l’Église. « Les coutumes morales d’un peuple représentent une valeur essentielle de sa culture » (11), ajoute Charles de Koninck.
Une vie en société est donc un travail de mémoire, une réaffirmation et une adaptation constante des valeurs et des coutumes qui lui sont propres. La sphère politique n’y échappe pas. Or, dans un tel exercice, le Québec semble aujourd’hui handicapé d’une partie de son histoire, sur laquelle on a jeté un voile d’obscurité. Cela augmente grandement la difficulté de se définir, et nos choix de société ont alors plus de chances d’être impersonnels, circonstanciels.
Renouer avec notre passé semble donc impératif. D’abord, avec l’époque que l’on a qualifiée de « grande noirceur ». Nous pourrions y trouver une richesse insoupçonnée et regagner un morceau manquant de notre identité.
Ensuite, avec la culture canadienne-française, qui précède la création de l’État québécois et qui dépasse encore aujourd’hui ses confins. Citons pour une dernière fois le philosophe Charles de Koninck : « Mais ce qui nous importe premièrement, sous peine d’être un peuple déraciné, sans histoire, c’est de savoir ce que furent les Canadiens-français depuis le début – leurs qualités et leurs limites. » (12)
Aux objections qui s’élèvent, brandissant la menace de l’intolérance et du chauvinisme, il faut répondre qu’une affirmation de soi conduit à une confiance commune qui permet justement la tolérance et l’accueil des différences, d’une façon plus inclusive qu’un simple laissez-faire poli.
En somme, pour faire face aux défis sociétaux contemporains, ce n’est pas un travail de création et d’innovation ex nihilo que nous devons faire, mais bien celui d’une redécouverte des racines de cette social-démocratie, des valeurs qui nous définissent, celles qui se déploient avec notre identité canadienne-française catholique. La tâche est ardue. Il nous faudra descendre par des chemins glissants dans les fondations obscurcies de notre État, et allumer quelque lumière afin de mieux voir, afin de mieux nous reconnaitre.
C’est à cet exercice que l’Observatoire Justice et Paix vous convie avec lui, afin de nourrir cette communion spirituelle et morale qu’un peuple est en droit de partager.
_____________
Notes :
(1) Compendium de la doctrine sociale de l’Église, chapitre 8, par. 384.
(2) Ibid.
(3) Débats de l’Assemblée législative du Québec, Christopher Dunkin, 14 février 1868.
(4) Marcel Hamelin, Les premières années du parlementarisme québécois, Québec, Presses de l’Université Laval, 1974, p. 8.
(5) Compendium de la doctrine sociale de l’Église, chapitre 8, par. 407.
(6) Fernand Dumont, Raisons communes, dans Œuvres complètes, tome III – Études québécoises, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 570.
(7) Ibid., p. 571.
(8) Compendium de la doctrine sociale de l’Église, chapitre 4, par. 186.
(9) Raisons communes, p. 567.
(10) Compendium de la doctrine sociale de l’Église, chapitre 8, par. 386.
(11) Charles de Koninck, Le dilemme de la constitution, Œuvres de Charles de Koninck, tome III, volume 3, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 320.
(12) Loc. cit.