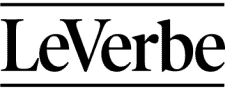À l’heure du passeport sanitaire et des états d’urgence successifs, au moment où l’obligation du vaccin se profile, il est bon de se demander ce que l’État peut légitimement imposer aux citoyens.
La période que nous traversons exige que nous prenions la mesure de l’emprise, sur nos vies, des puissances financières, technologiques et politiques. L’emprise est totale et quotidienne : le plus petit geste est conditionné par une banque, formalisé par une « appli » et réglé par un État.
Mais, pour ce qui est de ce dernier, une chose diffère : si les lois du marché nous échappent et que nul n’arrête plus le progrès technique, l’État est une institution pensée par l’homme, voulue par lui. Il est donc censé être au service de celles et ceux pour qui il a été créé.
Je vous propose, en sept points, d’y voir un peu plus clair.
1. Une création humaine
L’État est une création de l’être humain pour l’être humain.
L’État est donc second par rapport à l’être humain. Sans État, il y aurait tout de même des échanges de biens et de paroles, des nouveau-nés, de l’art et de la musique. Mais aussi des arbres et des corps organisés. Les animaux vivent sans État mais ils vivent. Les sociétés dites « primitives » sont des organisations sociales accomplies qui, pourtant, ne connaissent pas de pouvoir centralisé.
L’État tel que nous le connaissons aujourd’hui, avec un pouvoir central organisé hiérarchiquement et rationnellement, cet État à qui l’on accorde « le monopole de la violence physique », n’a pas toujours existé.
Quoique son pouvoir soit aujourd’hui sans précédent, l’État est donc une réalité, non pas première, mais dérivée.
Quoique son pouvoir soit aujourd’hui sans précédent, l’État est donc une réalité, non pas première, mais dérivée. Sa vocation peut légitimement prendre deux formes :
1) protéger ce qui existait sans lui (la vie, la socialité, les arts et les arbres) ;
2) accompagner ce qui existe sans lui afin de le mener à un plus grand degré de plénitude.
Il y a le même rapport entre l’État et ce qui existe sans lui qu’entre la culture et la nature. La culture peut accompagner la nature sur le chemin d’une perfection que la nature n’atteint pas toujours par elle seule. Ainsi l’arbre pousse mieux une fois qu’il a été élagué. De même, l’estomac malade accomplit mieux sa fonction grâce au bicarbonate prescrit par le médecin.
Mais la culture deviendrait folle si elle voulait absolument se substituer à la nature. La culture peut accompagner la croissance de l’arbre mais non pas remplacer celle-ci. Replanter la forêt amazonienne d’arbres en plastique serait une catastrophe. De même, la médecine perd son âme quand, au lieu de soigner le corps en l’aidant parfois à accomplir les fonctions qu’il accomplit d’ordinaire spontanément, elle fait de celui-ci un champ d’expérimentation. Le Dr Josef Mengele n’était médecin que par son titre.
2. Ce qui vient avant
Plus l’État est doté de grands pouvoirs, plus il doit lui être perpétuellement rappelé l’antécédence de ce que nous lui avons donné de régir. La vie ou la socialité précèdent l’État comme l’arbre précède l’art de l’élagage.
Cette antécédence est à l’origine de ce que les philosophes ont appelé « le droit naturel » : parce qu’il est le produit de la volonté humaine, le droit « positif » (ou écrit) ne peut prétendre régir l’entièreté du réel. Le droit positif peut légiférer à partir de ce qui est (la vie, le corps, la socialité…) mais non pas sur ce qui est. Autrement dit, le droit écrit, parce qu’il est écrit, ne se tient pas au même niveau que l’être, entendu par-là le monde en tant qu’antécédent.
Oublier cela, négliger qu’il y a une antécédence du réel sur le droit écrit, c’est-à-dire produit par une volonté humaine, c’est conférer à celui-ci la toute-puissance.

3. Une erreur historique
Cette évidence première, dont nous verrons plus bas les applications pratiques, est obscurcie par le fait que le droit naturel fut lui-même écrit, « posé » comme l’est le droit dit « positif ».
Au Moyen-Âge, on déclarait en toutes lettres que, en cas de famine, les biens de première nécessité appartenaient à tous, reconnaissant par-là la primauté (donc l’antécédence) de la vie sur le droit (notamment le droit de propriété privée).
Les Lumières de même ont tenté d’inscrire dans des déclarations les droits fondamentaux de l’Homme (propriété privée, liberté d’association, etc.), effort qui fut repris après la Seconde Guerre mondiale par la Déclaration universelle de 1948.
Or le passage à l’écrit du droit naturel, s’il est sans doute nécessaire, est aussi problématique.
La loi naturelle n’a pas besoin d’être écrite pour être vraie. Mais, ayant reçu le pouvoir de dire ce qui est, d’écrire la loi naturelle, les législateurs ont été inclinés à croire qu’ils en étaient, non pas seulement les garants, ou simplement les portevoix, mais les créateurs.
Même en ayant bien conscience qu’ils n’étaient que les scripteurs d’un réel qui les précédait absolument, dès lors qu’ils mirent la loi naturelle en mots, les législateurs l’ouvrirent à la discussion. Ils relativisèrent ce qu’ils voulaient sanctionner. Ils démonétisaient ce droit naturel qu’ils entendaient fixer.
Le droit naturel devait apparaitre finalement comme un droit positif qui s’ignore voire, pire, qui dissimule, sous la dénomination de « naturel », son caractère positif, c’est-à-dire arbitraire.
On le rejeta donc et l’on pensa qu’avant la loi écrite, il n’y avait ni justice ni injustice, seulement un chaos informe que la loi positive était tenue d’organiser. C’est sur cette erreur, qui confine parfois au mensonge, que repose aujourd’hui la toute-puissance de l’État.
4. Le privilège des nations
Cette erreur se prend d’autant plus pour une vérité que c’est aux États-nations qu’il revient aujourd’hui de protéger, quand toutefois ils les reconnaissent, les droits naturels des êtres humains.
On fera alors dépendre la jouissance de ces droits de l’appartenance à une nation, c’est-à-dire de l’appartenance à une terre natale circonscrite par l’État ou à une lignée définie par lui. Un migrant, par exemple, est la présence, au sein d’un État, d’un être privé, du fait de sa naissance, de la jouissance de ses droits naturels.
Allons plus loin : en tant que les États-nations sont multiples et en concurrence, on fera jouer les droits des membres d’une nation contre ceux des membres d’une autre nation. Pour son État, on peut tuer. On le doit même. Pour la sécurité de la nation, menacée par l’ennemi ou par une épidémie, on exigera des citoyens eux-mêmes qu’ils renoncent à leurs droits. C’est ce qu’on appelle l’état d’exception ou l’état d’urgence.
Nous pensons toutefois que s’il y a urgence aujourd’hui, c’est de rappeler aux législateurs qu’ils sont toujours déjà obligés par les droits naturels.
5. L’impasse d’une synthèse
Un dernier problème se présente alors. Comment reconnaitre ces droits ?
Les législateurs peuvent en effet prendre leurs privilèges propres pour des droits universels. On a ainsi reproché aux hommes des Lumières d’avoir édicté les droits de l’homme bourgeois, insistant sur la propriété privée et la liberté d’entreprendre, préférant aux droits économiques et sociaux des droits civils qui n’engageaient à rien.
Le recours aux textes fondateurs, porteuse d’une sagesse murie au fil des siècles, ne résout pas le problème. Car ces traditions sont diverses, parfois contradictoires : l’esprit du christianisme, qui met l’accent sur les obligations qui nous lient (« Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fasse ») est d’une inspiration en tout point opposée avec l’esprit individuel et libéral des Lumières.
De même, les règles de vie qu’on trouve dans l’hindouisme ou le bouddhisme n’ont pas ce tour humaniste qui anime les civilisations issues du christianisme.
Faire une synthèse des grands textes fondateurs (traditions orales des Indiens, textes sacrés de l’hindouisme ou du bouddhisme, Sermon sur la montagne, Déclarations des droits de l’homme, compendium de la doctrine sociale de l’Église…), en espérant y trouver une trame unique, n’aurait qu’un effet : masquer les dissemblances, privilégier, sans même s’en rendre compte, un point de vue ; ou bien, si l’on parvenait à la plus grande neutralité, ne faire ressortir, quant au droit, qu’un plus petit dénominateur commun.
Cette synthèse serait généreuse (on y vanterait la liberté de circulation, d’expression, d’association, etc.) autant que générale et vide.
6. L’être humain face à ce qu’il est
Heureusement, le droit naturel est bel et bien écrit avant toute transcription dans la lettre d’un texte. Il est écrit sur le corps humain et dans le milieu qu’il lui faut habiter pour vivre.
Il n’est pas la création de quelques-uns ni la voix multiple et discordante qu’il faudrait accorder.
Pour le saisir, il suffit de se demander ce que la loi positive, quelle qu’elle soit, organise sans toutefois pouvoir le créer. Il suffit d’énoncer les antécédences universelles.
Il y a urgence, aujourd’hui, à mettre l’être humain en pleine conscience de ce qu’il est avant qu’un écrit légifère sur ce qu’il doit faire.
De même qu’on peut assez aisément indiquer la part naturelle que la culture travaille (ainsi la culture peut créer un bonzaï, mais elle ne crée en lui ni la vie ni le fait qu’il s’agisse d’un arbre), de même on peut énoncer ce qui vient avant le droit positif et qui, pour cette raison, l’oblige absolument.
Il y a urgence, aujourd’hui, à mettre l’être humain en pleine conscience de ce qu’il est avant qu’un écrit légifère sur ce qu’il doit faire.

7. Les sept antécédences
Première antécédence : la vie
L’État ne crée pas la vie. C’est pourquoi aucun État ne peut commander qu’un être humain naisse ou qu’un être humain meure. Si une loi entend légiférer sur la naissance, pour la réguler, la permettre ou l’interdire, elle est coupable d’immixtion dans un domaine qui, ne supposant pas l’État pour être, ne peut être du ressort de l’État.
De même, si une loi rend fortement probable qu’un être humain perde la vie (conditions de détention indignes, autorisation de mise sur le marché de produits toxiques, usage immodéré de la force…), elle est caduque.
La guerre, qui rend parfois légitime la mise à mort et fait appel au sacrifice de soi, échappe donc à toute législation positive. Il n’y a d’engagement guerrier que libre et volontaire. Cela n’empêche pas l’existence d’une armée, mais cela interdit la conscription obligatoire. Il arrive en effet que l’on doive défendre sa communauté de destin contre un ennemi. Mais cela relève du fait brut, des choix tragiques de l’existence et échappe au droit. Si un pays ne trouve, en son sein, pas assez d’âmes pour le défendre, c’est que, de toute façon, il est déjà mort.
Deuxième antécédence : le milieu
L’État ne crée pas la vie (voir la première antécédence).
C’est pourquoi une décision politique ou une loi qui ruinent les conditions de la vie sur terre est coupable. La destruction du milieu permettant d’accueillir la vie future est un crime.
Dans cette optique, l’écologie n’est pas un courant politique. C’est le fait, pour les États, d’être obligés par ce qui conditionne leur existence : le milieu. C’est la logique rigoureuse de l’habitation (« éco-logie »).
Troisième antécédence : le foyer (le milieu humain)
L’État ne crée ni la vie (première antécédence), ni le milieu d’apparition et de croissance de la vie (seconde antécédence), ni le milieu humain où la vie trouve à se développer comme vie humaine. Il ne crée pas la famille, ou le foyer (famille élargie, village, etc.) où éclot la vie humaine. Puisque l’union des sexes au sein d’un foyer existait avant l’État et existerait sans lui, l’État doit regarder la famille (quelle qu’en soit la forme) comme un lieu sacré, en lequel il ne peut pénétrer sans une extrême mesure.
Toute loi violant l’intimité de la famille est caduque. Toute norme politique, émanant d’un pouvoir centralisé, qui entend rivaliser avec les lois spontanées qui ont cours dans le milieu humain, voire les détruire, est inique.
Tout État qui entend se substituer à l’autorité des parents est malade.
On peut imaginer que des agents de l’État protègent l’enfant d’une famille malveillante, mais c’est parce que la première antécédence nous oblige : l’être humain est fait par son foyer, où il reçoit soin et éducation, mais non pour lui. Accueilli et nourri par des êtres autres que ses parents, le nouveau-né vivrait. L’être humain est donc un fils ou une fille de la vie avant de l’être de ses parents.
La vie prime l’ancrage familial, lequel prime l’appartenance à un État.
Quatrième antécédence : le corps
Ce qui vient à la vie dans un milieu naturel et humain, c’est un corps.
Puisque l’État ne crée pas le corps et que l’espèce humaine telle qu’elle se donne charnellement est largement antérieure à l’État, l’État doit considérer le corps humain comme un temple et sa limite, la peau, comme une frontière infranchissable.
Il ne peut ainsi prescrire ni la torture ni des soins jugés, par un patient, comme intrusifs.
Un vaccin, sauf s’il est absolument prouvé que sa prescription est rendue nécessaire pour enrayer collectivement une épidémie, constitue, dès lors qu’il est contraint, une violation de cette limite sacrée qu’est la peau. Le masque en plein air, en toute heure et en tout lieu, en tant qu’il colle à notre peau sans avoir montré aucune efficacité médicale, est une intrusion corporelle. Un test PCR rendu obligatoire afin de pouvoir exercer sa profession s’apparente pour beaucoup à une sorte de viol par chantage.
Cinquième antécédence : la raison
Ce corps humain est animé, des doigts de pied à la cime du crâne, non seulement par la vie mais par la raison (ou logos). C’est elle qui détermine le sens de nos mouvements corporels volontaires.
Puisque l’État est le fruit de la raison, et non pas celui qui la crée, il ne peut, par des lois, exiger qu’un être humain y renonce — de même qu’il ne peut déployer des conditions politiques telles que l’usage en soit devenu impossible (propagation de la peur, financement de la bêtise médiatique, etc.).

L’État qui utilise son immense pouvoir à des fins de propagande ou de publicité, activant des ressorts non pas rationnels mais affectifs (même en cas de campagne dite « préventive »), est coupable. Beaucoup d’États, durant l’épidémie du Sars-Cov-2, se sont ainsi rendus coupables de traumatisme collectif dont les effets, sur le long terme, sont extraordinaires.
Sixième antécédence : le monde comme espace
L’État ne crée pas le monde entendu comme milieu pour un vivant (seconde antécédence). Il ne crée pas non plus le monde comme étendue spatiale. Il fixe des frontières ou sanctionnent celles, naturelles, qui étaient là avant lui. Mais le monde comme totalité existait avant lui, ce qui l’oblige en retour.
Toute loi qui empêche un citoyen de sortir de son pays est par conséquent caduque. Un État n’est pas une prison, sauf pour un être humain condamné à faire de la prison. Un « pass vaccinal » fait d’une nation une prison.
(Si l’on peut concevoir qu’un État entende régir l’arrivée d’êtres humains sur son territoire, il n’en reste pas moins absolument obligé par les différentes antécédences mentionnées plus haut. Ainsi, concernant les phénomènes migratoires, il faut rappeler aux États que leur frontière n’est pas un absolu. L’État le sait lui-même puisque l’histoire des nations est celle de leur expansion, c’est-à-dire de la relativisation de leur propre frontière dans le sens d’une plus grande extension.)
Septième antécédence : ce qui est hors du monde
L’État ne crée pas le monde (seconde et sixième antécédences). Il ne crée pas non plus ce qui échappe au monde. C’est là ce qu’on appelle la transcendance. L’État trouve en effet deux choses qui le précèdent absolument : la croyance religieuse, quelle qu’elle soit, et le fait que tous, nous mourons.
La croyance religieuse est la foi mise en un être que sa divinité place hors de ce monde sans qu’il en soit absolument séparé (même le dieu transcendant du judaïsme ou de l’islam prend la parole, par des prophètes). Une telle croyance rappelle aux puissances d’ici-bas, en tant qu’elles régissent les affaires de ce monde, que leur pouvoir ne sera jamais absolu ou total.
La liberté religieuse est le rappel, consenti par l’État lui-même, que l’État n’est pas divin.
La foi en un au-delà du monde fait dans le tout politique un trou, une percée. Il y a une cause pour laquelle on peut désobéir aux lois positives : la cause première (causa sui) dont ce monde découle.
En Occident, depuis que « Dieu a dépouillé les Puissances de l’univers ; [qu’]il les a publiquement données en spectacle et les a traînées dans le cortège triomphal du Christ » (lettre de saint Paul aux Colossiens), tous les rois sont nus. Ils ne tirent plus leur puissance d’une origine divine mais, simplement, de l’assentiment plus ou moins docile ou éclairé de la population.
La liberté religieuse est le rappel, consenti par l’État lui-même, que l’État n’est pas divin.
La mort est la transcription physique de cette foi métaphysique. La mort est ce par quoi nous échappons radicalement à ce monde. Elle est, ici-bas, le signe tangible de l’au-delà, quand bien même on ne croirait pas que cette échappée hors du monde ouvre sur une autre vie. La mort nous enlève même à nous-mêmes. Elle n’appartient à personne, pas même à celui qui la subira, encore moins à l’État. L’État devient totalitaire quand il entend régir jusqu’à la mort de ses sujets.
Aussi ne peut-il, sauf iniquité, légiférer sur la mort, par exemple pour interdire le suicide, ni même pour l’autoriser ou l’assister, ou bien encore pour fixer des protocoles indiquant à quel degré de dégradation physique une personne cesserait d’être digne de vivre.
Tout cela relève de l’entremêlement, dans nos vies, du malheur, ou de la finitude, et des réponses, libres et responsables, que l’être humain lui apporte.
***
En résumé, le fait que nous soyons vivants, dans un milieu naturel et relationnel, dans un corps s’inscrivant dans l’espace et échappant pourtant au monde : voilà ce que l’État doit chérir s’il ne veut pas périr d’avoir voulu tout ramener à soi.