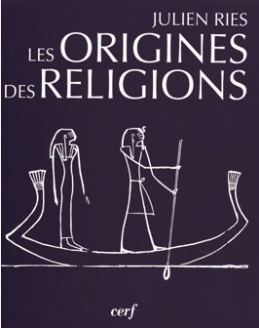Il y a 10 ans, le 23 février 2013, mourait, à l’âge de 92 ans, le prêtre et historien des religions Julien Ries. Sa mort survenait à peine plus d’un an après son élévation au rang de cardinal par Benoît XVI, qui avait voulu souligner non seulement la contribution éminente à la vie intellectuelle de cet universitaire belge, mais aussi l’articulation de cette vie intellectuelle à une vie de foi tout aussi exemplaire.
Je n’ai plus un souvenir clair du moment exact où, il y a environ une décennie, j’ai appris l’existence de ce vieux savant. Était-ce à l’annonce de sa création comme cardinal ou bien lorsque j’ai trouvé, à l’automne 2012, à la librairie Anne Sigier, une réédition de son livre de 1993 intitulé Les Origines des religions ? Qu’importe. Ce qui compte, c’est l’impression laissée en moi par cette découverte.
Il se trouvait donc dans l’Église catholique un éminent professeur, cardinal de surcroit, qui avait consacré toute sa carrière, à Louvain, à développer la discipline de l’anthropologie religieuse en inscrivant sa démarche – et c’est là ce qui m’a frappé – dans le prolongement de celle d’une des très influentes figures intellectuelles du 20e siècle dans le domaine de l’histoire des religions, Mircea Eliade (1907-1986).
Pour comprendre la fébrilité qui fut la mienne à ce moment-là (la vie intellectuelle est pleine d’émotions), il faut savoir l’influence déterminante qu’a eue Mircea Eliade sur mon cheminement spirituel. En effet, c’est en lisant Aspects du mythe (1963) pour un cours sur la mythologie grecque à l’automne de 1997, que la conviction que l’homme était foncièrement un animal religieux s’est ancrée en moi de façon définitive.
La lecture de cette étude sur la mentalité religieuse étudiée sous l’angle du mythe a infléchi le cours de ma vie intellectuelle, et de ma vie tout court, comme bien peu d’autres lectures l’ont fait par la suite. Seuls le Journal d’un curé de campagne (1936) de Georges Bernanos et La Mort de Virgile (1955) d’Hermann Broch ont eu un rôle aussi grand, voire plus grand, puisqu’ils m’ont conduit au seuil de la foi. Et c’est Thomas d’Aquin qui a savamment achevé le travail.
Une dialectique de l’objectif et du subjectif
Depuis 15 ans que j’avais lu Mircea Eliade, j’avais eu le temps d’adhérer à ses principales thèses, puis de m’en distancier. Car, passé un certain cap, je ne m’étais plus satisfait d’une approche qui entendait examiner la religion de l’extérieur. Le besoin d’éprouver directement la réalité du mystère (si jamais il existait) avait pris le dessus sur l’intérêt intellectuel pour une théorie qui avait pour fonction de le circonscrire, pas d’y plonger.
De plus, j’avais vu comment l’œuvre d’Eliade avait alimenté le courant ésotérique, et cela ne me disait rien qui vaille. Je n’ai donc pas poussé plus avant l’exploration de son œuvre. Me restait cependant cette certitude que l’effort de rationalité pouvait émerger du fond religieux de la culture humaine, mais qu’il ne pouvait prétendre s’en détacher ou le remplacer complètement qu’au prix d’une perte d’intelligence de la condition humaine.
Mais voilà qu’un éminent savant catholique, ayant eu reçu la caution du pape régnant, m’incitait à retourner du côté d’Eliade, pour apprécier ce que son œuvre pouvait avoir d’utile à la compréhension de l’homo religiosus, et – chose non négligeable pour un croyant qui fuyait les épistémologies rationalistes aux vertus sécularisantes – de catho-compatible. C’était vivre un émouvant retour à mes intuitions fondatrices.
*
L’effort de rationalité pouvait émerger du fond religieux de la culture humaine, mais il ne pouvait prétendre s’en détacher ou le remplacer complètement qu’au prix d’une perte d’intelligence de la condition humaine.
*
Plus encore, c’était une invitation à tenir ensemble ce qui, à un moment donné, avait pu m’apparaitre invinciblement incompatible : une posture d’analyse objectivante examinant l’homme religieux depuis l’extérieur, et une posture intérieure d’adhésion à Dieu. En me ramenant à Eliade, Ries m’a donc permis, après des années passées surtout à vivre la foi, d’effectuer la synthèse entre deux attitudes complémentaires.
La limite de l’approche objectivante de la science est sa tendance au réductionnisme rationaliste. La limite de l’approche croyante est qu’on peut rester dans l’immédiateté de l’expérience spirituelle, qui demeure alors irréfléchie, et qui peut, dès lors, courir le risque de ne pas bien se comprendre, ni finalement bien se vivre. Une dialectique de la méthode et de l’émoi offre une chance d’éviter ce double écueil.
Une approche contestée
Mais comment l’approche eliadienne est-elle appréciée aujourd’hui par les historiens de la religion ? Fait-elle encore école ? À part J. Ries, d’autres disciples ont-ils continué à penser l’homo religiosus en fonction de son «expérience du sacré»; à recenser la multiplicité des «hiérophanies» (des manifestations du sacré) pour en tirer une anthropologie religieuse structurée autour des notions de symbole, de mythe et de rite?
Autrement dit, la phénoménologie de la religion telle que théorisée et appliquée au fait religieux par Eliade, à partir des travaux précurseurs de Rudolf Otto (Le sacré, 1917) et de Gérard Van der Leeuw (La religion dans son essence et ses manifestations, 1933), et telle qu’elle s’est trouvée reprise et étoffée par J. Ries, est-elle encore vivante, ou fait-elle seulement partie de l’histoire de l’histoire des religions ?
Pour répondre à ces questions, j’ai consulté un ouvrage d’introduction à l’histoire des religions publié en 2017, et sobrement intitulé Introduction à l’histoire des religions. Son auteur, Jean-Marie Husser, professeur émérite de l’Université de Strasbourg, semble s’inscrire, en ce qui concerne sa conception du sacré, dans le prolongement lointain de la tradition sociologique durkheimienne.

Celle-ci fait de la religion à la fois une des fonctions ordonnatrices de la vie en société et un produit de cette même vie en société, en ceci qu’elle serait, comme le résume Jean-Paul Willaime dans Sociologie des religions (2017), une «transcendantalisation du sentiment collectif» découlant de l’expérience de dépendance et de révérence des individus à l’égard de la collectivité qui les englobe et les dépasse.
En ce qui a trait à la tradition éliadienne, Husser juge qu’elle est trop pleine de «présupposés philosophiques», et que sa notion phare, l’homo religiosus, est «parfaitement inutile pour la recherche historique, voire nocive à cette recherche». Seule l’école d’histoire des religions de Louvain (celle de Ries) y trouverait encore un intérêt, en ce qu’elle fournirait «un habillage moderne» aux thèses traditionnelles de l’anthropologie catholique qui voient dans l’homme un être ontologiquement disponible au divin.
Du refus du philosophique à son retour inévitable
On ne peut exprimer plus clairement son rejet. Mais ce n’est pas seulement l’approche phénoménologique qui se trouve disqualifiée et comme rejetée dans le domaine non scientifique, dans l’ouvrage passionnant de Husser, c’est l’ensemble de la longue tradition fondée sur ce qu’il appelle «le fonctionnement naturel de la pensée» (appelons-la la tradition philosophique), et qu’il oppose à la «démarche proprement scientifique, fondée sur l’histoire et les sciences sociales».
Cette tradition philosophique (puis théologique) a contre elle d’avoir cherché passionnément le divin, au lieu de faire de la religion, de façon dépassionnée, et donc plus propice à la connaissance objective, «un objet d’observation et d’analyse au même titre que l’art, la politique ou l’économie». La science peut évidemment être elle-même la proie des passions idéologiques, mais son ambition demeure, et il faut donc la prendre au sérieux au lieu de seulement pointer ses failles et ses ratés.
La mise à distance qu’elle invite et force à faire, depuis que les méthodes positives se sont imposées comme principales matrices du vrai, est salutaire. Elle dégage l’horizon, et confère à l’homme, tiré du milieu de ses croyances héritées, de ses évidences et de ses expériences immédiates, une liberté nouvelle. Mais ce pas en arrière est-il fait pour durer toujours ? L’esprit est-il fait pour se figer définitivement dans une posture de repli critique ? Ou, au contraire, l’homme n’est-il pas «embarqué» (Pascal) et sommé de choisir ?
Celui qui, aujourd’hui, veut défendre la foi contre les réductionnismes rationalistes se trouve dans la situation inattendue de devoir d’abord défendre la rationalité philosophique contre un esprit scientifique qui prétend avoir le «monopole des moyens de production» des certitudes fondées en raison.
Embarqué, c’est-à-dire personnellement précipité dans l’existence et placé devant la nécessité: 1) de tabler sur quelque chose (Pascal parlait de pari); et 2) d’organiser tant bien que mal sa vie en vue de ce quelque chose. Car, si par l’esprit nous pouvons effectivement comprendre le monde, il n’en demeure pas moins qu’en dernière instance, c’est le monde qui nous «comprend» (encore Pascal) et que cette situation existentielle appelle un positionnement lui aussi existentiel, et non seulement théorique.
Cela, le scientifique ne peut le nier. Et s’il s’obstine à le refuser en s’enfermant dans une posture de suspension permanente du jugement au nom de la science, il ne pourra justifier ce refus de se positionner autrement que par des raisons philosophiques. Car la démarche scientifique dont il se réclame n’est pas faite pour fournir un jugement global sur l’existence et sur la meilleure manière de l’assumer, mais pour collecter, ordonner et analyser des données; seule la philosophie (et la religion) le peuvent.
La source du sacré
Celui qui, aujourd’hui, veut défendre la foi contre les réductionnismes rationalistes se trouve dans la situation inattendue de devoir d’abord défendre la rationalité philosophique contre un esprit scientifique qui prétend avoir le «monopole des moyens de production» des certitudes fondées en raison.
Mais la situation n’est pas nouvelle. Il y a près d’un siècle déjà que Paul Valéry, constatant probablement l’inexorable avancée des sciences, avait partagé ce constat à l’abbé Mugnier: «La philosophie est en train de rejoindre la théologie dans les vieilles lunes.» (Journal de l’abbé Mugnier, 5 juin 1931)
Valéry était «un païen» (Journal, 10 juin 1938) dont la règle de vie se résumait à ceci: «Faire, sans croire» (Journal, 24 février 1933). Étranger à toute inquiétude métaphysique, il considérait que la religion n’était plus défendue par les gens de droite que pour des raisons bassement intéressées; que la foi, c’est «la force de fabriquer le vrai» (Journal, 25 mai 1922); et que le devoir est de douter. La philosophie, donc, ne valait désormais guère mieux que la foi. Elle n’était qu’une autre «fabrique du vrai». Quant à l’apologétique, il la réduisait à «l’art de faire de bons chrétiens avec de mauvais raisonnements» (25 mai 1923).

La vérité du langage, selon Valéry, est qu’il est essentiellement une puissance poïétique (une puissance d’invention, de fabrication). La part de vérité que contient cette théorie ne doit pas occulter le fait que l’esprit n’est pas qu’une machine à s’enivrer avec ses propres émanations poéticosymboliques.
Car la pensée ne serait plus alors apte qu’à produire des «effets de sens» se détachant artistiquement d’un incurable fond d’inconnaissance. Et le sens ne serait plus qu’une illusion, de laquelle l’esprit resterait prisonnier, jusqu’à ce qu’il s’en libère par un doute intégral et systématique (option privilégiée par Valéry).
Sous ce rapport, la pensée de Valéry se présente comme une variante du nietzschéisme qui s’est complu à rabattre le vrai sur le beau, pour faire de l’esthétisation (c’est-à-dire de la réduction de toute entreprise intellectuelle à une quête de nature artistique) le dernier mot de la culture et le seul horizon viable de la vie de l’esprit. Pourtant, l’esprit s’est montré apte à entrer en contact avec le réel, par les deux voies des mathématiques et des langues.
Et que dire de la grâce qui, dans l’immédiateté d’une illumination, nous donne accès à l’ordre transcendant, et nous enjoint, par sa douce infiltration ou sa soudaine présence, de passer de cette crispation intellectuelle parfaitement contraire à la vie de l’esprit qu’est le refus sceptique de conclure, à l’acceptation plénière d’une vérité révélée qui permet l’épanouissement de l’esprit autant que de l’espoir.
On en revient à la question que l’héroïque Énée posait à son ami: «Sont-ce les dieux qui donnent à nos âmes cette ardeur, Euryale, ou chacun se fait-il un dieu de son irrésistible désir?» Pour Ries, il n’est pas possible de ramener le sacré à un pur phénomène de projection du désir par la psyché. Pour lui, le substrat du religieux déborde le cercle de la conscience individuelle comme celui de la conscience collective, parce que celles-ci n’en sont pas, en dernier ressort, la source.
Le sacré (d’aucuns diront le numineux (R. Otto) ou le divin) possède donc sa réalité propre, même s’il n’est discernable scientifiquement qu’à travers le prisme de l’expérience psychologique de l’homo religiosus, et même si cette expérience reste en partie fuyante, insaisissable, malgré le déploiement de tout un appareil réflexif et conceptuel structuré autour de notions clés (comme celles d’archétypes, d’hiérophanies, etc.) censées le cerner.
Pour Ries, il n’est pas possible de ramener le sacré à un pur phénomène de projection du désir par la psyché. Pour lui, le substrat du religieux déborde le cercle de la conscience individuelle comme celui de la conscience collective, parce que celles-ci n’en sont pas, en dernier ressort, la source.
Jésus avait averti Nicodème du fait que l’élément transcendant, pour réel qu’il soit, demeurait inexorablement hors de l’emprise intellectuelle de l’homme: « Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d’où il vient ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l’Esprit. » (Jn 3,8) Mais ce que ce souffle venu d’en-haut a d’insaisissable n’empêche pas qu’il est, parfois, mystérieusement, «sensible au cœur» (toujours Pascal).
Le fait qu’on l’entende, qu’on en éprouve intérieurement la présence, n’enlève rien cependant à son caractère évanescent. Et une partie de l’explication tient au fait que cette réalité fugitive n’est pas qu’un simple concentré d’énergie susceptible de se manifester inopinément, à la manière d’un magma d’amour qui ferait soudainement irruption au fond de l’âme, mais qu’il est une liberté qui, au jour choisi, décide de se révéler à notre liberté comme amour.
Et cette révélation peut prendre des formes différentes, parfois spectaculaire, comme le «feu» du Mémorial de Pascal le laisse deviner:
L’an de grâce 1654. Lundi 23 novembre, jour de St Clément pape et martyr et autres au martyrologe. Veille de St Chrysogone martyr et autres. Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ minuit et demi. Feu Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ…
Blaise Pascal ou quand l’insaisissable nous saisit.