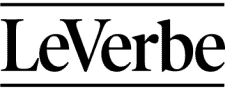Professeur de science politique à l’université de Notre-Dame, Patrick Deneen est connu pour son livre Pourquoi le libéralisme a échoué, un ouvrage fondamental de philosophie politique. Parmi ses nombreuses contributions médiatiques, on peut souligner son rôle au comité de rédaction de New Polity et sa collaboration à Compact. Son travail est disponible sur The Postliberal Order, une infolettre Substack à laquelle il participe avec d’autres universitaires qui prennent part à une réévaluation critique du libéralisme. Il nous fait le plaisir et l’honneur de cet entretien.
Le Verbe : L’une des principales caractéristiques de votre travail est une enquête approfondie sur les échecs du libéralisme, notamment dans votre livre Pourquoi le libéralisme a échoué. Vous avez dit que «le libéralisme a échoué parce que le libéralisme a réussi». C’est une façon quelque peu mystérieuse de présenter les choses. Que voulez-vous dire par là ?
Patrick Deneen : Ce n’est pas aussi contradictoire que cela peut paraitre. Si le projet est erroné, ou s’il est basé sur des prémisses fausses, alors une fois qu’il a réussi, ces prémisses fausses sont révélées. En un sens, le libéralisme a échoué parce que ses prémisses ont été pleinement révélées à notre époque.
On dit souvent que l’innovation fondamentale du libéralisme a été d’instaurer une compréhension radicalement nouvelle de la notion de liberté, différente de la manière dont elle était comprise dans le contexte de la pensée classique ou chrétienne. Est-ce bien cela qui est en jeu ici?
Le libéralisme a commencé comme un projet philosophique, il y a des centaines d’années, mais n’a atteint une sorte d’apogée politique qu’au 20e siècle, et sans doute au cours des dernières décennies, une fois qu’il a éliminé les anciens héritages qui avaient dissimulé la nature réelle de l’ordre libéral.
Le libéralisme s’appuie en effet sur un mot très ancien, le mot liberté, que l’on retrouve bien sûr dans les textes classiques: on le retrouve chez Aristote et Platon, on le retrouve dans la Bible – «la vérité vous rendra libres» (Jn 8, 32). C’est un concept très ancien, mais il avait un sens très différent de celui qu’il a pris dans la tradition libérale.
Être libre signifiait autrefois être un être humain individuel autonome, dans lequel les éléments supérieurs de notre nature gouvernent les éléments inférieurs. Ce sens a été transformé dans la tradition libérale pour signifier être libre de tout obstacle pour atteindre les objets de notre désir et de notre volonté. Ainsi, d’une certaine manière, on pourrait dire que la liberté en vient à signifier l’exact opposé de ce qu’elle avait signifié dans la tradition précédente.
Être libre signifiait autrefois être un être humain individuel autonome, dans lequel les éléments supérieurs de notre nature gouvernent les éléments inférieurs.
Afin de réaliser cette nouvelle définition de la liberté, l’ordre libéral a dû, dans un sens, démonter ou redéfinir chaque institution, pratique et tradition qui avait été érigée pour réaliser l’ancienne compréhension de la liberté. Tout, des universités aux églises, en passant par la famille et les communautés humaines, a dû être, d’une certaine manière, soit désassemblé, soit réassemblé ou redéfini pour atteindre le nouvel objectif.
Les deux façons d’atteindre ce but sont, premièrement, de libérer les êtres humains des autres. Il s’agit de nous rendre libres de tout sentiment de devoir, d’obligation ou de responsabilité, envers tout autre être humain particulier. Nous sommes considérés comme les plus libres lorsque nous sommes libérés des obligations directes que nous avons envers des personnes, qui sont à la fois de notre temps et de notre monde, mais aussi des personnes qui nous ont précédés, nos ancêtres, et celles qui nous succèderont, nos héritiers. Lorsque nous sommes libérés d’un sentiment de responsabilité à la fois envers leur mémoire et en prévision des vies à venir.
Nous réduisons le sens de notre responsabilité individuelle à la seule fabrication de soi, à l’autocréation du soi libéré. Cela conduit à toutes sortes de pathologies que nous pouvons commencer à documenter : la croissance de formes toujours plus radicales d’autonomie individuelle, qu’elles soient particulièrement louées par nos élites aujourd’hui, ou qu’elles soient subies de bien des manières par ceux qui ne réussissent pas aussi bien dans notre société; la montée des morts de désespoir; l’effondrement des institutions sociales, surtout celles qui sont nécessaires pour soutenir l’épanouissement humain.
Cela a eu des effets terribles, surtout sur les plus vulnérables de nos sociétés, et nous voyons toutes sortes de preuves du naufrage de ce projet.

Et quel est le deuxième moyen utilisé pour réaliser cette conception moderne de la liberté ?
C’est la conquête de la nature. La nature représente la deuxième grande limite à notre capacité de faire ce que nous voulons. Le projet moderne qui coexiste avec le libéralisme est la science moderne. Son objectif et son ambition majeurs sont de libérer les êtres humains des limites du monde naturel.
Cela est vrai à la fois dans la manière dont nous voyons la dévastation de notre environnement, des choses que le pape François a décrites avec force dans son encyclique Laudato si’. Mais bien sûr, nous le voyons aussi dans l’effort pour étendre ce projet à la personne humaine et à la nature humaine. L’un des développements les plus extraordinaires des temps modernes consiste à considérer le corps humain comme un sujet soumis à la domination scientifique et technologique.
Nous commençons vraiment à nous heurter à une contradiction qui nous indique que ce que c’est d’être humain, c’est de démonter tout ce que nous pensons être humain. Nous nous heurtons à cette contradiction.
Le monde nous donne donc un retour. Il nous donne un retour sur l’anémie sociale et l’effondrement de notre ordre. Il nous donne un retour dans le monde naturel, en matière de changement climatique et d’épuisement des ressources, à travers les piles de déchets que nous avons dans nos océans et sur nos terres. Il nous répond également par le type de dysfonctionnement social qui, selon moi, demeure la marque de fabrique de notre politique actuelle.
Nous avons tendance à penser que notre politique est marquée par les divisions partisanes et l’incivilité. Mais peut-être que ce que nous devons vraiment voir, c’est qu’un ordre politique qui repose sur une fausse idée de la liberté est un ordre qui ne sera pas durable, qui ne pourra pas fonctionner. Et donc, je pense que nous avons, dans toutes les mesures empiriques auxquelles nous pouvons penser, la preuve que le libéralisme a échoué parce que le libéralisme a réussi.
Pour de nombreuses personnes qui se considèrent aujourd’hui comme des libéraux classiques, souvent associés au conservatisme, le véritable problème est le libéralisme progressiste. D’après ce que vous avez dit, ce dernier est une conséquence de la volonté d’instaurer une vision radicale de la liberté individuelle qui a rendu impossible l’expression de désaccords sur les choix de quiconque. Les libertés formelles qui étaient censées être garanties par l’ordre libéral sont donc aujourd’hui remises en cause sur la base d’une forme plus avancée de libéralisme. Le conservatisme le plus courant à notre époque n’est-il donc pas qu’un libéralisme qui ne dit pas son nom?
Les libéraux classiques pensent que l’on peut arrêter la logique du libéralisme à un point où l’on est satisfait. Ils se différencient aujourd’hui des libéraux progressistes parce qu’ils veulent faire valoir que la forme de liberté qu’ils préfèrent peut et doit être librement choisie par les individus, et non imposée ou forcée par une autorité politique ou sociale.
Mais la contradiction que nous voyons entre le libéralisme classique et le libéralisme progressiste est en fait moins une contradiction qu’une simple différence à propos de la progression logique. Je pense que cette progression logique est particulièrement visible dans la pensée d’un héros du libéralisme classique, John Stuart Mill.
Je renvoie toujours ceux qui se posent ces questions à l’ouvrage de John Stuart Mill intitulé Sur la liberté, qui est souvent considéré comme l’expression paradigmatique du libéralisme classique, selon lequel les gens devraient être libres de faire ce qu’ils veulent tant que personne n’est lésé dans la poursuite de ce qu’il désire.
L’argument de Mill est que le plus grand danger du choix individuel ne vient plus du domaine politique. Il vient du domaine social. Dans cet essai, il parle longuement de ce qu’il appelle le «despotisme de la coutume». Le despotisme de la coutume est le despotisme qu’il considère comme émanant non pas de l’autorité politique en soi, mais de la société dans son ensemble, des normes, des traditions, des coutumes qui imprègnent une société, qui ne sont pas nécessairement inscrites dans un code juridique.
Ce sont exactement les coutumes, les traditions et les codes qui sont attaqués, sapés et démantelés par les libéraux progressistes aujourd’hui. C’est précisément ce qui, selon Mill, doit être limité et même, en fin de compte, déconstruit pour que l’individu puisse choisir, véritablement libre de toute influence de la société dans son ensemble.
Le laissez-faire caractéristique du libéralisme classique doit nécessairement être mis de côté au profit du libéralisme progressiste que nous connaissons aujourd’hui. C’est pourquoi le libéralisme classique n’est finalement pas une alternative par rapport au progressisme, car le progressisme est en fait le libéralisme classique dans un état plus avancé.

On ne peut pas contester le principe suivant lequel les mêmes causes produiront les mêmes effets.
Oui, exactement. Il semble bizarre de faire ainsi appel à quelque chose qui n’a pas fonctionné. C’est une situation très étrange que de faire la même chose encore et encore, en espérant que cela fonctionnera la prochaine fois.
Les fondateurs intellectuels du libéralisme étaient souvent des contradicteurs de l’Église catholique, à une époque où son autorité était de plus en plus remise en question. Cela a été l’un des plus grands défis historiques de l’Église. Quels impacts sur elle peut-on prévoir alors que le libéralisme fait à son tour l’objet d’une réévaluation critique?
J’aimerais avoir une boule de cristal pour voir ce que l’avenir nous réserve. Je pense que les futurs leadeurs et articulateurs de la vision de l’Église se tourneront bien sûr vers la tradition, qui est ininterrompue et cohérente au fil des siècles, mais qui tente toujours de comprendre les enseignements éternels de l’Église en lisant les signes des temps et en examinant l’ensemble particulier de défis contemporains auxquels elle est confrontée.
Le début de la doctrine sociale de l’Église remonte à l’encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII, qui porte sur les «choses nouvelles». L’effort de cette encyclique était – ce que l’enseignement social demeure – de prendre les enseignements éternels de l’Église et de les mettre en conversation avec les circonstances changeantes de notre époque contemporaine, et de tenter de les comprendre dans ce contexte.
Et quelles sont les choses nouvelles que Léon XIII examinait? C’était la montée de la révolution industrielle. C’était la montée de nouvelles idéologies politiques. Les deux qu’il mentionne sont essentiellement le libéralisme et le socialisme, qui n’existaient pas au Moyen Âge. Il s’agissait de l’effort de l’Église pour penser ses enseignements dans le contexte de circonstances politiques, sociales et économiques changées et en constante évolution.
Je pense que les circonstances qui ont conduit à une sorte de rapprochement entre le catholicisme et le libéralisme, en particulier au milieu du 20e siècle et sous les pontificats de Jean-Paul II et de Benoît XVI – qui n’étaient ni l’un ni l’autre des libéraux et qui ne se sont pas contentés d’approuver le libéralisme – ont été, après la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, la montée de l’Union soviétique et la menace du communisme.
L’Église s’est efforcée de comprendre comment coexister et peut-être corriger le libéralisme au cours de ces décennies. Je pense que nous sommes à une époque très différente et que l’évaluation du libéralisme par l’Église va refléter, dans le cadre de sa longue tradition, une compréhension très différente de ce qui constitue la grande menace pour la vision catholique de la personne humaine et de la société humaine et, en fin de compte, de la destinée de l’âme humaine.
Je pense qu’en lisant les signes du temps, il ne fait aucun doute que l’Église va commencer à penser différemment les grands défis posés par l’ordre libéral.
Ce n’est pas imminent, mais je pense que cela va certainement réussir de mon vivant. Je pense qu’en lisant les signes du temps, il ne fait aucun doute que l’Église va commencer à penser différemment les grands défis posés par l’ordre libéral.
Certains diront que le libéralisme que vous et d’autres avez si largement déconstruit ces dernières années continue à déterminer fondamentalement les conditions de possibilité de nos vies politiques, sociales et familiales. Ses détracteurs s’efforcent souvent de définir, en termes plus pratiques, une porte de sortie, pour ainsi dire. Qu’attend-on d’un ordre postlibéral? Comment y parvenir?
Il y a déjà, à mon sens, des signes très encourageants de changements significatifs qui se produisent dans le monde politique. De plus en plus de personnalités politiques adoptent et défendent des positions qui sont tout à fait compatibles avec les écrits d’un certain nombre d’entre nous et qui, je pense, s’en inspirent à bien des égards. Nous observons attentivement des candidats comme J. D. Vance dans l’Ohio, qui vient de remporter l’investiture pour le Sénat.
Vous le voyez dans les changements qui se produisent dans le monde des think tanks. Je veux dire des changements lents, dans certains cas. Plus la base des donateurs est classiquement libérale, plus elle est résistante. Ces changements se produisent et méritent d’être observés, car les dirigeants les plus avisés de ces institutions reconnaissent qu’il existe un décalage important entre leur programme politique et l’orientation probable de leur électorat et de l’avenir du mouvement politique qu’ils représentent.
Mais surtout, en tant que professeur d’université, je le vois dans l’enthousiasme et l’intérêt des jeunes penseurs, ceux qui seront les dirigeants de ce pays et d’autres pays dans 20 ans. Ce ne sont pas des républicains à la Ronald Reagan. Ils ne sont pas de grands admirateurs du libéralisme et ils reconnaissent que le monde dont ils héritent, le désordre dans lequel nous sommes, a été généré exactement par le succès des prémisses du libéralisme.
Ils sont donc à la recherche d’alternatives. En ce sens, je pense que l’avenir est plus prometteur que ce que nous pouvons lire dans les gros titres d’aujourd’hui pourrait suggérer. Et c’est pourquoi je ne suis pas aussi pessimiste que quelqu’un comme Rod Dreher, parce que j’interagis très souvent avec une jeune génération de personnes ambitieuses, brillantes, réfléchies, intellectuellement engagées, qui cherchent à changer le débat et la trajectoire des puissances occidentales, et certainement des États-Unis. Je pense qu’il y a une source d’espoir considérable.
Il est intéressant de voir, en comparaison, à quel point le discours est différent dans mon propre pays, le Canada, où une telle réévaluation critique du libéralisme semble impensable, et où diverses formes de libéralisme restent si profondément influentes.
C’est peut-être malheureux, mais les États-Unis ne sont pas seulement un hégémon économique et militaire, mais aussi culturel, comme le Canada le sait très bien. Ce que vous pourriez décrire comme le dysfonctionnement que nous constatons aujourd’hui au Canada ou en Europe occidentale a des racines considérables dans l’exportation de l’idéologie libérale américaine dans le monde entier.
J’ai l’espoir, pour des pays comme le Canada ou l’Irlande d’où mes ancêtres ont émigré, qu’ils finiront par se rendre compte qu’ils ont été colonisés. Ils ont été colonisés d’une manière non moins approfondie, et peut-être plus insidieuse, qu’ils ne l’ont été autrefois – dans le cas de l’Irlande, par les Britanniques à une époque antérieure.
Une fois qu’ils auront reconnu la nature de cette colonisation, j’ai quelque espoir qu’une sorte de fierté pour leur propre tradition, pour ce qu’ils ont trop vite sacrifié au nom d’une sorte de faux dieu du progrès, reviendra au premier plan. Des pays comme le Canada et les nations d’Europe occidentale ont des ressources et des traditions vraiment profondes. En fait, à certains égards, ils ont des racines plus profondes que nous en Amérique. Le Canada, entre autres, a George Grant.
Le Canada, l’Irlande, la France, l’Italie, l’Espagne, les grandes nations catholiques ont toutes ces ressources extraordinaires qui sont à redécouvrir. J’ai l’espoir raisonnable qu’au fur et à mesure que l’imperium américain s’effrite, et que la faillite, au sens propre comme au sens figuré, des États-Unis devient plus visible, les gens vont chercher à redécouvrir ce qu’ils ont sacrifié à l’autel de ce faux dieu du progrès.
Ils redécouvriront leurs propres traditions, et ce sera un grand moment de révélation pour ces nations et ces peuples.