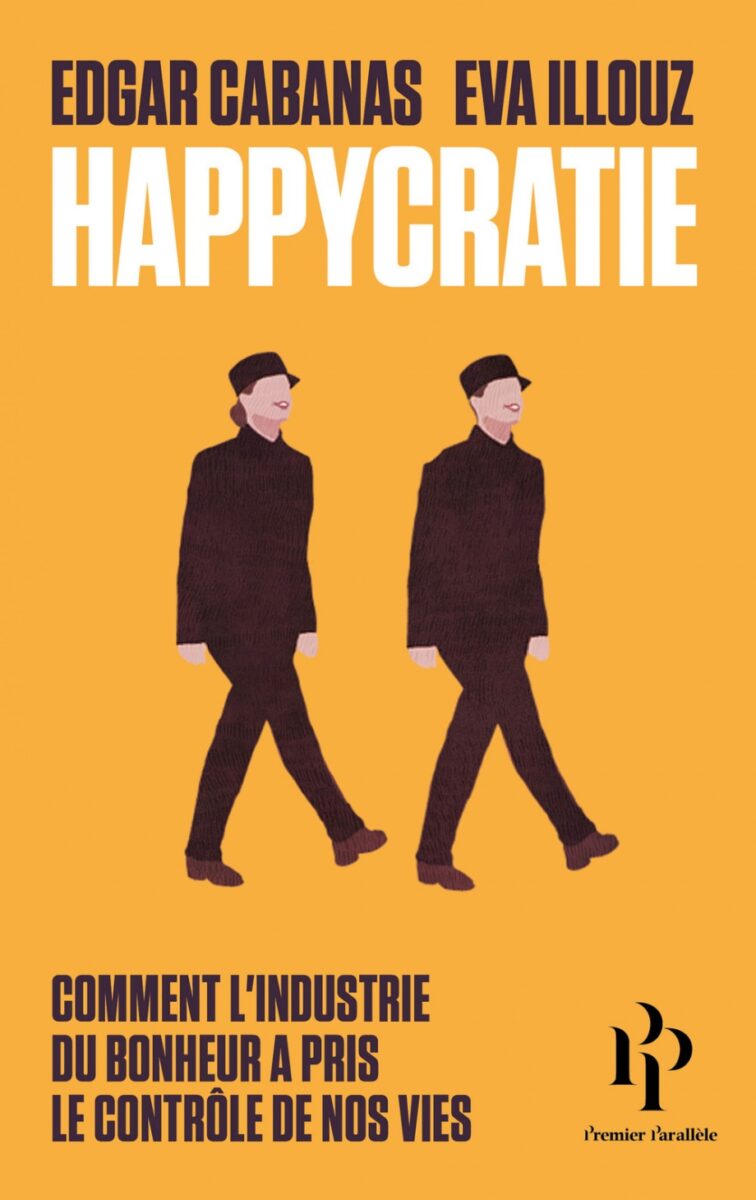Vous voulez être heureux? Il vous faut un coach, un expert du moi, qui vous aidera à découvrir votre authenticité cachée. Suivez ses conseils, appliquez ses techniques et vous le saisirez enfin, ce bonheur qui, telle une truite frétillante, ne cesse de vous glisser entre les doigts. Voilà l’une des promesses qui nous sont proposées sur les étals du marché florissant du bonheur individuel. Cette promesse interpelle Eva Illouz, sociologue franco-israélienne et professeure à l’Université hébraïque de Jérusalem. Le bonheur, vu par les marchands du temple.
Le Verbe: La quête effrénée du bonheur, est-ce une lubie de l’homme moderne?
Eva Illouz: En fait, la recherche d’une sorte de bienêtre psychique n’est pas du tout nouvelle. Les Grecs avaient déjà le concept de l’eudaimonia, qui signifiait «la vie bonne». Ensuite, il y a eu aussi les stoïques, qui essayaient de comprendre la nature de la souffrance pour mieux la surmonter. Leur recette était: puisque j’ai peu de prise sur le monde, ce que je dois changer pour être heureux c’est moi-même, en maitrisant mes désirs, en diminuant mes attentes.
Chez les juifs, on retrouve l’idée que la vertu contient en elle-même sa propre récompense et donc qu’une personne vraiment vertueuse, en l’occurrence qui suivrait tous les commandements de la Torah, serait ipso facto heureuse.
Un autre exemple: au 18e siècle, dans la constitution américaine, dans l’affirmation de la dignité et des droits de l’individu, Jefferson a ajouté un droit essentiel, celui de la poursuite du bonheur. Si l’on replace cela dans le contexte historique, le fait d’y inscrire le bonheur était quand même révolutionnaire à cette époque.
Bref, ce n’est pas nouveau. Pourtant, cette quête du bonheur a changé dans le dernier siècle.
Dans mon livre Happycratie, je me suis intéressée à l’intégration récente de l’idée de bonheur dans le marché de consommation. À la marchandisation du bonheur. Plus précisément, j’ai observé un courant particulier, celui de la psychologie positive, apparu dans les années 1990 et qui affirme que la psychologie telle qu’elle s’est pratiquée jusqu’alors s’est trompée, et cela parce qu’elle s’est focalisée sur la souffrance humaine. Au contraire, selon cette nouvelle psychologie positive, ce qu’il fallait désormais affirmer, c’était la capacité de l’être humain à surmonter toute souffrance, tout traumatisme, tout choc, aussi violent qu’il soit, par la simple puissance de la volonté.
C’est cette version particulièrement consumériste du bonheur, qui finalement nie la valeur éducative de la souffrance, voire la présence même de la souffrance, son inéluctabilité dans la vie humaine, que l’on retrouve de plus en plus aujourd’hui.
Il n’y a vraiment aucune place à la souffrance dans cette psychologie?
Non, aucune. On ne reconnait pas la souffrance, sauf pour la dépasser. On la voit comme une mauvaise prédisposition de l’esprit. Ce qui faisait la base d’une grande partie des spiritualités est finalement nié: le Bouddha qui devient le grand maitre spirituel parce qu’il comprend et voit la souffrance; le Christ aussi, qui voit la souffrance et qui est capable de lui parler. Le Christ a souffert, et la notion d’imitatio Dei, d’imitation du Christ, est une notion très forte dans la vie du chrétien et fait une grande place à la Passion.
Les adeptes de la psychologie positive jettent au panier la souffrance. Ils ne lui reconnaissent aucune valeur éducative, spirituelle, politique. Ils se voient eux-mêmes comme porteurs d’une nouvelle vérité, messagers d’une nouvelle religion en quelque sorte. La psychologie positive a créé une nouvelle stratification ou hiérarchisation des émotions. D’un côté le bienêtre menant au bonheur, de l’autre la souffrance menant au malheur. La science du bonheur force à choisir entre souffrance et bienêtre, comme si toutes les émotions négatives devaient être rejetées.
Selon vous, on vit désormais dans une tyrannie du bonheur.
Ça devient tyrannique lorsque c’est intégré dans des institutions qui font de la mentalité positive un ingrédient et un signe de réussite sociale. Les tyrans de la positivité font du bonheur une ressource monnayable, qui rapporte socialement. Par exemple, les gens positifs sont ceux que l’on veut le plus recruter dans les entreprises.

Que nous impose cette nouvelle tyrannie?
Pour moi, il est presque axiomatique [NDLR: évident, au point d’être indémontrable] d’affirmer que la rencontre avec le monde, pour la plupart d’entre nous, est douloureuse et difficile. Ou en tout cas semée d’obstacles et de déceptions. Et dans cette interaction, ce que le monde nous demande est complexe. Nous devons être à la fois beaux, riches, intelligents, performants dans des tas de domaines très différents. L’injonction au bonheur de la psychologie positive nous dit que, lorsque nous n’y arrivons pas, c’est parce que nous n’avons pas suffisamment bien essayé. C’est d’abord l’idée qu’il faut être satisfait de tout ce qu’on a. C’est ensuite l’idée que, si nous ne sommes pas satisfaits, si nous continuons à souffrir, le problème vient de nous. Il ne vient jamais du monde. Le bonheur est le but de l’existence, et le rater est un échec individuel.
La quête du bonheur est un fardeau que chacun doit porter par lui-même et pour lui-même?
Oui, tout à fait. Martin Seligman, le père de cette psychologie, donne un exemple de cette idée. Deux personnes qui travaillaient à Wall Street ont été renvoyées. L’un sombre dans la déprime et l’autre arrive à s’en sortir. Il trouve un nouveau travail, beaucoup moins bon et pour lequel il doit quitter la ville dans laquelle il habitait, mais il retombe sur ses pieds. Selon Seligman, celui qui n’y arrive pas est coupable. Il est coupable de se vautrer dans le sentiment de l’échec.
Ce qu’on nous demande aujourd’hui, c’est de devenir une sorte d’entrepreneur de notre propre personne. Un entrepreneur du moi. Constamment travailler les conditions pour que notre moi s’améliore. Il y a même une idée, que je trouve scandaleuse: la post-traumatic growth, qui affirme que, quand quelque chose de vraiment terrible nous arrive, nous devons être capables non seulement de la surmonter en puisant dans nos ressources cachées, mais également d’y trouver une source d’épanouissement.
Ce qu’on nous demande aujourd’hui, c’est de devenir une sorte d’entrepreneur de notre propre personne.
C’est là le tour de force de la mentalité positive. Si la psychologie classique s’adressait uniquement aux personnes en souffrance, la psychologie positive a réussi quant à elle à ouvrir le marché gigantesque et inexploité des personnes «saines» et «normales». Elle y est parvenue en invitant tous les individus à réaliser un travail sur eux-mêmes, au risque de devenir des «happycondriaques», abimés dans leur vie intérieure, occupés à se gérer et à se corriger. Il va sans dire qu’un monde où chacun est tenu responsable de sa souffrance réserve peu de place à la pitié et à la compassion.
Justement, la souffrance, symbolisée par la croix dans la foi chrétienne, a un sens, car elle est intimement liée au fait de donner sa vie pour l’autre. Ici, l’individu cherche le sens uniquement en lui-même?
Oui, on est complètement centré sur l’individu. On a cherché à voir les affinités entre cette façon de penser la souffrance et l’idéologie néolibérale, qui dit que l’individu est responsable de tout ce qui lui arrive, qui déclare finalement qu’il n’y a pas de communauté, qu’il n’y a pas de solidarité et que l’État ne doit pas être l’incarnation de la solidarité qui doit exister entre les citoyens. C’est ça l’idée néolibérale, de dire que toutes les formes supra-individuelles qui incarnent la solidarité sont caduques et qu’elles doivent être dépassées par le travail énergique que les individus doivent faire sur eux-mêmes pour maximiser leur potentiel.
Donc, il n’y a plus de place pour la spiritualité et la communauté dans cet environnement?
En fait, comme souvent le bien social fait défaut, on se tourne quand même vers de nouvelles formes de spiritualités qui sont des sortes de mélanges syncrétiques de plusieurs choses et qui, surtout, ne sont plus ancrées dans les religions établies. Elles sont davantage des substituts d’autogestion psychologique. Par exemple, la mindfullness et la médiation, qui viennent vaguement d’Asie. Elles sont en vogue, car elles sont présentées comme des techniques de maitrise de soi.
C’est paradoxal, car les sociétés contemporaines produisent beaucoup d’angoisse, d’anxiété et d’incertitude. Et pour composer avec elles, on demande à l’individu d’avoir recours à lui-même, de se regarder et d’espérer pouvoir maitriser les conditions d’une angoisse et d’une incertitude qui pourtant ne viennent pas nécessairement de lui.
Finalement, chercher à tout prix le bonheur, est-ce une bonne idée?
Bien sûr, je ne veux en aucun cas valoriser la souffrance en tant que telle. Mais il faut aussi ne pas culpabiliser ceux qui n’y arrivent pas. Et il faut se souvenir de la créativité étrange et paradoxale qui peut parfois émaner de la souffrance psychique. Dans la souffrance, nous pouvons potentiellement découvrir notre propre vulnérabilité. Et seule l’expérience de cette vulnérabilité peut nous pousser à la compassion.