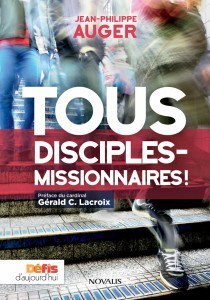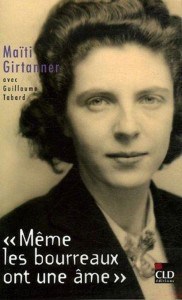Notre lecteur compulsif Alex La Salle nous gratifie ici de quelques recensions initialement publiées dans l’édition papier de la revue Le Verbe. Bonne lecture!
*
La fécondité des petits groupes
Une dépêche du printemps nous le confirmait: la grande braderie continue! La grande liquidation du parc immobilier de l’Église bat son plein! Et les choses vont rondement! Depuis 2011, on se débarasse de quarante lieux de culte déplâtrés par année, pour un total d’environ 500 bâtiments fermés ou vendus depuis 2003. Ce qui constitue 18 % de l’ensemble des 2751 nefs qui accueillaient les Québécois il y a encore quatorze ans.
On serait tenté un instant de dire qu’un arbre qui tombe fait plus de bruit qu’une forêt qui pousse, mais quand c’est la forêt de clochers qui tombe sans que la moindre pousse ne retrousse, on se découvre subitement à court de proverbes rassurants. Et la situation nous apparait dans son accablante réalité.
Aujourd’hui, deux options s’offrent à nous: ou bien nous regardons jusqu’à la fin notre Église tomber en quenouille, ou bien nous recommençons tout depuis le début, en amorçant à nouveaux frais une réflexion sur le modèle ecclésiologique le plus susceptible de réinscrire la foi dans le paysage (d’abord mental) de nos contemporains.
J.-P. Auger a choisi la réflexion et fait maintenant la promotion d’un modèle ecclésiologique de plus en plus mis de l’avant par les chrétiens engagés dans la nouvelle évangélisation, celui de l’Église conçue comme communauté de disciples-missionnaires. Le développement de ce modèle repose sur un processus de formation intégral des croyants, dont la visée est le partage, par tous, du mandat missionnaire. Cette façon particulière de faire Église mise judicieusement sur la fécondité des petits groupes et sur le rôle clé qu’y jouent les leadeurs pour assurer la croissance du Corps du Christ.
Pour tous ceux qui veulent commencer à réfléchir à l’enjeu crucial de la conversion missionnaire des communautés chrétiennes, voilà un bon point de départ.
Jean-Philippe Auger, Tous disciples-missionnaires!, Novalis, 2017, 232 pages.
*
Le loisir, fondement de la culture
Cet ouvrage, initialement paru en 1947, propose une réflexion critique sur le monde moderne, royaume de l’animal laborans (Hannah Arendt) tout occupé à produire puis à consommer sa ration quotidienne de biens périssables et à assurer la régularité de son transit intestinal, en ne s’élevant que périodiquement au-dessus des «nécessités premières» pour s’adonner au loisir, compris pauvrement comme temps de pause et d’amusement, en vue d’un réengagement rapide dans le travail, cœur de la vie des cités et des hommes selon le vœu de Wall Street.
Revenant, après l’avènement de la bourgeoisie, à la conception aristotélicienne du loisir, qui fait de ce dernier non pas le moyen du travail efficace (on se repose pour mieux travailler), mais la finalité du travail efficace (on travaille en vue d’avoir du loisir), le philosophe Josef Pieper nous appelle à redécouvrir la valeur et le sens profond du loisir (skholè, en grec), qui était compris par les Anciens comme fondement de la culture, c’est-à-dire comme condition sine qua non de la vie intellectuelle et spirituelle, et donc de la civilisation tout entière.
Pour se persuader qu’un lien essentiel unissait jadis loisir et culture, pour revenir avec empressement à la conception originelle que les Grecs avaient de celui-là, il suffit de constater la fortune qu’a connue historiquement le mot skholè, sur le plan étymologique.
En effet, skholè a donné schola en latin, Schule en allemand, school en anglais, et école en français. Comme l’écrit l’éminent penseur désireux de nous réorienter vers une conception plus substantielle du loisir, «École ne veut pas dire “école”, mais “loisir”» (p. 18). Ce qui signifie, en somme, que loisir ne veut pas (seulement) dire «loisir», mais (aussi) «école».
Plus qu’une plage de temps libre, plus qu’un moment de délassement, plus même qu’une occasion de s’instruire, le loisir est, anthropologiquement, une capacité et une disposition de l’âme à la quiétude, à la réceptivité, bref à la contemplation, dans laquelle l’homme exerce son aptitude à se recevoir et à se concevoir, dans l’intuition spirituelle des vérités les plus vitales. Par le loisir, l’homme échappe à toute finalité étroitement mondaine, se soustrait à la logique utilitariste qui voudrait ne faire de lui qu’un rouage de la mécanique sociale. Il peut alors cultiver la part la plus haute, la plus précieuse de son humanité. Ainsi, «dans le loisir […], ce qui est véritablement humain est sauvegardé et conservé» (p. 49-50).
Le loisir rend possible l’expérience d’une vraie liberté, il affranchit de la peur animale du manque et fortifie la faculté spirituelle de l’humain à s’abandonner au divin, qui est le véritable horizon ontologique de l’homme.
«C’est pour cela que la capacité de loisir, que l’énergie propre au loisir fait partie des puissances fondamentales de l’âme humaine. Comme le don d’immersion contemplative au sein de l’être et la capacité d’élévation festive du cœur, cette énergie permet, dans le dépassement du monde du travail, d’atteindre des puissances d’être surhumaines et dispensatrices de vie, qui nous renvoient ensuite réconfortés et renouvelés dans la nervosité du quotidien» (p. 49).
Josef Pieper, Le loisir, fondement de la culture, Ad Solem, 2007, 78 pages.
*
La (vraie) première mairesse
Ce livre est la réédition mise à jour d’une biographie de Jeanne Mance originellement parue en 1995, et qu’il est opportun de (re)lire, alors que nous célébrions dernièrement le 375e anniversaire de la fondation de Ville-Marie/Montréal.
En même temps qu’il relate la vie de mademoiselle Mance, l’ouvrage nous replonge dans l’histoire épique des fondateurs de Montréal. Jugez-en vous-mêmes par cet extrait: «Le 29 juillet 1652, Martine Messier […] est attaquée par des Iroquois dissimulés dans les blés presque murs. Elle est à deux portées de fusil du fort et hurle pour donner l’alerte. Il faut trois ou quatre coups de hache pour parvenir à la faire taire. Après quoi, un des assaillants veut la scalper. Alors elle le saisit, dit un témoin, “par un endroit que la pudeur nous défend de nommer” et ne lâche prise qu’en s’évanouissant. Les Français arrivent.» Martine sera sauvée.
On déplorera seulement que l’auteur ait jugé bon d’entretenir le doute sur le caractère surnaturel de la guérison du bras «desséché et livide» de Jeanne Mance, survenue le 2 février 1659, alors qu’elle s’apprêtait à se recueillir près du cercueil de Jean-Jacques Olier. Sous prétexte de retenue scientifique, l’historienne donne ainsi à l’explication tendancieusement rationaliste une plausibilité égale à celle que tous les témoins de l’époque avaient privilégiée, Jeanne Mance la première, à savoir qu’il s’agissait d’une guérison miraculeuse du corps, accompagnée d’une grâce de communion spirituelle (joie et larmes) avec le «bien heureux serviteur de Dieu».
Françoise Deroy-Pineau, Jeanne Mance. De Langres à Montréal, la passion de soigner, Fides, 2016, 144 pages.
*
Les bourreaux du Seigneur
La foi en un Dieu mystérieux et invisible a-t-elle quelque chose à offrir aux hommes soumis à une aussi abominable débauche de crimes, à un déchainement de violence et de haine aussi monstrueux que ceux auxquels se sont livrés les soldats allemands durant la Seconde Guerre mondiale? Question difficile, car, en un sens, il est manifeste que la foi n’est d’aucun secours. Elle n’a pas sauvé Jeanne d’Arc d’une mort atroce sur le bucher. Elle n’a pas épargné la guillotine aux carmélites de Compiègne. Elle n’a pas empêché l’extermination de centaines de milliers de Juifs à Treblinka.
Elle n’a pas non plus détourné la Gestapo de soumettre à la question la jeune Maïti Girtanner, compromise dans la Résistance et presque laissée pour morte à la fin du dernier interrogatoire qui précéda son sauvetage par l’armée des ombres, en février 1944. À lire son témoignage, il ne fait cependant aucun doute que Dieu fut le roc sur lequel elle s’appuya, depuis le premier jour de l’Occupation, qui força sa famille à héberger chez elle des officiers allemands, jusqu’aux ultimes moments de son supplice, et même au-delà, durant les années où elle emprunta le long chemin qui la conduisit à pardonner à ses bourreaux.
Non seulement se tourna-t-elle vers le Seigneur en toute circonstance, mais elle encouragea aussi les autres à le faire. Surtout dans les moments les plus critiques, lorsque, par exemple, au petit matin, il fallait faire traverser clandestinement des résistants en zone libre, en tirant avantage de l’emplacement de la maison familiale, sise au bord de la Vienne, une rivière qui servait alors de frontière entre les deux zones. En tout et pour tout, Maïti organisa une centaine de traversées. Chacune fut l’occasion de rappeler la sollicitude de Dieu aux hommes éprouvés qu’elle guidait vers la liberté.
Aux deux officiers en cavale venus un jour la prier d’organiser discrètement leur passage en zone libre, elle demanda, sans préambule, alors que la tension était à son comble et que le moment de traverser le cours d’eau était venu: «Êtes-vous chrétiens?» Un des deux fugitifs interloqués lui répondit: «J’étais catholique.» Maïti répliqua: «Eh bien, tâchez de le redevenir. Peut-être que vous, vous avez abandonné le Seigneur, mais lui ne vous a pas abandonné. C’est le moment de vous en souvenir.» À l’autre qui devait attendre son tour pour franchir la rivière, elle demanda de prier pour son ami, ce qu’il fit.
Quand elle parlait ainsi de l’amour de Dieu, Maïti faisait montre d’une assurance, d’une fermeté d’âme et d’une force de conviction telles que, pour quelques-uns au moins des fugitifs et des combattants qu’elle aida, ses paroles eurent l’effet d’un «choc spirituel». «C’était pour eux que je posais cette question. Pour qu’ils puisent en eux une énergie qu’ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes. Pour qu’ils découvrent ou redécouvrent que, dans ce moment crucial de leur vie, ils n’étaient pas seuls. Pour qu’ils sachent qu’au moment où leur pas hésiterait Quelqu’un les précèderait, leur ouvrant la voie avec assurance.»
Maïti perdit son aplomb lorsque, un jour, son principal bourreau, malade et condamné à une mort prochaine, vint la voir en France, quarante ans après la fin de la guerre, dans l’espoir qu’elle pourrait l’aider à affronter la mort avec plus de sérénité. Ainsi, l’ancien bourreau venait-il solliciter le secours de celle qu’il avait failli tuer et dont le témoignage de foi et d’espérance l’avait secrètement marqué en 1944. Sa demande d’aide ne fut précédée d’aucune demande de pardon, cependant. À l’homme qui l’avait handicapée à vie, qui l’avait enfermée dans la douleur physique pour toujours, qui avait détruit sa carrière de pianiste et pulvérisé ses rêves de famille, Maïti commença à parler de torture… et de miséricorde divine.
Maïti Girtanner, «Même les bourreaux ont une âme», CLD éditions, 2006, 208 pages.
___
Revu et augmenté le 18-09-2018